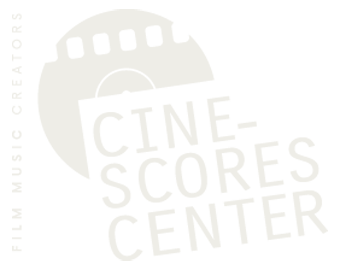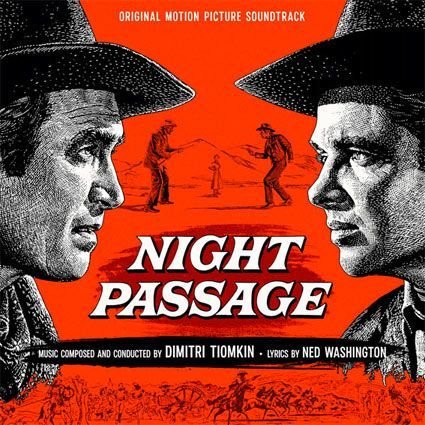Spellbound

Grand classique incontournable du cinéma américain, « Spellbound » (La maison du docteur Edwardes) est de loin l’un des plus brillants films d’Alfred Hitchcock, et aussi un chef-d’oeuvre intemporel du septième art. Réalisé en 1945, « Spellbound » est une adaptation du roman « The House of Dr. Edwardes » (1927) de John Palmer et Hilary A.Saunders, roman qui attira l’attention du fameux producteur américain David O.Selznick et qui l’incita à concevoir la production de « Spellbound ». La réalisation fut ainsi confiée à Alfred Hitchcock, qui avait déjà travaillé avec Selznick en 1940 sur le prestigieux « Rebecca », son premier long-métrage hollywoodien, avant de retrouver à nouveau le producteur sur « Spellbound ». Le film se déroule dans l’univers de la psychanalyse et raconte l’histoire du docteur Constance Petersen (Ingrid Bergman), qui travaille dans l’établissement psychiatrique de Green Manors dirigé par le docteur Murchinson (Leo G. Carroll). Ce dernier est sur le point de prendre sa retraite, et doit être remplacé sous peu par le jeune et talentueux docteur Anthony Edwardes (Gregory Peck). Peu de temps après son arrivée, Edwardes et Constance tombent amoureux l’un de l’autre, mais très vite, la psychiatre remarque l’attitude étrange de son nouveau chef : elle découvre alors que son directeur est en réalité un amnésique nommé John Ballantine, qui a usurpé l’identité du docteur Edwardes, et qu’il est soupçonné de l’avoir fait disparaître. Constance décide alors d’aider Ballantine à retrouver la mémoire et à découvrir la vérité au sujet de la disparition du docteur Edwardes. « Spellbound » est certes un classique intemporel du cinéma américain, mais le film ne s’est guère fait sans heurt. Alfred Hitchcock se brouilla régulièrement pendant le tournage avec le psychanalyste consultant du film le Dr. May Romm engagé par David O.Selznick lui-même, tandis que les scènes de rêve surréalistes vers la fin du film, confiées au peintre Salvador Dali, ont été en grande partie coupées par le producteur lui-même (la séquence onirique durait à l’origine environ 20 minutes). Autre problème de taille : la production souhaitait engager Bernard Herrmann à la musique, mais ce dernier n’étant pas disponible au moment du film, ce fut finalement Miklos Rozsa qui fut engagé pour composer le score de « Spellbound », ce qui déplu particulièrement à Hitchcock qui n’aima guère la musique de Rozsa. Fort heureusement, le succès fut au rendez-vous pour Hitchcock et le film obtint un Academy Award pour la meilleure musique et fut nominé dans plusieurs catégories en 1945.
« Spellbound », en plus de contenir une intrigue policière passionnante – comme toujours chez Hitchcock – est aussi un chef-d’oeuvre de mise en scène et de plastique visuel : Hitchcock réalisa sans aucun doute l’un de ses films les plus artistiques visuellement parlant, multipliant les trouvailles visuelles et les plans symboliques avec une maîtrise rarement égalée pour l’époque. A cette intrigue de psychanalyse torturée (assez moderne, pour un film hollywoodien de 1945 !), Hitchcock répondit par un film dont les symboles se multiplient et s’enchevêtrent pour former un véritable puzzle visuel absolument saisissant. A ce sujet, il faudra d’ailleurs plusieurs visions pour pouvoir appréhender chacune des composantes de ce dédale de portes et de couloirs, car c’est justement là que le film touche son but : créer la sensation d’être dans l’esprit de John Ballantine en multipliant les plans de portes, qui s’ouvrent ou qui se referment, comme si Hitchcock avait voulu nous plonger consciemment dans le cerveau du personnage de Gregory Peck. On se souviendra notamment de cette scène symbolique où l’on voit plusieurs portes s’ouvrir l’une en face de l’autre, quasiment à l’infini, lors de la scène où Constance cède enfin à l’amour avec Ballantine. Evidemment, on se souviendra surtout de l’anthologique séquence du rêve, qui doit beaucoup aux décors surréalistes de Salvador Dali. Cette séquence s’inspire aussi particulièrement des expériences surréalistes du cinéma expressionniste allemand des années 20, et plus particulièrement de F.W. Murnau, Fritz Lang ou Robert Wiene. Quand au sujet de la psychanalyse, Hitchcock l’aborde avec brio dans son film, malgré quelques facilités évidentes (les solutions et interprétations des rêves ou des souvenirs semblent trop souvent préconçues ou inébranlables, ce qui en réalité n’est jamais le cas, la psychanalyse n’ayant jamais eu vocation à être une science de LA vérité). On sait que le réalisateur a commencé à s’intéresser à cette science nouvelle à son arrivée aux USA au début des années 40, un élément qui deviendra d’ailleurs récurrent dans la plupart de ses films (« Psycho » et « Vertigo » étant probablement les deux cas les plus connus). Le visuel en noir et blanc du film permet d’ailleurs de renforcer le caractère froid et clinique de cette intrigue de psychanalyse (un peu comme le fera John Huston dans son superbe « Freud » en 1962), avant que le réalisateur ne se décide, à travers le personnage de la belle Ingrid Bergman, à rendre le tout plus chaleureux à travers l’inévitable romance hollywoodienne, plus conventionnelle mais tout aussi réussie. Tous ces éléments permirent donc à Alfred Hitchcock de nous offrir l’un des films les plus mémorables de sa filmographie, un grand moment de cinéma qui deviendra par la suite une référence incontournable du genre, au même titre que des classiques tels que « Psycho », « North by Northwest » ou bien encore « Vertigo » !
La partition symphonique de Miklos Rozsa contribua grandement au succès de « Spellbound », à tel point que le compositeur gagna ainsi l’Oscar de la meilleure musique en 1945. Même si la musique était prévue à l’origine pour Bernard Herrmann, Rozsa s’en tira à bon compte sur le film d’Hitchcock et nous livra une partition mystérieuse et romantique du plus bel effet, totalement indissociable de l’univers visuel de « Spellbound ». Dans une note du livret de l’album publié par Intrada, Rozsa explique qu’Hitchcock et Selznick lui demandèrent de composer un grand thème romantique et un thème plus étrange pour la paranoïa d’Edwardes/Ballantine. C’est alors que le compositeur eu une idée de génie : utiliser le théremin, fameux instrument électronique crée en 1919 par le russe Léon Theremine, et qui deviendra un instrument incontournable par la suite à Hollywood, et plus particulièrement dans les films de science-fiction américains des années 50. D’abord sceptiques à l’origine, Hitchcock et Selznick furent tellement épatés par le son du théremin qu’ils demandèrent à Miklos Rozsa de l’utiliser un peu partout dans le film, à chaque apparition du thème de la paranoïa ou dans la plupart des scènes où John Ballantine essaie de se souvenir de ce que son esprit essaie de refouler depuis son enfance. Rozsa explique aussi qu’il fut particulièrement impressionné par le travail de Salvador Dali, qui lui inspira en grande partie la plupart de ses idées et couleurs musicales sur la musique de « Spellbound ». Pour le reste, le succès de la partition permit à Rozsa d’obtenir un Oscar en 1945 et de voir son travail adapté à de nombreuses reprises, et notamment sous la forme d’un concerto pour deux pianos sorti dans les années 80. L’enregistrement que nous propose Intrada est une réinterprétation intégrale de la partition complète de « Spellbound », nous permettant ainsi d’entendre pour la première fois certains développements thématiques inédits et certains détails qui n’apparaissaient pas dans les précédentes éditions (hélas, pas de version originale en vue, l’enregistrement de 1945 étant donc trop daté et probablement perdu !). Le film s’ouvre au son de la fanfare écrite par Alfred Newman pour le studio Selznick, suivie immédiatement du premier thème du score, un motif de 4 notes chromatiques descendantes et mystérieuses brillamment interprétées par le théremin avec des réponses en imitation aux contrebasses, des cordes et des bois sur fond de timbales et de cors dramatiques. Le thème du mystère psychologique cède ensuite la place au prestigieux et célèbre Love Theme, sans aucun doute l’un des thèmes romantiques les plus célèbres et les plus reconnaissables du Golden Age hollywoodien des années 40. Le Love Theme de Constance et John nous est présenté ici dans son intégralité à travers un puissant tutti orchestral au lyrisme flamboyant et passionné, dans une tonalité de mi bémol majeur : harmoniquement, le thème se structure essentiellement sur deux accords, le premier degré de mi bémol majeur, et un accord du deuxième degré altéré (avec do bémol) et renversé (toujours sur basse mi bémol) : cet enchaînement très technique paraît peut-être un brin abstrait pour les novices, mais il faut savoir qu’il s’agit là d’un élément harmonique très utilisé dans la musique romantique du Golden Age hollywoodien, inspiré des oeuvres du Romantisme allemand du 19ème siècle (quoiqu’on pense davantage à certaines mesures lyriques de la fameuse « Symphonie Romantique » N°2 d’Howard Hanson). Ce somptueux Love Theme, très présent et abondamment répété tout au long du film, servira de base quelques années plus tard au fameux « Spellbound Concerto » pour piano et orchestre, que Rozsa adaptera lui-même pour ses oeuvres de concert.
Après le superbe générique de début – qui reste un grand moment de musique de film et une ouverture célèbre – Miklos Rozsa nous donne à entendre un troisième thème pour « Foreword », lors du texte initial qui pose les bases de l’histoire et nous permet de resituer l’intrigue dans son contexte. Ce thème, plus doux et apaisé, conserve une approche lyrique à travers son écriture suave et raffinée des cordes sur fond de cors et de bois. Le thème de « Foreword » est ensuite repris à la flûte et aux cordes dans « Green Manors », avec ses harmonies quasi impressionnistes et son violon soliste au lyrisme élégant typique de Miklos Rozsa. Le quatrième thème de la partition apparaît ensuite dans « First Meeting », une sorte de scherzo plus exubérant et joyeux que Rozsa adaptera lui aussi dans son « Spellbound Concerto » quelques années plus tard. Le thème du scherzo évoque la rencontre entre Constance et Ballantine et l’idée d’un amour naissant, plein de joie et d’entrain. Le morceau se conclut d’ailleurs avec une brève reprise du thème mystérieux à la clarinette sur fond de timbales et de tremolos de contrebasses annonçant la tension et le suspense à venir. Quand au Love Theme, il revient dans une très belle version pour hautbois, cordes et harpe dans « The Picnic », évoquant l’idylle entre la jolie psychanalyste et le séduisant imposteur, dans un ton plus léger et pastoral. La partition nous propose ensuite l’un des premiers sommets de la musique de « Spellbound », dans ce qui reste le morceau le plus long du score (et de la filmo en général de Rozsa), plus de 16 minutes de musique ininterrompues dans la scène du premier baiser de Constance et Ballantine jusqu’à « The Cigarette Case ». Le compositeur développe pleinement ici son Love Theme passionné dans une série de variations orchestrales passionnées et brillantes, entrecoupées de brèves variations autour du thème psychologique mystérieux pour le personnage de Gregory Peck. On notera ici l’emploi du violon ou du violoncelle soliste avec le retour de l’énigmatique théremin lors de la scène où Ballantine semble pris d’un malaise soudain – le théremin soulignant parfaitement à l’écran cette sensation troublante de malaise. Thématiquement, en plus du Love Theme et du thème mystérieux, on retrouve aussi un motif entendu au début de « First Meeting » et un nouveau motif, qui apparaît furtivement vers 11:51 aux bois, motif associé au mystère de l’identité de l’imposteur, et que Rozsa utilisera à quelques reprises dans le film. On appréciera le travail du théremin dans « The Burned Hand » et son apparition quasi fantomatique qui annonce clairement le style des futures musiques de science-fiction des années 50/60 (on pense déjà au « The Day the Earth Stood Still » de Bernard Herrmann en 1951), tandis que le motif du mystère est ses figures mélodiques chromatiques et brèves reviennent aux cordes et aux cuivres en sourdine à la fin de « The Burned Hand », symbolisant les tourments et la tension. Le suspense devient d’ailleurs de mise dans le sombre « The Penn Station » et son écriture orchestrale plus dense et torturée accompagnée du théremin avec quelques trouvailles instrumentales intéressantes (une combinaison d’un célesta, d’un vibraphone et d’un novachord pour créer une atmosphère mystérieuse quasi surréaliste à l’écran). Au fur et à mesure que l’histoire avance, la musique s’intensifie et fait monter progressivement la tension, ramenant ainsi le thème psychologique aux cordes et au théremin pour la scène du rasoir dans le troublant « Honeymoon at Brulov’s/The White Coverlet/The Razor/Constance is Afraid ». On appréciera ici l’accélération rythmique spectaculaire de « The Razor » et ses notes répétées de caisse claire, dont l’entêtant ostinato rythmique n’est pas sans rappeler le battement d’un coeur. On retrouve ici aussi le motif mystérieux de « The Cigarette Case » associé aux secrets enfouis dans l’esprit torturé de Ballantine, la musique cédant petit à petit la place à une atmosphère psychologique plus terrifiante et particulièrement sombre et tourmentée.
La fameuse séquence du rêve permet à Rozsa de nous offrir un morceau-clé de la partition de « Spellbound » dans « Gambling Dream/Mad Proprietor’s Dream/Roof-Top Dreams ». Rozsa utilise ici un solide mélange de théremin et d’orchestrations quasi impressionnistes, à mi-chemin entre Ravel et Debussy, sans oublier cette étonnante combinaison de novachord, célesta, cloches, harpe, glockenspiel, flûte et piccolo qui illustrent parfaitement l’atmosphère onirique et surréaliste de cette séquence, sur fond de glissandi mystérieux de théremin. Les harmonies impressionnistes du morceau renvoient clairement à certaines mesures de « La Mer » de Debussy et à une bonne partie de l’école impressionniste française de la fin du 19ème siècle – on pense aussi aux grandes oeuvres symphoniques de Maurice Ravel. Miklos Rozsa prolonge d’ailleurs son travail autour de l’atmosphère onirique du rêve dans « Dream Interpretation Parts 1 & 2/The Decision » avec un motif de piccolo/xylophone comparable au balancement d’un pendule. Le motif mystérieux revient dans « Train To Gabriel Valley » tandis que « Ski Run/Mountain Lodge » (non utilisé dans le film) présente un solide morceau d’action pour la scène où Ballantine et Constance descendent la pente enneigée à skis. Dans le film, la musique a été en partie remplacée par des pièces de Roy Webb et Franz Waxman entre autre, ce qui est parfaitement regrettable, étant donné que Rozsa avait écrit l’un des morceaux les plus spectaculaires et les plus intenses de la partition de « Spellbound » pour cette fameuse scène du ski. Enfin, « The Revolver » nous permet d’aboutir à la sombre révélation finale (ici aussi, la scène utilise dans le film une musique de Roy Webb) avec le retour du motif mystérieux. La musique évolue vers un long crescendo dramatique et violent pour la scène étonnante du pistolet vu à la première personne, aboutissant à un climax orchestral brutal et tragique. Le film se termine sur une ultime reprise grandiose et puissante du Love Theme dans « The End », le morceau se concluant avec une brève touche d’humour avant d’aboutir à une coda en Do majeur puissante et triomphante, un vrai final digne des plus grandes symphonies classiques. Miklos Rozsa nous livre donc pour « Spellbound » un véritable chef-d’oeuvre de la musique de film, à redécouvrir dans son intégralité grâce au superbe et très respectueux réenregistrement d’Intrada. La partition symphonique de « Spellbound » est à plus d’un titre un sommet de la musique du Golden Age hollywoodien, une oeuvre intemporelle d’une maîtrise et d’une grande richesse, servie par des influences classiques (les musiciens Romantiques du 19ème siècle, la Symphonie Romantique d’Howard Hanson, la musique impressionniste française de Ravel et Debussy) et une incroyable floraison de thèmes et de motifs divers et variés. Evidemment, les auditeurs retiendront tous le thème mystérieux et l’immortel Love Theme, un sommet de lyrisme et de romantisme que Rozsa lui-même parviendra difficilement à égaler par la suite, hormis peut être dans ses magnifiques mesures lyriques pour violon et orchestre de « The Private Life of Sherlock Holmes » (1970). Il est vrai que Rozsa s’est spécialisé tout au long de sa carrière dans les grandes envolées orchestrales romantiques, mais ce fait n’a jamais était aussi vrai que dans sa somptueuse partition pour « Spellbound » : laissez-vous donc emporter par le lyrisme passionné et le mystère de ce véritable chef-d’oeuvre de la musique de film hollywoodienne, à ne rater sous aucun prétexte !