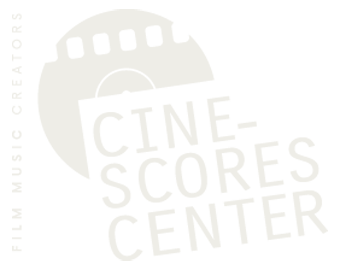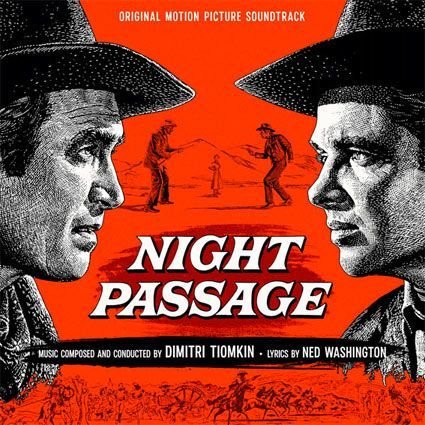Citizen Kane

« Citizen Kane » fait partie de ses éternels classiques du septième art que l’on ne présente plus. Premier long-métrage hollywoodien du jeune Orson Welles tourné en 1941, « Citizen Kane » raconte l’ascension et la chute d’un magnat de la presse américaine dans l’Amérique de 1940. Charles Foster Kane (Orson Welles) meurt dans son gigantesque manoir de Xanadu après avoir prononcé dans son dernier souffle le mot « Rosebud » en laissant échapper une boule de Noël. La presse s’intéresse alors à l’ultime mot énigmatique prononcé par le milliardaire avant son décès. Le journaliste Thompson est chargé de percer le mystère du mot « Rosebud » et décide alors de rencontrer tous ceux qui ont bien connu Charles Foster Kane dans sa vie passée. Au gré de ses rencontres, Thompson découvre le passé agité de Kane : arraché très jeune à sa mère qui hérita par hasard d’une mine d’or, le jeune Charles fut élevé par un banquier, Mr. Thatcher, afin de le préparer à gérer sa fortune à l’âge de 25 ans. A l’âge adulte, Kane devint un grand magnat de la presse américaine et épousa la nièce du Président des Etats-Unis. Il décida ensuite de se lancer dans la politique, mais sa carrière fut stoppée net par un scandale révélant une liaison adultère entre le politicien et une jeune pseudo-cantatrice d’opéra, Susan Alexander. Il décida ensuite d’épouser la chanteuse pour qui il construira un énorme opéra et le fastueux manoir de Xanadu. Mais sa nouvelle épouse, lasse de tant de luxe et de richesse, décidera de quitter Charles pour de bon. Cet événement conduira Charles Foster Kane à sa perte. « Citizen Kane » est un film majeur dans l’histoire du cinéma, souvent considéré comme le meilleur film de tous les temps et connu pour ses innovations cinématographiques et narratives. Saisissant son expérience passée à la radio dans les années 30, le jeune Orson Welles fit appel à une partie des acteurs de sa troupe de théâtre du Mercury Theater pour le casting du film – alors quasiment constitué d’acteurs débutants et méconnus à l’époque – tandis que le réalisateur campa le rôle de Charles Foster Kane à l’écran avec brio et conviction.
La narration du film, révolutionnaire pour l’époque, est quasiment entièrement construite sur une série de flashbacks – cela paraît banal aujourd’hui, mais pour un film de 1941, c’était extrêmement moderne et anti-conventionnel – qui permettent de revenir sur le passé du personnage principal campé par Orson Welles. Certaines scènes sont même racontées successivement par deux personnages différents, apportant un éclairage nouveau à chaque récit. En s’affranchissant des règles habituelles de la narration cinématographique, le cinéaste faisait déjà de « Citizen Kane » un film moderne et révolutionnaire pour l’époque. La mise en scène, extrêmemement élaborée, utilise toutes les possibilités de la caméra à l’époque : en plus de trucages visuels et d’effets spéciaux assurés par Vernon L. Walker, le film repose aussi sur une série de plans en plongée et contre-plongée représentant des moments-clé dans le récit de Kane (le discours politique contre Jim Gettys, la dispute dans la chambre avec Susan, la demande de mutation de Leland à Kane, etc.), mais en inversant la symbolique ordinaire des plans : la contre-plongée devient ici le faire-valoir du pouvoir et de l’orgueil de Kane qui dépasse l’homme et l’écrase sous le poids de ses fautes. Certaines scènes sont d’une inventivité visuelle confondante, comme cette scène où Kane passe devant une série de miroirs qui reproduisent son reflet à l’infini, des plans qui ne sont pas sans rappeler certaines oeuvres picturales du début du 20ème siècle. Enfin, le succès du film fut tel qu’il devint une véritable icône dans la culture populaire au fil des années, cité par de nombreux cinéastes du monde entier et des artistes d’horizons divers. Quand à l’anthologique « Rosebud », ce mot énigmatique – et peut être le plus célèbre de l’histoire du cinéma - continue de traverser les époques et de susciter la curiosité et l’enthousiasme de milliers de cinéphiles, un véritable coup de génie en somme pour ce qui reste, à n’en point douter, un classique insurpassable du septième art.
Orson Welles décida de confier la musique de « Citizen Kane » au jeune Bernard Herrmann, avec lequel il travailla quelques temps à la radio entre les années 1937 et 1939 pour le compte de la CBS. Herrmann faisait d’ailleurs partie de l’équipe du Columbia Workshop dirigée par Norman Corwin et Orson Welles avant de devenir chef d’orchestre pour le Mercury Theater on the air de Welles, qui fut à l’époque la première équipe américaine de théâtre à travailler pour la radio. C’est d’ailleurs à cette époque qu’Orson Welles se fit connaître grâce à son spectaculaire et célèbre dramatique radio de 1938 inspiré du « War of the Worlds » d’H.G. Wells. C’est en 1939 que le cinéaste décida d’aller à Hollywood en emmenant avec lui le jeune Bernard Herrmann qui composa alors, à l’âge de 30 ans, la musique de « Citizen Kane ». Herrmann profita de son expérience passée à la CBS pour composer la musique du film d’Orson Welles à la manière de ses travaux pour la radio : à contrario de bon nombres de partitions musicales du cinéma hollywoodien des années 30/40, la musique de « Citizen Kane » alla d’emblée à l’encontre du concept de musique au kilomètre utilisée de façon quasi non-stop comme le voulait la tradition de l’époque (on pense aux oeuvres de Korngold ou de Steiner par exemple) en imposant une approche des images plus morcelée et offrant davantage d’espace aux silences : ainsi, la plupart des morceaux composés par Herrmann étaient utilisés pour servir de transition entre deux scènes ou pour renforcer des effets de montage, chose assez moderne pour l’époque encore une fois. Le compositeur fut aussi relativement libre de choisir son instrumentation comme il le souhaitait lors des sessions d’enregistrement : c’est pourquoi il décida très rapidement de mettre en avant des orchestrations assez inhabituelles comme le fameux quatuor de flûtes basse utilisées en ouverture du film, un trait caractéristique du style de Bernard Herrmann qui deviendra par la suite l’une des marques de fabrique de la musique du compositeur – pour un jeune compositeur qui livre sa première expérience pour le cinéma, c’est déjà assez remarquable. Herrmann utilisa aussi le principe du leitmotiv pour élaborer sa partition, tout en refusant l’approche mélodique habituelle, privilégiant davantage les sonorités instrumentales ou les motifs harmoniques. Enfin, « Citizen Kane » permit aussi à Bernard Herrmann de composer un air d’opéra original pour la scène où Susan interprète le « Aria from Salammbô », d’après un texte tiré du célèbre roman de Gustave Flaubert paru en 1862, déjà mis en musique dans le passé par Ernest Reyer puis par Modeste Moussorgski.
Le film débute au son du sombre « Prelude », dominé par des orchestrations à base de bois graves et de vibraphone : on découvrait ainsi dès 1941 le son orchestral typique de Bernard Herrmann : clarinettes basse, basson/contrebasson, quatuor de flûte basse et de flûtes alto, trompettes et vibraphone suffisent à créer une atmosphère lugubre et funèbre dès les premiers plans où l’on aperçoit au loin le manoir abandonné de Xanadu – on notera ici l’absence des cordes et la prédominance des bois, qui apportent une couleur particulière à l’ouverture du film. Les bois développent ici le thème principal du score, motif de 5 notes sombre et mystérieux associé à Charles Foster Kane dans le film. Fait amusant : Herrmann a toujours prétendu être contre le principe du leitmotiv en musique, mais sa musique pour « Citizen Kane » contient tout de même deux thèmes : un est associé à l’enfance de Kane et à son traîneau (entendu aux bois dès le début de « Prelude »), l’autre à l’ascension sociale de Kane adulte. Le dit motif revient ensuite dans « Rain » avec l’ajout des cordes et de la harpe, en plus des bois et du vibraphone. Dans « Litany », la musique prend une tournure plus harmonique et presque religieuse avec l’utilisation étonnante de trompettes en sourdine wah-wah avec une harpe et quelques bois. Le thème de Kane revient dans « Manuscript Reading and Snow Picture » où dominent encore une fois ces instruments à vent mystérieux et latents qui créent une atmosphère intrigante au début du film, annonçant clairement le style des futures partitions thriller d’Herrmann dans les années 50/60. Cette fois-ci, le thème est associé à des accords plus lumineux et signes d’espoir, où il est alors question de l’enfance de Kane. On notera aussi la prédominance des motifs harmoniques (et non mélodiques) et des notes obsédantes et répétitives, autre trait caractéristique du style de Bernard Herrmann. La musique devient heureusement plus exubérante dans « Snow Picture » avec ses bois sautillants pour le flashback sur l’enfance de Kane chez ses parents. Le morceau est important, car il introduit le deuxième thème de la partition, thème lié à l’enfance de Kane, confié ici aux cordes. « Mother’s Sacrifice » crée inversement une atmosphère dramatique pour le départ de l’enfant et la séparation avec ses parents, reprenant et développant le thème de 5 notes de Kane de manière tragique. Les cordes deviennent ici plus chaleureuses et poignantes tout en jouant sur une retenue émouvante et mélancolique. On découvre la facette plus romantique d’Herrmann dans « Charles Meets Thatcher » (avec sa reprise lyrique du thème de l’enfance) et une musique plus exubérante et très colorée dans « Galop » servie par des orchestrations extrêmement riches qui doivent autant à l’école russe du 19ème siècle qu’à celle de Richard Strauss ou Richard Wagner. Et comme souvent chez Herrmann, la musique fonctionne ici sur la rupture et l’idée de la suspension : on retrouve ainsi les flûtes répétitives dans la reprise de l’énigmatique thème principal de 5 notes dans « Second Manuscript », qui nous invite à partager une nouvelle séquence de flashback en suggérant la sensation de temps suspendu et de retour dans le passé, une brillante idée qu’explore Herrmann dans sa musique tout au long du film. Les scènes de transition comme « Thanks » ou « Dissolve » n’apportent pas grand chose en terme d’écoute, mais permettent de cimenter les transitions dans le film, à la manière des programmes musicaux de la radio de la CBS pour lesquels Herrmann composa dans les années 30.
Le compositeur varie les ambiances à loisir et saisit l’opportunité de s’exprimer dans des styles différents, comme le joyeux ragtime jazzy de « Kane’s New Office » évoquant l’ascension sociale de Kane dans la presse, ou la polka sautillante de « Hornpipe Polka », sans oublier le très dansant « Carter’s Exit ». La partie centrale du film évoquant l’ascension sociale et politique de Charles Foster Kane permet à Bernard Herrmann de développer une série de scherzos joyeux et très classiques d’esprit, influencés par la musique symphonique américaine : on pense autant à Georges Gershwin qu’à Aaron Copland dans des morceaux insouciants et joyeux évoquant la vivacité du jeune Kane en pleine force de l’âge. Autre élément important : la quasi absence des deux thèmes, hormis la reprise subite et inattendue du thème principale à la fin de « Carter’s Exit ». Un morceau comme « Chronicle Scherzo » évoque clairement les orchestrations et la vivacité des ballets américains d’Aaron Copland avec un sens du rythme ludique assez similaire, tout comme « Bernstein’s Presto » nous renvoie à l’insouciance des musiques viennoises du 19ème siècle. Le scherzo américain de Kane revient dans « Kane’s Return », mais la partition ne tarde pas à prendre un autre tournure alors qu’à l’écran, on assiste à la première déconvenue de Kane suite à la grande dépression de 1929, obligé de quitter son journal, le « Inquirer ». Le thème de l’enfance revient aux bois dans « Sunset Narration » de manière mélancolique, comme une sorte de retour à la réalité : après l’insouciance, place aux regrets et à l’amertume refoulée pour Kane, « Sunset Narration » restant un morceau extrêmement poignant et profond dans ce qu’il cherche à évoquer – les regrets d’une époque passée et de la chaleur d’un foyer familial que Kane ne connaîtra jamais (d’où l’énigme associée au traîneau). Dans « Valse Presentation », Herrmann introduit un thème de valse viennoise pour le couple Kane/Susan, qui tombe très vite dans la routine de la bourgeoisie américaine et fastueuse. Herrmann développe le thème de valse dans l’excellent « Theme and Variations » dominé par les cordes et les vents, tandis que « Kane and Susan » reprend le thème de l’enfance de Kane avec un lyrisme poignant. Evitant toute envolée romantique qu’Herrmann n’appréciait guère par nature, « Susan’s Room » privilégie à contrario un lyrisme retenu sans aucun artifice mélodramatique, suggérant de manière délicate et touchante le thème de l’enfance dans un style similaire à « Kane and Susan ». La musique devient alors plus sombre et dissonante avec « The Trip » et « Getty’s Departure », marquant un tournant dans l’existence chamboulée de Kane. A contrario, suivant sa logique de la rupture, Herrmann reprend le thème de Kane dans une forme plus joyeuse et exubérante pour le mariage de Kane et Susan dans « Kane Marries », aux allures de flonflon populaire. C’est alors que le compositeur nous dévoile l’un des sommets de la partition de « Citizen Kane », le superbe air d’opéra « Salaambo’s Aria », interprété dans le film par Susan. Véritable création artistique de Bernard Herrmann sur des paroles de John Houseman d’après un texte de Phèdre, le célèbre « Salaambo’s Aria » évoque les grands arias d’opéras romantiques du 19ème siècle, et plus particulièrement ceux de Richard Strauss. Le morceau se termine d’ailleurs par un fameux contre-ut virtuose et spectaculaire de la part de la cantatrice. A noter que l’aria d’Herrmann a été souvent repris par la suite, l’une des plus belles interprétations restant à coup sûr celle de la soprano Kiri Te Kanawa avec le National Philharmonic Orchestra dirigé par Charles Gerhardt en 1974.
Avec « Leland’s Dismissal », Kane entame sa descente aux enfers suite au renvoi de son fidèle ami Leland. Le thème de 5 notes de Charles Foster Kane devient ici plus menaçant et agressif avec ses cuivres sombres et ses timbales agressives. Elément sonore intéressant ici : « Leland’s Dismissal » se conclut sur un accord d’orgue quasi liturgique et mystérieux annonçant la tonalité funèbre du dénouement final. Dès lors, un morceau comme « Xanadu » confirme l’orientation sombre et funèbre de la dernière partie du film et de la musique en développant quasi conjointement les thèmes de Kane et de l’enfance. Dans « Xanadu » et « Second Xanadu », on se rapproche indiscutablement du style et des sonorités du sombre « Prelude ». L’innocence passée fait place aux désillusions et à l’amertume dans « Kane’s Picnic », dans lequel Herrmann corrompt de manière subtile la mélodie aux allures de flonflon populaire de « Kane Maries » avec des cuivres en sourdine superposés brillamment au thème de Kane. Le thème de l’enfance est repris avec une douce mélancolie dans « Susan Leaves », suggérant la fin du couple. Enfin, l’histoire aboutit à son dénouement final tragique dans « The Glass Ball » et « Finale », dévoilant les deux thèmes principaux de la partition pour une conclusion dramatique absolument saisissante. Voici qui conclut ainsi ce monument de la musique de film hollywoodienne, la toute première partition musicale de Bernard Herrmann pour le cinéma et un premier chef-d’œuvre resté inégalé à ce jour : la musique de « Citizen Kane » est un modèle d’illustration musicale d’un film, variant les styles et les ambiances à loisir (jazz, pastiches de musique américaine de l’époque, valse viennoise, aria d’opéra romantique, etc.) tout en affirmant la grande personnalité de musicien si singulière d’un jeune Bernard Herrmann extrêmement motivé et passionné par son sujet, qui saisit l’opportunité grâce au film d’Orson Welles de nous livrer cette brillante partition évoquant les différentes facettes fort complexes du personnage énigmatique de Charles Foster Kane : avec sa structure morcelée (rare à l’époque), son approche psychologique du personnage, ses développements thématiques subtils, ses orchestrations atypiques et sa variété d’ambiances et de trouvailles musicales, « Citizen Kane » reste à ce jour un classique incontournable de la musique de film américaine, un chef-d’oeuvre à ne manquer sous aucun prétexte !