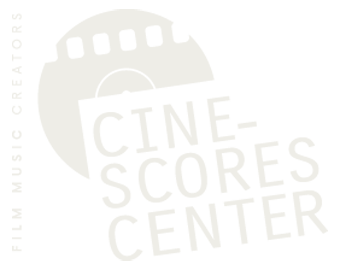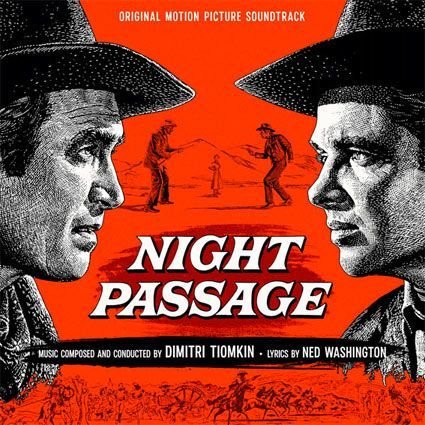Citizen Kane

CITIZEN KANE est un film d’auteur. Toutes les critiques en conviennent. Et avec Welles apparaissant au générique comme scénariste, producteur, metteur en scène et interprète principal, il n’y a plus aucun doute: KANE est bien l’œuvre d’un seul homme : Orson Welles. Une idée reçue veut que le metteur en scène soit «l’âme» du film, qu’il porte ses idées à l’écran en utilisant une équipe de «techniciens». Or il ne faut en aucun cas négliger la contribution des «collaborateurs de création», comme le scénariste, l’opérateur ou le compositeur. En l’occurrence il s’agit de Herman J. Mankiewicz, Gregg Toland et de Bernard Herrmann. On ne peut pas assimiler leurs fonctions à celles de simples exécutants (le réalisateur «utilise» la musique, c’est bien connu!). Cet article se propose d’analyser l’apport d’un de ces collaborateurs: il s’agit du compositeur Bernard Herrmann. Évidemment il peut paraître arbitraire de se borner à la seule dimension acoustique d’un film; cette difficulté est néanmoins inhérente à toute étude spécialisée. Nous nous référerons donc constamment au plan visuel du film.
Herrmann & Welles
Lorsque Welles, en 1940, entama la réalisation de CITIZEN KANE, il insista à faire venir Bernard Herrmann à Hollywood pour écrire la musique de son premier film. Herrmann, tout comme Welles, était un novice dans le domaine du cinéma. Il avait commencé sa carrière en 1933 au Columbia Broadcasting System en écrivant de la musique fonctionnelle pour des émissions de radio, telles que la série «Suspense» de William Spier et Bill Robson ou «Corwin Presents» de Norman Corwin. Dès 1934 il dirigeait les programmes de musique symphonique, en tant qu’assistant chef d’orchestre. A partir de 1936 Herrmann collaborait avec Orson WELLES sur une émission intitulée «The Mercury Playhouse Theatre».
«J’ai appris à devenir un compositeur de film en travaillant sur deux à trois mille pièces radio-phoniques… La radio était le meilleur endroit où l’on pouvait former son sens du dramatique». (1)
En 1941 il y eut CITIZEN KANE. Ce film lança Herrmann sur une nouvelle carrière qu’il allait poursuivre, avec quelques interruptions, jusqu’à sa mort en 1975. Si Welles révolutionna l’art du cinéma avec KANE, Herrmann en fit de même pour la musique de film. Le mot «révolutionnaire» s’appliquant aussi bien à la partition elle-même qu’aux conditions de travail de Herrmann.
Dans un article publié après la sortie de CITIZEN KANE, Herrmann écrivait: «J’avais entendu parler des difficultés qui existent à Hollywood pour un compositeur. L’une d’elles était la vitesse avec laquelle les partitions devaient souvent être écrites – parfois en deux ou trois semaines. Un autre problème était que le compositeur avait rarement le temps d’orchestrer sa propre musique. Et que, lorsque la musique était écrite et enregistrée, le compositeur n’avait rien à dire sur le niveau du son ou la dynamique de la musique dans le film.» (2)
Toutes ces conditions furent bouleversées lors du tournage de CITIZEN KANE. Herrmann disposait de douze semaines pour écrire sa partition, ce qui lui permettait d’élaborer un plan artistique, ainsi que d’orchestrer et de diriger lui-même sa musique. Il travaillait sur le film rouleau après rouleau, avant même qu’il ne fût terminé. De cette manière la musique s’incorporait parfaitement au film.
«A Hollywood la plupart des partitions musicales sont écrites après que le film est entièrement terminé; et le compositeur doit adapter sa musique aux scènes sur l’écran. Dans beaucoup de scènes de CITIZEN KANE une méthode entièrement différente fut utilisé, beaucoup de séquences étant découpées afin de s’adapter à la musique.» (2)
Grâce à ces conditions de travail ainsi qu’à son sens inné du dramatique, Herrmann a pu écrire une partition rompant avec toutes les conventions régnant sur la musique de film hollywoodienne des années ’30 à ’40.
Kane & Rosebud

La musique de CITIZEN KANE se fonde essentiellement sur deux ‘leitmotivs’ dont l’utilisation dans ce film «était pratiquement impérative à cause de l’histoire et de la manière suivant laquelle elle était développée.» (2)
- Un bref thème de quatre notes, joué par les cuivres, symbolise la puissance et la soif de pouvoir de Charles Foster Kane (= thème de Kane).
- Un thème mélancolique caractérise le traineau «Rosebud» et par conséquent la jeunesse perdue de Kane (= thème de «Rosebud»).
Ces deux thèmes reviennent sous différentes formes à travers le film pour commenter et expliquer les actions de Kane. Le début de CITIZEN KANE constitue jusqu’à ces jours une pièce d’anthologie de la musique de film: Deux titres annoncent le film: «A Mercury Production by Orson Welles» et CITIZEN KANE. L’écran devient noir pendant quelques secondes. Nous voyons apparaitre un portail portant un écriteau: «No Trespassing». La caméra monte le long du grillage. En haut du grillage est monté – en fer forgé – une sorte d’emblème montrant la lettre «K». Dans la brume on distingue les contours énormes d’un château. De courts plans nous font voir une cage de singes, un lac artificiel avec des gondoles, un champ de golf, des statues et des ruines artificielles; la caméra se rapproche d’une fenêtre illuminée dans la tour principale du bâtiment.
La musique, qui commence une à deux secondes avant la première image du film, accentue l’atmosphère sinistre et oppressante qui caractérise cette scène. Autour du thème de Kane, joué par les cuivres (trombones bouchés) sur une pédale des contrebasses dans les premières mesures de la partition, Herrmann crée une sorte de requiem pour Kane, vaguement réminiscent du chant grégorien «Dies Irae». Graduellement contrebasson, clarinettes et flûtes se joignent aux cuivres; le thème de «Rosebud» apparait, joué par le vibraphone. Lorsque la caméra s’approche de la fenêtre illuminée, la lumière s’éteigne; la musique s’arrête après un accord brusque des cuivres. Le spectateur a l’impression d’avoir été surpris en train de s’avancer sur un terrain interdit (le mouvement de la caméra s’est aussi arrêté). (3)
Après quelques secondes de silence complet l’action continue; le spectateur est maintenant à l’intérieur de la chambre où l’on aperçoit un vieil homme – Charles Foster Kane – étendu sur un lit. En gros-plan on voit une boule de verre avec une petite maison et remplie de neige artificielle. Le thème de «Rosebud» qu’utilise Herrmann dans cette scène, nous révèle inconsciemment et par anticipation l’identité de «Rosebud»; «le tintement de clochettes de traineau dans la musique fait une référence ironique à des clochettes de temple indien – la musique gèle» (4), avant que Kane murmure: «Rosebud!» et laisse tomber la boule de verre. Dans toute cette séquence la musique contribue à accentuer le caractère expressionniste des images et constitue un commentaire extérieur à ces images (utilisation du thème de «Rosebud»).
Le thème de Kane est souvent employé à travers le film pour commenter les actions de Kane. Une des utilisations les plus originales du thème se trouve dans la scène où Kane et Leland arrivent à l’INQUIRER sur les rythmes d’un ‘ragtime’ (nous sommes dans les années 1890) qui, après quelques mesures, se révèle n’être qu’une variation extrêmement poussée du thème de Kane. La musique découvre ainsi les vraies raisons qui ont poussé Kane à diriger un journal. Un autre exemple de ce genre est constitué par le montage des scènes de petit-déjeuner. Le thème de Kane, puissamment orchestré, est aussi lié à Xanadu (flashbacks de Susan et de Raymond) pour 1) communiquer un sentiment de crainte aux spectateurs, et 2) souligner la mégalomanie de Kane.
Dans la scène du picnic ce thème dénonce les intentions de Kane et des « amis » qui l’accompagnent dans une longue file de voitures («Invite everybody! Order everybody, you mean, and make them sleep in tents. Who wants to sleep in tents when they’ve got a nice room of their own, with their own bath, where they know where every thing is?», dit Susan).
Le thème de «Rosebud» est également utilisé à différents moments-clé du film. Ainsi dans la séquence de la Thatcher Memorial Library où le reporter Thompson veut trouver la réponse à «Rosebu » dans les mémoires inédites de Walter Parks Thatcher. Tandis que Thompson commence à lire («I first encountered Mr. Kane in 1871…»), un ostinato de la flûte (et en contrepoint le thème de Kane sur cuivres bouchés) se transforme en thème de «Rosebud», tandis que le texte se dissout et l’on voit apparaître un paysage d’hiver. Ce thème accompagne aussi la séparation cruelle du petit Charles de sa mère et son départ avec Thatcher. Une variation du thème de «Rosebud» est utilisée pendant la première rencontre de Kane et de Susan Alexander, constituant ainsi un commentaire tout à fait original sur les sentiments de Kane.
Dans la scène finale du film (symétrique au début) Herrmann utilise les deux thèmes pour créer une conclusion particulièrement pathétique et mémorable: Thompson et les autres journalistes, sans avoir résolu le problème de «Rosebud», se préparent à quitter Xanadu. Une variation sinistre du thème de Kane (cuivres bouchés et violoncelles) accompagne un long travelling sur les objets d’art accumulés par Kane ; un motif plus triste est joué par les bois. Tandis que l’on voit un ouvrier jeter des objets dans un four, un accord aigu des cuivres et des trilles (violoncelles) préparent le spectateur au plan suivant: sur le traineau que l’homme vient de jeter au feu, on lit clairement le nom «Rosebud» dont le thème est littéralement «hurlé» (5) par tout l’orchestre. Le thème de Kane, puissamment orchestré pour cuivres, conclut le drame.
Autres «leitmotivs»

A part ces ‘leitmotivs’ au sens conventionnel du terme, Bernard Herrmann utilise parfois des pièces de musique «réaliste» pour marquer l’évolution des principaux personnages à travers le film. La chanson liée à la campagne électorale de Kane apparait pour la première fois dans la scène du diner de fête à l’INQUIRER. Elle fut écrite par Herman Ruby sur une musique de Pépé Guizero) (6) :
«There is a man, a certain man, And for the poor you may be sure, That he’ll do all he can. Who is this one, this favirite son, Just by his action has the Traction magnates on the run…»
Une version orchestrale de cette chanson est utilisée pendant l’allocution de Kane à Madison Square Garden. C’est le thème du succès social de Charles Foster. Herrmann en fait une utilisation ironique après la défaite électorale de Kane; jouée tristement par un orgue de Barbarie, la chanson reflète les sentiments de Kane tout en rappelant les temps passés.
«Una voce poco fa», un air de ROSSINI, est lié étroite ment à la carrière artistique de Susan Alexander Kane. Susan le chante à la demande de Kane lors de leur première rencontre. C’est ce même air que Signor Mattisti, le professeur de chant de Susan, s’efforce d’enseigner à son élève peu douée. Il revient – également joué par un orgue de Barbarie – dans la scène où Kane, après le suicide raté de Susan, promet à sa femme qu’elle n’aura plus jamais à chanter en public.
Un autre thème est associé à l’évolution des rapports entre Susan et Kane: il s’agit de «In a Mizz», une composition de Charles Barrett et Haven Johnson. (6) Joué par un vibraphone dans la scène à l’«El Rancho», cette chanson commente la déchéance de Susan après son divorce de Kane. Elle réapparait, jouée par un groupe de musiciens noirs, dans la scène du picnic. Dans cette séquence la musique ainsi que les paroles («There ain’t no love, there ain’t no true love») constituent un contre point ironique à la querelle entre Kane et Susan.
Une collaboration étroite

Il y a déjà été question de la collaboration étroite entre Herrmann et Welles. Cette collaboration est sur tout évidente dans les différents montages à travers le film, qui ont souvent été assemblés de manière à s’adapter à la musique. Des pièces musicales complètes furent écrites pour ces montages.
Dans les scènes montrant les activités de Kane à l’INQUIRER – qui ont toutes lieu dans les années 1890 – Herrmann utilise les formes de danse populaires à cette époque. Ainsi le montage montrant l’augmentation du tirage de l’INQUIRER est accompagné par un can-can, La campagne contre le «Traction Trust» est réalisée en forme d’un galop. Kane et Leland arrivent à l’INQUIRER aux rythmes d’un ‘ragtime’. (2)
Cette méthode est le plus parfaitement appliquée dans les scènes de petit-déjeuner. Dans ce montage de six scènes Welles montre la déchéance du premier mariage de Kane. Herrmann utilise une valse «dans le style de Waldteufel» (2) et une série de cinq variations sur ce thème, qui servent en même temps à unifier et à séparer les différentes scènes. Au fur et à mesure que les relations entre les jeunes mariés se détériorent, la musique perd son caractère de valse et devient plus dissonante. Dans la dernière scène Kane et sa femme lisent leur journal sans s’adresser la parole. La musique, jouée dans les régis très aigus des violons, démasque les véritables sentiments de Kane: la valse si romantique se révèle n’avoir été qu’une variation en profondeur du thème de Kane.
Un des moments les plus mémorables de la partition de Bernard Herrmann est l’extrait d’opéra, intitulée «Salammbo», qu’il composa pour Susan Alexander Kane. Cette scène présenta des problèmes très particuliers à Herrmann. La musique devait 1) refléter le chaos des répétitions et des préparations avant l’entrée en scène de Susan, 2) suggérer l’angoisse de Susan et 3) montrer son insuffisance à chanter un grand opéra.
Herrmann, qui disposait de connaissances encyclopédiques dans le domaine de la musique, sentait qu’aucun des opéras existants pouvait remplir ces fonctions; il composa donc son propre extrait d’opéra. Le résultat est un curieux pastiche du style franco-orientaliste des années 1880 (dans le scénario original Mankiewicz et Welles avaient indiqué THAIS de Massenet) ; l’orchestration a été faite dans un style proche de Richard Strauss. Le texte, basé sur la scène de suicide de PHEDREN de Racine, est tout à fait à propos, si l’on pense à la tentative de suicide de Susan.
Pour l’air de «Salammbo», écrit dans une clé très aiguë, Herrmann engagea une chanteuse professionnelle, Jean Forward, qu’il fit chanter au dessus de son registre de voix naturel. L’orchestration écrasante créait le, senti ment «qu’elle s’enfonçait dans du sable mouvant». (1) La musique de Herrmann parvient admirablement à remplir les exigences décrites plus haut.
L’expérience de la radio

L’utilisation des différents motifs musicaux révèle une technique nettement inspirée par la radio («radio scoring»). Herrmann écrit: «Les films négligent fréquemment des occasions pour des points de repère musicaux ne durant que quelques secondes, c’est-à-dire de cinq à quinze minutes au plus; la cause en étant que l’oeil couvre habituellement cette transition. D’autre part, dans des pièces de radio chaque scène doit être reliée par quelque effet sonore, de manière à ce que même cinq secondes de musique deviennent un instrument vital à informer l’oreille que la scène change. Je sentais que dans ce film, où les contrastes photographiques sont souvent si abruptes, un bref motif – même deux ou trois accords – pouvait accroître énormément l’effet.»(2) Le thème de Kane est fréquemment utilisé de cette manière.
Une technique semblable qu’utilise Herrmann dans CITIZEN KANE, consiste à faire commencer une pièce musicale au milieu d’une scène pour préparer le spectateur à la scène suivante (souvent un flash-back). Ainsi dans la scène à l’«El Rancho» ou Thompson interroge Susan sur son mariage avec Kane. Un blues joué sur piano, qu’on entend à l’arrière-fond, se transforme soudainement en «Una voce poco fa» pendant la dernière phrase de Susan («Everything was his idea, except my leaving him.»); la chanson que chante précisément Susan dans le flash back qui suit. La musique fonctionne donc ici comme un fondu enchainé acoustique.
L’orchestration de la musique est loin d’être orthodoxe, une caractéristique qui allait distinguer toutes les partitions suivantes de Herrmann. Elle varie constamment à travers le film et fait rarement appel à un orchestre symphonique complet. Ainsi le thème de Kane est souvent joué sur des cuivres bouchés; dans la scène du Huntington Memorial Hospital (entretien Thompson – Leland) Herrmann utilise le son des cuivres bouchés et les vibrations d’un tambour pour créer une atmosphère de menace; un motif répété sur flûte précède et suit l’entretien Thompson Susan.
Il est intéressant aussi de noter que la musique n’est pas simplement superposée à la bande sonore, mais que musique et effets sonores se complètent mutuellement, Dans le «suicide montage» (montage de titres de journaux relatifs à la carrière de Susan et précédant sa tentative de suicide) un motif musical rythmique est combiné à des pistes sonores superposées de la voix de Susan pour créer un effet d’hystérie croissante.
Lors du réenregistrement de la musique sur la bande sonore, une autre convention de Hollywood a été basculée : «Trop souvent à Hollywood, le compositeur n’a rien à dire sur ce procédé technique; le résultat en est que certaines des meilleures musiques de films sont souvent assourdies à des niveaux presqu’inaudibles. Welles et moi sentions qu’une musique projetée comme arrière-plan atmosphérique devait être écrite originalement à cette fin, et non être baissée dans le studio de synchronisation. En d’autres mots, la dynamique de la musique dans le film devrait être projetée à l’avance, de manière à ce que la synchronisation finale ne soit qu’un simple procédé de transfert. Avec ses intentions nous passions deux semaines entières dans le studio de synchronisation, et la musique fut souvent réenregistrée – sous notre supervision – six à sept fois avant que le niveau dynamique correct ne fut atteint. Le résultat est une projection exacte des idées originales dans la musique.» (2)
La collaboration entre Herrmann et Welles était absolument unique à Hollywood. La plupart du temps, le compositeur collaborait avec le producteur (et souvent par l’intermédiaire du directeur musical). En plus, une idée reçue favorisée par les conditions pratiques des grands studios voulait qu’une musique de film soit écrite dans un style romantique et pour un orchestre symphonique, également hérité de la tradition romantique.
Herrmann bouleversa toutes ces règles; sa collaboration étroite avec Welles lui permettait d’écrire une partition tout à fait originale, qui rompait avec presque tout ce qui avait été écrit à Hollywood dans les années précédentes.
La musique de CITIZEN KANE, nous l’avons vu, constitue une véritable anthologie de ce que peut (et doit être la musique de film; non pas un commentaire musical super posé au plan visuel du film, mais une partie intégrante de la structure de l’oeuvre. Dans l’histoire du cinéma peu de partitions musicales ont pleinement atteint cet objectif. Parmi celles-ci la musique de CITIZEN KANE occupe une place de choix.
Notes
- Ted Gilling, The Colour of the Music (Interview avec Bernard Herrmann), dans: SIGHT AND SOUND Vol.41 No.1 (Hiver 1971/72), p.36 et 38
- Bernard Herrmann, Score for a Film, dans: NEW YORK TIMES du 25.5.1941
- Roy A. Fowler, Orson Welles: A First Biograph Londres 1946. Partiellement réédité dans : Ronald Gottesman, Focus on ‘Citizen Kane’, Englewood Cliffs N.J. 1971, p.91
- Orson Welles, cité par Roy A. Fowler, op. cit., p.92
- Christopher Palmer, ‘Citizen Kane’, RCA ARL1-0707
- Charles Higham, The Films of Orson Welles, Berkeley Cal. 1970, p. 15