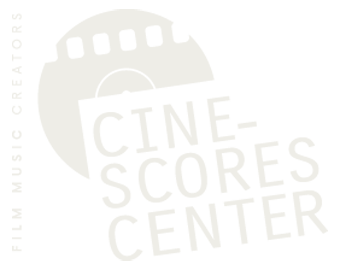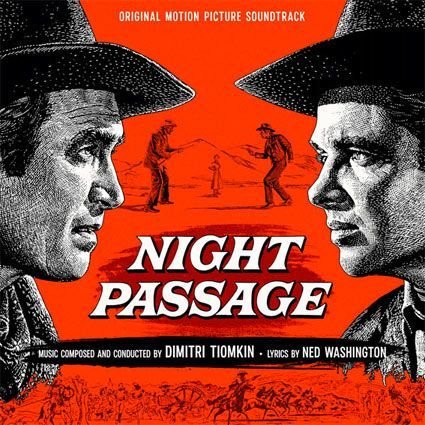King of Kings
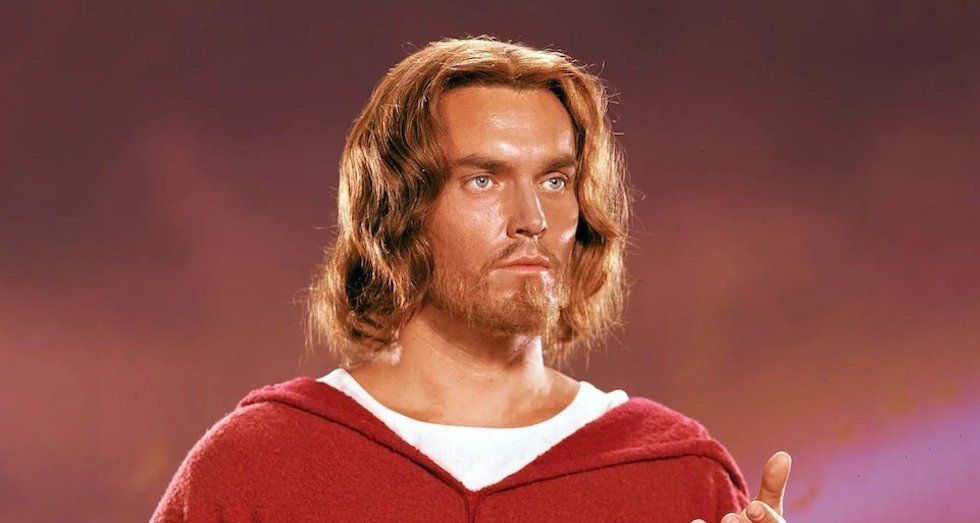
Remake du film homonyme réalisé par Cecil B. DeMille en 1927, ‘King of Kings’ (Le roi des rois), le film de Nicholas Ray est un classique dans le genre des péplums bibliques. Produit par la MGM et Samuel Bronston, ‘King of Kings’ est l’unique incursion du studio et du célèbre producteur hollywoodien dans le domaine du péplum biblique, le film n’ayant d’ailleurs jamais été récompensé d’une quelconque façon. L’histoire du Christ a été porté à de multiples reprises au cinéma, à tel point que l’on pouvait même se demander ce que ‘King of Kings’ allait bien pouvoir encore apporter à ce célèbre récit extrait du Nouveau Testament. Il faut dire que le genre du péplum biblique était particulièrement à la mode à la fin des années 50 et au début des années 60 à Hollywood, ‘King of Kings’ ayant sans aucun doute motivé la United Artists à produire quatre ans plus tard le somptueux ‘The Greatest Story Ever Told’ de George Stevens, qui reste à ce jour la plus belle adaptation cinématographique jamais réalisée à cette époque sur l’histoire de Jésus Christ. Il faut dire que le film est une exception dans la carrière de Nicholas Ray puisque ce dernier s’est spécialisé tout au long de sa vie dans les films noirs et n’avait encore jamais abordé un film épique de ce genre. On ne sait d’ailleurs pas trop ce qui a motivé le réalisateur a tourné ce remake du film homonyme de Cecil B. DeMille, le réalisateur s’en tirant moyennement avec une réalisation correcte mais un manque d’humilité, de profondeur et une série d’intrigues secondaires totalement inutiles. On ne comprend par exemple pas pourquoi Ray a tenu à développer le personnage de Barabbas en parallèle de l’histoire du Christ, le réalisateur prenant quelques libertés étranges et discutables par rapport au récit d’origine où il n’est question du voleur Barabbas (ici représenté comme le chef d’une armée de juifs rebelles contre les troupes romaines) que lors de la scène où le Christ est condamné par la foule qui demande de relâcher Barabbas. On ne comprend pas non plus pourquoi le réalisateur perd son temps sur le personnage de Salomé (Brigid Bazlen) ni même de Jean le Baptiste (incarné par l’excellent Robert Ryan), qui, bien qu’un personnage capital dans la première partie de l’histoire du Christ – il apparaît pour la première fois dans le film lors de la scène du baptême dans les eaux du Jourdain, avec le regard bleu perçant et radieux de Jeffrey Hunter, idée que George Stevens reprendra dans une scène similaire pour ‘The Greatest Story Ever Told’ – est curieusement un peu trop développé dans l’histoire, à tel point que l’on se demande parfois si l’on regarde un film sur la vie du Christ ou sur celle de Jean le Baptiste.
L’histoire reste quand à elle toujours la même, à savoir la naissance de Jésus dans l’étable avec les trois rois mages, en passant par la rencontre entre Jean le Baptiste (Robert Ryan) et Jésus (Jeffrey Hunter) dans les eaux du Jourdain, sans oublier la trahison de Judas (Rip Torn), la crucifixion et la résurrection. Mais à l’inverse de ‘The Greatest Story Ever Told’, ‘King of Kings’ accumule donc les artifices et nous propose une version un peu courte et estropiée du récit du Christ. Malgré sa longueur (2h48 environ), le film délaisse curieusement certains moments pourtant importants dans l’histoire du Christ comme la scène de la colère de Jésus dans le temple ou la condamnation du Christ par le peuple qui réclame sa crucifixion auprès de Ponce Pilate (à noter que les scènes avec les apôtres sont injustement réduites à leur tour au strict minimum!). Ces moments sont toujours suggérés et passés sous forme d’ellipses un brin maladroites. On peut penser que le réalisateur a du être contraint de faire de nombreuses coupures pour raccourcir la durée du film qui, s’il devait raconter l’intégralité de l’histoire, durerait 3 ou 4 heures de plus. Pourtant, les choix scénaristiques du réalisateur sur ‘King of Kings’ sont bien souvent des erreurs qui tendent à diminuer la qualité d’une grosse production biblique célèbre et pourtant pas si inspirée qu’elle n’y paraît. Par exemple, certains ont trouvés que Jeffrey Hunter manquait de passion et de profondeur dans le rôle de Jésus Christ, et qu’il aurait sans aucun doute été préférable de confier ce rôle à Robert Ryan, qui arrive véritablement à tirer son épingle du jeu dans le rôle de Jean le Baptiste. Alors que Max Von Sydow avait su offrir toute la chaleur humaine et la passion à son Christ dans ‘The Greatest Story Ever Told’, Jeffrey Hunter campe un Jésus mollasson baignant dans une mise en scène académique et finalement peu inspirée. Le comble reste sans aucun doute les quelques scènes d’action belliqueuses qui viennent pimenter le film en faisant perdre toute crédibilité au récit d’un individu qui parle pourtant de paix et d’amour entre les hommes. On se demande par exemple quelle était l’utilité de la scène où les soldats romains écrasent les partisans rebelles de Barabas devant les portes du temple de Jérusalem vers la fin du film, alors qu’il aurait été préférable de montrer à ce moment là la fameuse colère de Jésus contre les marchants du temple, curieusement passée sous silence dans le film. Idem pour la scène de l’embuscade de Barabbas vers le début du film, avec une scène d’affrontement entre le voleur et un légionnaire romain à peine digne d’une série-B d’action hollywoodienne. Une fois encore, que vient faire là cette scène? Qu’apporte t’elle vraiment au récit? Pourquoi ne pas privilégier le Christ lui-même au lieu de perdre systématiquement une bonne dizaine de minutes à chaque fois sur d’autres personnages secondaires dont on se fout royalement dans le contexte de l’histoire de Jésus Christ, d’autant que ces scènes viennent souvent parasiter celles du Christ et de ses précieux enseignements d’amour et de paix (où est la cohérence scénaristique dans tout cela?). On s’imagine donc sans mal les producteurs demander à Nicholas Ray de leur offrir un nouveau ‘El Cid’ version biblique, une vraie trahison par rapport à l’histoire d’origine du Nouveau Testament, et aussi par rapport au talent de Nicholas Ray, qui accouche ici d’un film académique, bancal et totalement dépourvu de personnalité! Du coup, on se demande comment le film a put obtenir son statut de classique au fil du temps, alors que dans le même genre ‘The Greatest Story Ever Told’ montrait l’histoire du Christ sous sa vraie nature, sans artifice ni gros effets de mise en scène hollywoodienne. Il manque à ‘King of Kings’ une certaine profondeur, une certaine intensité et surtout une véritable passion dans le récit du Christ. Il ne paraît donc pas injuste de penser que ce film est une sorte de ‘corruption’ hollywoodienne de l’histoire du Nouveau Testament, une erreur qui sera vite corrigée quatre ans plus tard avec le chef-d’oeuvre de George Stevens!
Si le film est en lui-même particulièrement décevant, il n’en est absolument pas de même pour la partition symphonique/chorale de Miklos Rozsa, sans aucun doute l’un des grands chef-d’oeuvre du compositeur qui, en 1961, était plus que jamais au sommet de son art lorsqu’il signa la musique du film de Nicholas Ray. Evidemment, à l’instar du film, Rozsa a choisi de faire dans le massif et le spectaculaire en nous offrant une grande fresque symphonique démesurée et passionnante, un score qui évoque la puissance de l’histoire du Christ à travers une série de thèmes inspirés et mémorables. Ce sont d’ailleurs par la qualité et le nombre impressionnant de thèmes que le score de Rozsa s’impose littéralement au fil des écoutes dans l’esprit de l’auditeur, créant un impact majeur autant à l’écoute que sur les images du film de Nicholas Ray. Introduit par des cuivres amples et des cloches, le ‘Prelude’ accompagne ainsi le générique de début sur le ton de l’épique, de la grandeur et de la majestuosité en dévoilant l’inoubliable thème principal associé au Christ. Thème triomphant et royal, le leitmotiv associé à Jésus Christ est confié à des cuivres massifs sur fond de choeurs grandioses qui renforcent ce sentiment épique de grandeur. Aucun doute possible, le spectaculaire thème principal, qui marque irrémédiablement les esprits même après une première écoute, annonce une énorme partition symphonique grandiose et inspirée, que l’on peut déjà considérer comme un grand classique dès sa magnifique ouverture! Après le côté spectaculaire de ce superbe ‘Prelude’, Rozsa continue à faire dans le massif avec ‘Roman Legions’ et son thème de marche pompeux associé aux légions romaines au début du film, lors de l’arrivée de Pompée à Jérusalem. On retrouve ici le Rozsa des musiques traditionnelles de péplum comme ‘Ben-Hur’, ‘Quo Vadis’ ou ‘Julius Caesar’, un genre qui paraît aujourd’hui un peu daté mais qui passe pourtant magnifiquement bien dans le contexte de ‘King of Kings’. A noter que le thème réapparaît de façon sombre et menaçante dans ‘The Elders/Sanctuary’ lorsque Pompée ravage le sanctuaire au début du film, atmosphère sombre qui se poursuit dans ‘The Scrolls/Subjuguation’ qui développe au passage un nouveau thème d’ambiance hébraïque associé à Jérusalem, malmené ici par des orchestrations rythmées navigant entre cordes pesantes et cuivres graves illustrant la brutalité des romains. ‘Road to Bethlehem/The Nativity’ s’impose quand à lui avec une ambiance plus adoucie en annonçant le très beau thème associé à Marie lors de la scène de la nativité, joué ici par des violoncelles. Le thème de la nativité se veut quand à lui féerique et empreint d’une magie pleine d’innocence et de joie, avec sa très belle mélodie gracieuse sur fond de choeurs féminins et d’un orchestre ample sur un rythme de sicilienne, le tout rythmé sur fond de cloches, de cordes, de vents et carillon, avec un côté légèrement impressionniste dans la façon dont Rozsa utilise ses différentes couleurs instrumentales. A contrario, on appréciera l’incroyable brutalité orchestrale de la scène du massacre des enfants dans ‘The Slaughter of Innocents’ et ses variantes assombries du thème hébraïque, qui rappelle à quel point Rozsa a toujours été un grand maître des musiques d’action et des déchaînements orchestraux.
L’atout majeur de ‘King of Kings’ est de développer cette alternance systématique entre passages lyriques, doux et émouvants et déchaînements orchestraux en règle dans un style plus massif et véritablement ‘péplum’. Ainsi, après la brutalité de ‘The Slaughter of Innocents’, on ne peut qu’apprécier la douceur réconfortante de ‘Joseph and Marie’ avec sa très belle reprise du thème de Marie par un hautbois sur fond de cordes, harpe et vents. Suivant sa logique de l’alternance douceur et brutalité, Rozsa nous offre tout de suite après l’apaisé ‘Joseph and Marie’ une nouvelle marche romaine tonitruante pour ‘Pontius Pilate’s Arrival’ qui évoque massivement l’arrivée du nouveau commandeur romain Ponce Pilate à Jérusalem à grand renfort de tambours et de cuivres agressifs sur fond de rythmes martiaux (on retrouvera ce thème dans les passages plus agités du reste de la partition). Impossible alors de passer à côté du superbe ‘Revolt/Barabbas’s Escape’ pour ce qui reste incontestablement l’un des meilleurs morceaux d’action du score de ‘King of Kings’, illustrant la séquence où Barabbas et ses hommes tendent une embuscade aux romains. Le thème de Ponce Pilate, développé dans un premier temps, s’envole par la suite pour un nouveau déchaînement orchestral excitant où Rozsa développe continuellement un motif d’action sur fond de percussions brutales et de cuivres virtuoses. On reconnaît d’ailleurs bien là ce souci toujours constant chez Rozsa du contrepoint et des développements thématiques et motiviques totalement indissociables de son style, preuve d’un immense savoir-faire et d’une écriture orchestrale remarquable, qui ont de Miklos Rozsa un grand nom du ‘Golden Age’ hollywoodien. Si vous adorez les musiques d’action massives, virtuoses et totalement frénétiques, les 4 minutes 44 de ‘Revolt/Barabbas’ Escape’ sont donc faites pour vous! A l’écoute d’une musique aussi agressive et frénétique, difficile de croire que l’on écoute la musique d’un film sur l’histoire du Christ, mais quelle efficacité, quel impact dans le film!
‘John the Baptist’ développe quand à lui un nouveau leitmotiv associé cette fois-ci à Jean le Baptiste, thème de cordes jouées tout en quintes parallèles dans une ambiance plus rustique et moyenâgeuse, thème juxtaposé tout au long du morceau à un autre motif plus sombre aux sonorités vaguement orientales évoquant la menace des romains à Jérusalem et aux alentours, menace qui pèse sur Jean le Baptiste alors qu’il ne cesse d’attiser les foules et de proclamer la venue du Messie. Ce thème en quintes parallèles est repris dans ‘Baptism of Christ/Sadness and Joy’ pour la scène où Jean baptise Jésus dans les eaux du Jourdain. Depuis le ‘Prelude’, c’est la première fois où l’on réentend à nouveau le magnifique thème du Christ, exposé ici de façon plus douce et quasi féerique avec ses cordes en trémolos, ses vents, son vibraphone et ses choeurs féminins symbolisant la pureté paisible et mythique du personnage, suivi d’une nouvelle reprise du thème de Marie confié à un violoncelle mélancolique du plus bel effet pour le très beau ‘Sadness and Joy’. On entre alors dans la scène où le Christ se fait tenter par le diable dans le désert avec ‘The Last Temptation of Christ’, un morceau particulièrement sombre et un peu à part puisqu’il possède la particularité d’avoir été écrit à partir d’une série dodécaphonique (de 12 sons) suivant la théorie sérielle instaurée au début du 20ème siècle par Arnold Schoenberg. La noirceur du morceau permet alors à Rozsa de reprendre le thème du Christ dans une version minorisée qui évoque les tourments de Jésus lors de sa traversée du désert, tandis que la partie associée aux diables recèle un vrai petit bijou de recherche sonore et d’instrumentation avec des clarinettes grimpantes exposant la série de 12 sons sur fond de nuage sonore plus chaotique, et un motif menaçant de 5 notes associé au diable. C’est bien la première fois que Rozsa se laisse ‘tenter’ par une écriture plus avant-gardiste et atonal, lui qui a toujours été très proche tout au long de sa carrière du style romantique et postromantique allemand de la fin du 19ème siècle, preuve que, décidément, le compositeur était plus que jamais au sommet de son inspiration et de son art lorsqu’il écrivit la partition de ‘King of Kings’. Il confère en tout cas à cette scène une dimension quasi angoissante et torturée du plus bel effet, une approche musicale viscérale qui hante cette séquence et qui reste un autre morceau incontournable de la partition! Le thème du Christ réapparaît de manière plus triomphante à la fin du morceau, évoquant la grandeur d’âme et la puissance du personnage, qui a réussi à surmonter cette terrible épreuve et à mettre en échec Satan dans le désert. Dès lors, le thème du Christ, repris dans ‘The Chosen’ et le magnifique ‘Miracles’ (scène des miracles amplifiée par des choeurs magnifiques) restera omniprésent tout au long du film, alternant avec les nombreux autres thèmes avec, comme toujours, cette même fougue orchestrale.
Les traditionnels morceaux de fausse ‘source music’ sont quand à eux toujours présents, comme en témoigne la danse orientale un brin stéréotypée de ‘Herod’s Feast’ pour la scène du festin d’Herod, ‘Jugglers and Tumblers/Herod’s Desire’ pour une scène similaire, sans oublier la fameuse danse de Salomé dans ‘Salome’s Dance’, superbe danse orientale frénétique qui rappelle inévitablement la danse de l’opéra ‘Salomé’ de Richard Strauss. Ces morceaux restent bien évidemment fonctionnels et n’ont pas beaucoup de poids par rapport aux autres morceaux du score, comme la magnifique reprise apaisante du thème du Christ dans le fiévreux ‘Cast out the Demon’ (scène où Jésus chasse le démon du corps d’un homme possédé) ou l’imposant ‘Mount Galilee/Sermon on the Mount/Love Your Neighbor’ illustrant la scène du sermon du Christ sur la montagne. C’est dans ce très long morceau (près de 8 minutes) que Rozsa développe un nouveau thème particulièrement magnifique, que l’on pourra qualifier de thème de Dieu ou thème de la foi, lorsque Jésus évoque le royaume de Dieu et dispense son message de paix et d’amour envers son prochain. A noter que la version de ce morceau sur le CD est quand différente, la version film de cette séquence correspondant en réalité au début de la pièce ‘Overture’ au tout début du premier disque, avec ses choeurs grandioses et ses cloches en ouverture. Le thème de Dieu est développé dans le magnifique ‘The Lord’s Prayer’ où il s’apparente à une mélodie de style choral protestant avec un certain classicisme d’écriture et des choeurs grandioses et émouvants. On se rapproche alors imperturbablement de la dernière partie du film qui s’assombrit considérablement. Ainsi, un morceau comme ‘The Disciples’ est très représentatif de ce changement d’ambiance. Après une première partie pleine d’espoir avec une mélodie de cordes gracieuse associée aux disciples du Christ (et par la suite en contrepoint au thème de Jésus aux violoncelles), la seconde partie navigue entre inquiétude et espoir, Rozsa nous annonçant clairement ce qui va suivre. Ainsi, ‘Barabbas’s Plan’ développe le thème de Barabbas de façon sombre et menaçante alors que le voleur prépare ses plans d’insurrection contre les romains, tandis que ‘Jesus Enters Jerusalem’ accompagne la scène de l’entrée du Christ dans le temple de Jérusalem suivit de la scène où la rébellion de Barabbas est écrasée et que le chef des rebelles juifs est arrêté par les romains (il s’agit du plus long morceau de tout l’album, la pièce avoisinant ici les 14 minutes). Si la première partie se veut plus festive et cérémoniale, la seconde partie est nettement plus sombre et brutale avec un nouveau déchaînement orchestral du plus bel effet. Le morceau se conclut sur la scène du célèbre dernier souper du Christ, la cène, accompagnée dans ‘The Last Supper’ de façon très minimaliste par un choeur a cappella à l’unisson, Rozsa ayant ainsi opté pour une approche plus sobre et dénudée pour cette fameuse scène en délaissant temporairement la grosse artillerie lourde. La noirceur de ‘Judas Sees Caiphas/Gethsemane’ évoque clairement l’issue dramatique du film avec la trahison de Judas tandis que l’arrestation de Jésus dans ‘Agony in the Garden/Judas’ Kiss’ nous permet de retrouver la version assombrie et minorisée du thème du Christ telle qu’on avait déjà pu l’entendre dans le très sombre ‘The Last Temptation of Christ’, suivi ici du très beau thème de Dieu qui évoque la foi imperturbable de Jésus en son père, et ce même aux moments les plus sombres de son existence. La tension monte inévitablement dans le brutal ‘The Scourging of Christ/Crown of Throns’ lorsque les romains torturent Jésus, débouchant sur le dramatique ‘Via Doi Orosa/Christ Bearing his Cross’ lorsque le Christ porte sa croix. La scène est entièrement illustrée pendant plus de 9 minutes par des cordes graves particulièrement pesantes et tourmentées, évoquant à merveille le calvaire de Jésus et sa souffrance, le thème de Ponce Pilate restant toujours très présent comme pour rappeler qu’il fut l’un des responsables de sa condamnation. La scène sur la croix reste dans le même ordre d’idée, extrêmement sombre et funèbre suivi d’un morceau plus radieux et triomphant pour la scène de la résurrection, avec une nouvelle très belle reprise du thème du Christ amplifié ici par l’inévitable ‘Hosanna’, chant religieux de joie et de gloire interprété ici par une chorale grandiose pour l’ascension du Christ dans les cieux (suggérée habilement dans le film par un effet d’ombre sur une plage au bord de la mer), idéal pour conclure cette partition en beauté, avant un ‘Epilogue’ magnifique reprenant le thème de Dieu dans toute sa grandeur et sa magnificence.
Vous l’aurez très certainement compris, ‘King of Kings’ est un véritable monument musical dédiée à l’immortel histoire de Jésus Christ extraite du Nouveau Testament. Miklos Rozsa a donc opté, à l’instar des concepteurs du film, pour une approche épique et massive du plus bel effet, qui réussit à merveille à la superproduction de Nicholas Ray, apportant une grandeur et une magie incontestable aux images du film. Loin de faire dans la subtilité et la retenue, Rozsa nous rappelle qu’il est décidément un spécialiste des musiques de péplum et des grandes fresques symphoniques épiques et démesurées. Maniant de nombreux thèmes avec une aisance rarement égalée, des orchestrations somptueuses et un souci constant du contrepoint et d’une écriture orchestrale toujours très soutenue, Rozsa nous livre un véritable chef-d’oeuvre de la musique de film, un score gigantesque et 100% épique qui ne peut laisser indifférent, tant sa puissance et sa grandeur égale à merveille celle de l’histoire du Christ. Quelques années après l’immense ‘Ben-Hur’, Miklos Rozsa confirmait qu’il était décidément l’un des maîtres incontesté du ‘Golden Age’ hollywoodien en nous offrant un nouvel opus symphonique/choral totalement inspiré, dans lequel le compositeur manie les ambiances et les différentes idées musicales (contrepoint très soutenu, nombreux thèmes et développements, richesse d’orchestration, intervention d’une série dodécaphonique pour la scène du désert, choeurs religieux pour la cène et le final, etc.) avec une maestria exemplaire. Si ‘Ben-Hur’ vous avait déjà captivé, ruez-vous d’urgence sur ‘King of Kings’, qui s’avère être encore bien plus spectaculaire et efficace. Les chef-d’oeuvres de la musique de film sont rares, mais cette partition en fait définitivement partie!