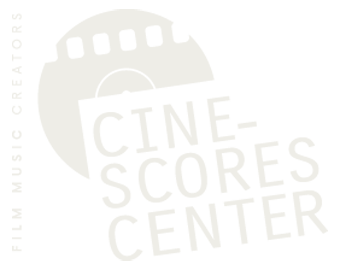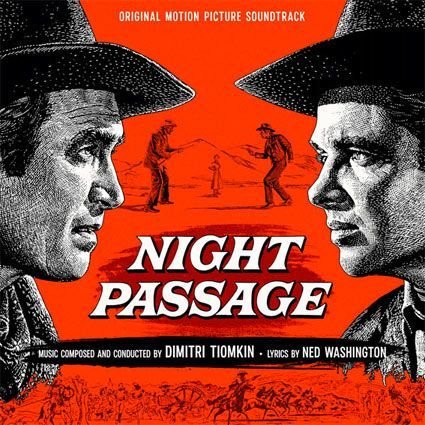Bernard Herrmann

Introduction
Dans Le son de Hollywood, documentaire diffusé déjà plusieurs fois à la télévision, le chef d'orchestre John Mauceri parle de ses années d'apprentissage et reconnaît que pour convenir à l'air du temps, il se voulut arnateur, sinon expert, en musique moderne: sérialisme, atonalisme, recherches acoustiques... Jusqu'au jour où il s'avisa que, décidément, cela n'était pas sa voie. Pour la raison que ce qui lui plaisait, c'était la mélancolie, une musique qui chante et non qui pense, une musique romantique à souhait.
Examinant cette inclination d'un peu plus près, il se rendit compte que ce que le siècle précédent avait conçu, et si somptueusement exprimé, ne s'était pas éteint avec lui: qu'en matière de musique, le romantisme était parvenu à survivre sous des formes diverses, à la faveur de circonstances propices, presque tout au long de ce XXème siècle et en particulier dans le contexte de la musique commandée par les studios hollywoodiens au cours de cette période faste s'étendant, disons, de 1930 à 1970.
Ainsi, à la tête de l'Hollywood Bowl, John Mauceri eut la bonne idée d'enregistrer quelques flamboyantes compilations des musiques de l'Âge d'Or associées à des cuivres classiques, mettant ainsi en évidence les correspondances existant entre ces deux domaines voisins mais s'ignorant encore trop souvent. Réticences que le jeune chef dénonce, non sans malice, quand il signale que, dirigeant une formation européenne, il lui arrive parfois de repérer un instrumentiste affichant, au coin des lèvres, une moue de dédain, un petit sourire supérieur à destination de cette musique trop facile pour être de qualité, trop flatteuse pour répondre aux attentes d'un public cultivé. Jusqu'au jour où, dépassant les préjugés de toutes sortes, l'avenir saura garantir renommée à tout ce qui la mérite.
Nul doute que dans cette perspective, l'oeuvre de Bernard Herrmann ne continue à recevoir son dû. La petite contribution qui va suivre se propose d'aborder le travail du musicien non d'un point de vue chronologique, mais par le biais des grands thèmes qui s'y déploient et en assurent la cohésion et la singularité.
Le Romantique
L'esprit romantique prédispose à la mélancolie; c'est l'un des traits de caractère dont se souviennent les potaches même s'ils ont, par ailleurs, tout oublié de leur passage au lycée. Mélancolie omniprésente dans toutes les partitions du compositeur, qu'elles aient été écrites pour le cinéma ou pour le concert. Il n'est, pour s'en convaincre, que de passer en revue les titres donnés aux diverses sections figurant sur les plus récents enregistrements: solitude, chagrin, élégie, désespoir, adieux, consolation. Même la « Poésie », comme dans l'AVENTURE DE MADAME MUIR joint son chant profond mais plaintif à tant de mélopées imprégnées de merveilleux et de mystère. Sans omettre ces danses qui sont valses tristes ou lentes allant même jusqu'à revendiquer leur place au sein d'une intrigue où l'on ne s'attend guère à les trouver: celle de MAIS... QUI A TUÉ HARRY ? Une partition dont Hermann s'est servi pour agencer une petite suite d'orchestre bien sentie intitulée 'un portrait de Hitch', croquis exécuté par petites touches comme ce récit qui mêle l'humour et le macabre et dut stimuler le musicien. La valse essaie des pas timides, un peu guindés; le cinéaste déplace ses personnages avec une rare maîtrise. Il y a là, déjà, l'expression d'une fatalité qui se fera plus tragique dans quelques prochains films.
De tous, SUEURS FROIDES est le plus célèbre, peut-être parce que le plus réussi. Histoire de dédoublements et de sosies, d'attraction et de répulsion, d'idées fixes et de fantasmes; de confusion entre le passé et le présent, le réel et l'imaginaire. De manière assez paradoxale, la musique, souvent furtive, est le contrepoint approprié à cette dramaturgie qui ne manque jamais de faire sur le spectateur une curieuse impression. Enveloppant les images et le récit dans une atmosphère de surnaturel, la partition fait entrer un peu de tendresse dans le monde clos des troubles mentaux, d'une vertigineuse schizophrénie. Et le tout, obtenu par les procédés les plus délicats, bien dans le style de ce qu'il est convenu d'appeler « the french touch», la tradition française.
Ainsi en va-t-il du thème de Madeleine marquéLento amoroso par le compositeur lui-même et suggérant, avec tout le talent que l'on connaît à Herrmann, mystère, fantaisie, romance et tristesse. Motif s'offrant à des variations assourdies où, en d'autres lieux étranges telle cette forêt de séquoias à la beauté sépulcrale, il recourt à des tonalités très changeantes afin de souligner les pensées de cette jeune femme revenant sans cesse sur la frontière incertaine et mouvante séparant le monde des vivants et celui des morts (D'entre les morts: titre du roman de Boileau-Narcejac d'où le film est tiré). Perception ambiguë, sentiment très amer pris en charge à nouveau par ce love theme, tout d'ardeur contenue et qui a été souvent comparé à cet autre motif connu sous le nom de Liebestod - Amour / Mort, présent dans l'opéra de Richard Wagner TRISTAN UND ISOLDE.
Dans un autre registre, du moins en ce qui concerne le cadre antique où le scénario entrelace ses intrigues, l'EGYPTIEN est une partition bicéphale due moitié au travail d'Herrmann, moitié à celui de son confrère et ami Alfred Newman. La musique peaufine cette fois le portrait d'un héros désabusé. Qu'il s'agisse de la douleur d'un amour non partagé que confie ce poignant narratif pour orchestre dédié à Mérit, fidèle servante; ou qu'il en aille de cette consternante passion liant Sinouhé à la courtisane Néfer, c'est toujours la même déconvenue, le même accablement qu’interprètent des cordes langoureuses et des haut-bois plaintifs ne cachant rien d'un avenir qui va bientôt déchanter. Les reproches adressés à ce futur sont soulignés avec insistance par des séries d'accords se répétant sans relâche, comme pour emporter ' plus profond la spirale de la frustration. Jusqu'au thème de l'enfance que reprennent des bois désespérés, le confinant ainsi dans l'isolement et l'affliction. Ce qui est bien la tonalité dans laquelle se clôt le film et le livre:"I desire no offerings at my tomb and no immortality for my name. This was written by Sinuhé, the Egyptian, who lived alone all the days of his life". (Mika Waltari).
Deux scores sont imprégnés de mélancolie, voire de nostalgie: CITIZEN KANE et ce quintette pour clarinette intitulé SOUVENIRS DE VOYAGE. Dans le film d'Orson Welles, chacun se souvient du nom que prononce le milliardaire en mourant: Rosebud. Mais le cinéaste laisse le spectateur dans l'ignorance de ce qu'il signifie exactement et c'est Herrmann, par sa musique, qui va le mettre dans la confidence. Non seulement il introduit le motif Rosebud dès le Prélude, mais en bien d'autres occasions tout au long du récit: de la première apparition de Kane enfant à l'ultime image où la luge, portant ce nom, est la proie des flammes. La musique l'avait bien dit dès le début: Rosebud, c'est le souvenir d'une période de bonheur, de simplicité et d'innocence; joyeux temps qui s'en est allé et ne reviendra plus.

Car la mémoire et ses productions occupent une place de choix dans l'oeuvre du musicien, comme c'est le cas dans ce quintette où la clarinette est reine: Pièce dont le romantisme et les timbres sont considérablement plus chauds que dans bien d'autres partitions. Les trois mouvements tirent leur substance de trois sources artistiques différentes. Le premier brosse un vaste panorama en y restaurant d'antiques reliefs; le deuxième est un coucher de soleil sur la côte irlandaise que magnifient de superbes nuances automnales; quant au dernier, il a la transparence d'une aquarelle vénitienne en attendant que la nuit enveloppe tout l'espace dans une solitude bienfaisante.
C'est alors que la nostalgie quitte la terre ferme, appelle la mer, aspire au grand large du rêve et de la fantasmagorie. Histoires de marins volontaires, de beaux capitaines, de sympathiques fantômes; et de navires perdus, de rivages lointains, d'îles enchantées. L'AVENTURE DE MADAME MUIR demeura l'une des partitions préférées du compositeur et, pour beaucoup, elle restera comme l'une de ses plus attachantes. Dès le prélude qui combine la plupart des thèmes que le film donne à entendre, des cloches solennelles déploient un paysage maritime à la manière de Debussy et contrastent avec l'évocation subtile d'un désir en peine, rappel incessant du temps qui passe et laisse l'attente inassouvie. L'insatisfaction est le lot de Lucy Muir et lors de la visite d'Anna, sa soeur, c'est un canon très élégiaque suggérant la présence du capitaine qui suscite en chacune le souvenir d'une perte irréparable. Le lyrisme est partout présent et le rêve se fait pure poésie: les cordes entonnent un chant serein, mais triste en certaines nuances, et les bois effrangent cette délicate broderie, rosée pour un matin diaphane qui frémit sous le toucher d'un artiste très capable.
Le rêve est la réplique à un désarroi cruel, un désenchantement certain. Un monde gris et morne, un univers oppressant, une société murée comme celle du RIDEAU DÉCHIRÉ qui décrit la vie derrière le rideau de fer en quelques phrases saisissantes. Âpre et sans émotion, la musique se voulait, pour ce film, tendue à l'extrême par ces répétitions et ces inversions aptes à engendrer un sentiment de malaise, de nausée. Existence sinistre, bien traduite par une série de quatre accords (parfois entendus comme seulement quatre notes) et qui, d'ailleurs, clôt la partition avec beaucoup de doigté. Un autre monde, une société plus inquiétante encore est celle de FAHRENHEIT 451, puisqu'il s'agit là d'une contrée où les pompiers sont appelés non pour éteindre le feu mais pour brûler les livres. Écrit pour cordes, harpes et percussions, le score se remarque par des rythmes implacables évacuant toute espèce d'émotions et par un chromatisme (mélange de tonalités) qui induit une forte impression d'inhumanité.
Passe encore que le monde soit à l'origine de ce désappointement; le pire n'est-il pas de le trouver en soi-même ? ECHOES est l'unique quatuor à cordes du musicien et la première pièce de concert après quatorze années de silence en ce domaine: L'oeuvre, secrète et tourmentée, est une série de variations nostalgiques et parfois énigmatiques, associant quelques recherches inédites à des citations de partitions anciennes revenant ici comme une obsession. PSYCHOSE marque de son empreinte tout le début de l'allegro, cette ouverture où les violons pleurent, comme dans SUEURS FROIDES. Une même simplicité d'expression règle une valse lente, une barcarolle lyrique et une habanera bien trempée faisant d'autant plus ressortir la morosité du présent. Pour citer Christopher Palmer, musicologue et grand ami du compositeur: « Some episodes deliberately seem to impart no feeling at all... a state of mind in which the nerves have ceased to vibrate ». Ainsi, les sombres sonorités de l'alto et du violoncelle finissent-elles englouties par une solitude glaciale et déchirante. La mélancolie, en sa phase aiguë dégrade l'image de soi; celle qu'Herrmann pouvait, à cette époque, se faire de lui même ainsi qu'il le confia à son épouse d'alors, Lucille Fletcher, peu de temps avant leur séparation: "More and more, I feel I am not possessed of any great talent. It is, perharps, an echo of a talent... never the real voice".
Et cependant, d'un bout à l'autre de ce quatuor, c'est bien une même subjectivité qui s'exprime sans fards et sans excès parce que c'est du plus intime que parle cette voix. Ce n'est plus une confidence, c'est une confession; et comment alors ne pas penser à cet autre maître du romantisme en musique que fut Hector Berlioz et qui, bien dans l'esprit de ce courant artistique, a toujours voulu ôter toute entrave à l'expression de sentiments francs et nobles. Ainsi, Berlioz compose-t-il sa SYMPHONIE FANTASTIQUE comme une déclaration d'amour à la belle actrice anglaise Harriet Smithson; oeuvre exubérante, biographie musicale presque impudique parce que tel est le génie de ce Romantisme qu'Herrmann et quelques autres ont su préserver durant le siècle qui vient de s'achever, y semant les graines d'une renaissance possible.
Le Novateur
Herrmann, compositeur old-fashioned/vieille manière, ainsi que cela fut prétendu et dit à l'orée des années soixante-dix du fait de son attachement à la forme classique. Quelques synthétiseurs coûtant moins cher que la location d'une phalange symphonique toute entière. Mais de la modernité, Herrmann se fit toujours une autre idée, lui qui sut enrichir son univers musical en explorant d'autres voies que l'héritage académique occidental. Digne disciple en cela des Bartok, de Falla et Vaughan Williams. C'est, dans les films de Welles, le recours fréquent au folklore de son pays natal inspirant des pièces désormais connues sous le nom d'americana; c'est l'intégration dans ses propres ouvrages des codes en vigueur dans de lointains pays comme cette échelle pentatonique javanaise et toutes les couleurs orchestrales propres à un exotisme qui sublime ses sources plutôt que de les plagier. Ceci est certes un bon point en faveur du musicien et de sa fibre novatrice, mais ce n'est pas le seul. Un autre, encore plus déterminant, est l'essai abouti, non d'une nouvelle syntaxe, mais d'un nouveau mode de composition mis au service d'un sens dramatique aigu et d'une fine psychologie. Approche singulière reposant sur l'emploi et la récurrence de motifs très courts qui font d'Herrmann l'un des précurseurs du minimalisme.
Ainsi en va-t-il avec ce motif de cinq notes qui est celui du meurtre dans LE RIDEAU DÉCHIRÉ que les cors habillent de toute la violence et la férocité requises, et qu'Herrmann réutilisera comme cri de guerre dans LA BATAILLE DE LA NERETVA quelques années plus tard. Ailleurs, ce sont de simples triades de notes claires très adéquates dans les films fantastiques et leurs inlassables reproductions ayant pour effet de concentrer l'efficacité de la musique sur les timbres, au lieu d'attirer l'attention de l'auditeur / spectateur par d'envoûtantes mélodies ou de l'épater par de savantes textures harmoniques ou contrapuntiques.
Dans le même ordre d'idées, l'angoissante coda accompagnant Norman Bates incarcéré est basé sur ce qu'Herrmann appelle "le vrai motif de PSYCHOSE", une signature de trois notes, de folie et de désolation, issue de la SINFONIETTA FOR STRINGS datant de 1935 et présente également dans le finale de MOBY DICK ainsi que la conclusion de TAXI DRIVER. Mais concision qui ne fait nullement tache sur la complexité de l'architecture musicale comme on peut en juger d'après ce que proposent certains préludes. Trois d'entre eux suffiront à plaider la cause d'un musicien qui n'avait nul besoin d'un temps indéfini pour faire les présentations. Ainsi, le générique de PSYCHOSE, marquéallegro / molto agitato comprend-il six sections de musique dont trois motifs majeurs et une mélodie. Le tout pour une minute et cinquante cinq secondes selon le tempo retenu par Joël Mc Neely et le Royal Scottish National Orchestra. Un autre prélude, celui de JASON ET LES ARGONAUTES requérant un orchestre au grand complet, introduit, dans sa courte durée, les trois principaux motifs associés à l'Argo, le splendide vaisseau et à son équipage. En surplomb d'un rythme de galérien scandé par les timbales, le thème central est donné à l'unisson par les cors. Une autre idée est une figure descendante / ascendante pour tubas et bassons conduisant à un troisième moment: une fanfare miniature pour trompettes et trombones. Les trois thèmes sont présentés une seconde fois et la pièce s'achève dans la tonalité éclatante de do majeur. L'ensemble pour une minute et cinquante quatre secondes, sous la baguette de Bruce Broughton à la tête du Sinfonia of London.
Enfin, avec MAIS... QUI A TUÉ HARRY ? où les cadavres provoquent plus l'envie de sourire que de pleurer, l'histoire est parfaitement mise en relief par l'exposition, dès le générique, de quatre thèmes dont le premier est une phrase en forme de question jouée aux cuivres et ayant l'allure d'un grand lied telle "une arche, à l'image du film qui se termine par ou il a commencé" pour citer Jean-Pierre Eugène dans un récent et excellent travail sur « La musique dans les films d 'Alfred Hitchcock » (Dreamland éditeur / Paris).
Ainsi Herrmann et ses amis se donnaient-ils là les moyens de répondre à l'arrogance de ces érudits ayant le front d'affirmer qu'il était impossible d'écrire une bonne musique de film parce qu'il était absurde de penser qu'un compositeur pouvait être inspiré pour quelques minutes et une poignée de secondes, tout au plus ! D'après ce qu'en rapporte Miklos Rozsa, lors d'un débat houleux sur ce thème.

Mais le goût de l'expérimentation chez Bernard Herrmann ne s'arrête pas là. Tout un autre domaine, largement exploré par le musicien est celui de la couleur orchestrale, c'est-à dire de la recherche sur les timbres se traduisant, en premier lieu, par de très originales combinaisons d'instruments dont certains sont même fort curieux. Nul amateur digne de ce nom n'ignore que la partition de TEMPÊTE SOUS LA MER / BENEATH THE TWELVE MILE REEF (le titre américain est peut-être mieux connu...) est très exactement un concerto pour neuf harpes et grande formation incluant orgue d'église, le tout brossant une série de tableaux maritimes, galerie magnifique que peuvent envier pas mal de film d'aventure. Dans le même genre, LA SORCIÈRE BLANCHE met la jungle en poème symphonique tout bardé de tam-tams et de tambours de tailles très diverses, de formes variées, jusqu'au tambour de frein d'un gros véhicule de marque Volkswagen; le constructeur automobile n'y étant sans doute pour rien. Quant à la séquence la chasse à mort / Death hunt dans LA MAISON DE L'OMBRE / ON DANGEROUS GROUND, elle a pour protagonistes musicaux huit cors qui jappent et aboient tels des chiens à la poursuite de leur proie.
A titre individuel, apparaissent ici et là une enclume (comme c'est le cas également du Rozsa des QUATRE PLUMES BLANCHES), un tuba bouché et un serpent obsolète, cuivre à méandres résonnant comme un basson enroué. L'harmonica joue le rôle d'un motocycliste psychopathe dans NIGHT DIGGER; la viole d'amour chante sa complainte comme elle le fit déjà dans LA MAISON DE L'OMBRE, film au générique duquel le nom de la virtuose, Virginia Majewski, figure sur le même carton que celui du compositeur, à sa propre demande. Instrument qui sait ajouter ses teintes désuètes a quelques épisodes mélancoliques de la célèbre série télévisée: LA QUATRIÈME DIMENSION / THE TWILIGHT ZONE. Il y a un violon électrique et deux ondes thérémines dans LE JOUR OU LA TERRE S'ARRÊTA, score particulièrement novateur qu'Alfred Newman suggéra de compléter par une bouilloire du même type, afin de parachever l'aspect futuriste d'une partition qui n'est pas sans faire penser aux trouvailles du jeune George Antheil.
Quant aux coups d'archets de PSYCHOSE, il s'agit là, ni plus ni moins, d'une nouvelle façon de jouer du violon qui, comme le piano chez Bartok, devient avec Herrmann un instrument à percussions. Ce travail sur les timbres imposa donc au musicien d'écrire toutes ses orchestrations et de refuser ainsi l'aide d'un subalterne dont la fonction reste si controversée dans la musique hollywoodienne. Pour VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE, il élimina toutes les cordes pour ne conserver qu'un ensemble de vents augmenté de cinq orgues dont un de cathédrale et quatre électroniques. Les réverbérations du vibraphone simulent avec justesse les échos d'un monde de grottes et de cavernes, tandis que le reste de l'orchestre, jouant dans les registres les plus graves, crée une ambiance lourde de menaces et aussi d'émerveillement. Ainsi en va-t-il de la féerie en stuc multicolore d'une Atlantide battue par le flux et le reflux de lignes mélodiques souples et ondoyantes.
A l'opposé de cette fresque tellurique, comme travaillée au couteau, il y a la musique légère et sensible de MAIS... QUI A TUÉ HARRY ? où les divers pupitres sont employés comme autant d'instruments solistes. Jeu de couleurs et de nuances, palette très impressionniste bien digne de tracer le portrait de ce cinéaste pince-sans-rire et, à sa façon, diabolique. Mais, comme il arrive souvent, le film commande et le musicien s'exécute. C'est pourquoi LE JARDIN DU DIABLE est une partition dominée par une brève et saisissante figure jouée par les cors, trombones et trompettes, et qui ne montre nul développement tout au long du film mais devient un motif obsessionnel auquel un spectaculaire accompagnement orchestral procure tout le relief nécessaire. En ces moments propices, le compositeur se fait démiurge. II façonne le monde; que ce soit celui des basiliques minérales qui se dressent un peu partout dans la trame de sa SYMPHONIE, de ces plongées ahurissantes dans le ventre de la terre, dans les abysses océanes, la gueule béante de MOBY DICK la baleine blanche, le gouffre d'une démence qui, sans cesse, creuse le vide sous elle. Ou alors, à l'assaut d'une abrupte falaise, les têtes de quatre hommes illustres apportant leur caution à l'art cinématographique et aussi à la musique qui fut écrite pour le servir. Tel ce "fandango orchestral et kaléidoscopique" composé pour le générique de LA MORT AUX TROUSSES et qu'interprète, avec toute la fougue requise, l'orchestre symphonique de la M.G.M. Tant de foisonnements sonores qu'Herrmann aimait bien mais, de son propre aveu, "à condition que la rigueur préside à cette fusion".
Un dernier point vaut la peine d'être soulevé. Il s'agit de la présence de la musique dans le film, de son rapport avec les images et le récit. A l'époque du tout musical qui marqua les débuts du cinéma succéda celle où des compositeurs comme Herrmann et Rozsa en particulier, surent faire évoluer leur contribution en fixant des limites à la musique. Cessant d'être omniprésente, elle devient d'autant plus pertinente en ces moments où elle se conçoit comme élément de la construction filmique, approfondissement de la psychologie et de la dramaturgie. La seule scène d'ouverture de SUEURS FROIDES suffira à illustrer ce propos. Course poursuite sur les toits de San Francisco qu'accompagne un ostinato sur les cordes graves et une furieuse dynamique des cuivres, mais incapable cependant de faire franchir au personnage l'espace séparant deux buildings. Un accord dissonant évoque magistralement le vertige de James Stewart qui est frayeur du dehors et du dedans également. Le mouvement est double et la partition enrichit le texte filmique; elle est aux petits soins de la complexité du discours qu'affectionne le cinéaste.
D'un autre côté, elle s'en voudrait d'être trop souvent en décalage par rapport aux images; aussi se plaît-elle à en adopter souvent les couleurs et les dessins. Avec Herrmann, on peut dire que toutes les saisons y passent et pas seulement les cinq premiers mois de l'année comme dans THE FANTASTICKS, cycle de chants sur des vers de Nicolas Breton, poète élisabéthain. Les couleurs de l'hiver sont celles de JANE EYRE, histoire balayée par les vents froids d'une lande austère; ce sont aussi les panoramas enneigés de LA MAISON DE L'OMBRE que traverse un fugitif en quête de rédemption, ce sont les cimes monumentales et acérées de cette unique SYMPHONIE à l'orchestration anguleuse, aux teintes très scandinaves; ce sont les gris et les verts estompés, pastels pour une berceuse dédiée à ceux qui sont tombés (FOR THE FALLEN). La mauvaise saison, c'est encore la partition monochromatique du RIDEAU DÉCHIRÉ où un motif de trois notes pour violoncelle et contrebasse diffuse partout un sentiment de terreur et de meurtre. Herrmann possédait les dons de l'aquarelliste, dédaigneux des huiles lourdes et criardes, préférant adoucir les contrastes, gommer les aspérités, lisser toutes les surfaces. Quoi de plus naturel qu'il en vînt à composer en noir et blanc ou, du moins, dans ce qui, à ses yeux, en était un équivalent musical. Ce qu'il fit pour PSYCHOSE avec un orchestre de cordes ayant fait date dans les annales de la musique de film.
Les riches nuances de l'automne sont celles de MAIS... QUI A TUÉ HARRY? dans ces paysages de la Nouvelle-Angleterre auxquels conviennent bien les teintes élégiaques du cor anglais qui fredonne comme un très vieux folk-song. En fin d'après-midi, les couleurs se font plus dures sans que leur âpreté n'altère la bonhomie de personnages qui savent qu'une marche peut être funèbre mais que la mort est rarement sérieuse au cinéma. Il y a aussi l'opulente polychromie du fantastique, les couleurs chaudes et vives d'une belle époque, ce fastueux XViiième siècle où l'Angleterre régnait sur les mers et où Lemuel Gulliver découvrait plein de fabuleuses contrées peuplées de très grands et de très petits qui enchantaient les enfants et leurs parents. Il y a encore tout le bariolage de la fantaisie, ces nuits proche-orientales et cet Olympe de carton-pâte, monstruosités hideuses et divinités toutes de métal pour lesquelles le musicien convoque un ensemble assez extravagant avec, excusez du peu, une très large section de cuivres et bois, une gargantuesque batterie de percussions dont une vingtaine d'appareils à bruit; des fortissimo dans les registres les plus graves, des figures éraillées, des effets stéréophoniques pour cors et trompettes, des dynamiques très inhabituelles, le tout sous le contrôle d'un technicien hors pair et d'une liberté créatrice conjuguant précision et virtuosité.
Conclusion
C'est un lieu commun de dire aujourd'hui qu'Herrmann fut un passeur entre deux rives: d'une musique héritée de la période romantique à cette autre intégrant les recherches les plus inédites; et participant ainsi à l'émergence d'une nouvelle génération de musiciens de films, chacun pouvant citer ici les noms qui lui semblent les mieux convenir. Ainsi, en permettant la transition entre deux approches complémentaires, le musicien a-t-il assuré la pérennité de la forme classique adaptée au cinéma... Ce nouveau genre qui a bien grandi en un siècle mais n'est pas encore reconnu comme un enfant légitime. Du reste, si Herrmann n'avait pas rejoint Hollywood, les cuivres qu'il aurait écrites auraient-elles été bien différentes de ses musiques de films D'autant qu'il sut toujours garantir son indépendance et ne travailla, presqu'à chaque fois, que sur des projets qu'il avait choisi. Aurait-il pu devenir le compositeur de JANE EYRE et de MADAME MUIR sans avoir été celui des HAUTS DE HURLEVENT; celui de PSYCHOSE sans que de sa plume soit sortie la SINFONIETTA FOR STRINGS?
Enfin, comment ne pas rapprocher Herrmann de cet autre musicien, si tourmenté, que fut Robert Schumann, pianiste raté, piètre chef d'orchestre, incertain de sa vocation et plus à l'aise dans les structures musicales simples que dans les grandes formes symphoniques. Un siècle plus tard, Schumann aurait peut-être écrit de la musique de film ! Jusqu'à cette manière de clore une partition par quelque dissonance pesante, un accord non résolu qui laisse l'auditeur désappointé: une fin mais sans vrai dénouement. Schumann, dépressif et exalté, versatile et exubérant, le frère en mélancolie mais aussi en dons prodigieux d'Herrmann le romantique.
Publié à l’origine dans Soundtrack Magazine Vol.20/No.77/2001
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur, Luc van de Ven
En collaboration avec
The CinemaScore and Soundtrack Archives