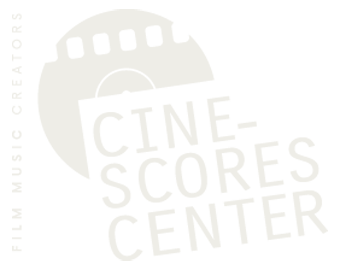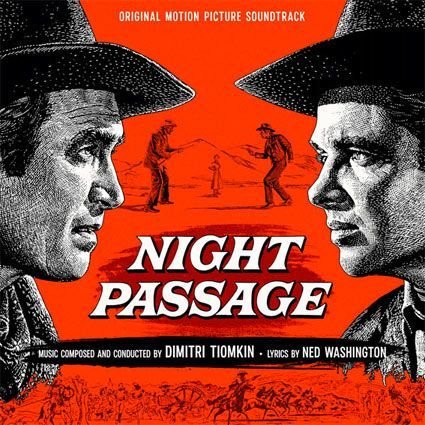Max Steiner, sa vie et son œuvre

De Vienne à New York
Maximilian Raoul Walter Steiner, est né à Vienne le 10 mai 1888, à une époque qui était encore celle des Strauss, mais où déjà s’annonçait l’éclatement de l’empire austro-hongrois et la fin de cette société insouciante. La situation matérielle des Steiner était très aisée : Maximilian Steiner, le grand-père de Max, avait dirigé le célèbre « Theater an der Wien » et produit les premières opérettes de Franz von Suppé et Johann Strauss fils. Son père, Gabor, contrôlait cinq théâtres parmi les plus importants, ainsi qu’un parc d’amusement (pour la petite histoire : c’est lui qui a construit la grande roue dans le « Prater »). Maria, la mère, avait hérité de trois restaurants les plus en vogue de Vienne.
Le jeune Maximilian, fils unique, avait donc la chance de grandir dans un milieu très musical (son parrain était Richard Strauss) et de recevoir une éducation de premier ordre. À 13 ans, il entra à l’Académie Impériale de Musique, ses maîtres étant, entre autres, Robert Fuchs, Hermann Graedener, Gustav Mahler et Félix Weingartner. Enfant prodige, tout comme l’était son contemporain Erich Wolfgang Korngold, il fit la merveille de ses professeurs et termina en un an des cours devant normalement s’étaler sur quatre années. Plus tard, Steiner s’en rappellerait avec ironie : « Mahler prédisait que je deviendrais un des plus grands compositeurs de tous les temps. Il ignorait que je finirais à la Warner Bros. »
Dès cette période, Steiner aborda une carrière dans le domaine de l’opérette et de la revue musicale. En 1903, à l’âge de 15 ans, il composa une opérette intitulée « Die schöne Griechin » qui, produit par un concurrent de son père, était un des succès de la saison. En tant que chef d’orchestre, Max Steiner allait voyager à Berlin, Moscou, Johannesburg. En 1906, après la banqueroute de son père, il décida de s’établir à Londres où il allait vite se faire un nom dans le milieu de la comédie musicale.
Lorsque la guerre éclata, l’Autrichien Steiner se vit obligé de quitter le pays. Il résolut d’aller aux Etats-Unis où il arriva en décembre 1914 dans le port de New York, « avec trente-deux dollars dans ma poche », comme il le raconterait plus tard. Broadway étant loin de Londres, Steiner dut de nouveau repartir à zéro. Il accompagna au piano des artistes de vaudeville et accepta un travail de copiste chez Harms Music Publishing. Rapidement, on commença à l’engager comme orchestrateur de comédies musicales. Pendant les années suivantes, Steiner allait collaborer, en tant qu’arrangeur, orchestrateur et chef d’orchestre, avec les grands noms de la comédie musicale américaine dont Victor Herbert, George Gershwin, Jerome Kem, Vincent Youmans, Cole Porter, Irving Berlin et Florenz Ziegfeld.
L’arrivée à Hollywood
Lorsque, le 6 octobre 1927, un public enthousiasmé découvrit Al Jolson dialoguer à l’écran avec sa « Mammy » et entamer quelques chansons du répertoire populaire, il signa en même temps l’arrêt de mort du cinéma muet. La panique s’empara d’Hollywood : comment allait-on satisfaire les nouvelles préférences des spectateurs? THE JAZZ SINGER et sa quasi-suite THE SINGING FOOL (1928) avaient marqué la direction à prendre. Les nouveaux procédés de synchronisation semblaient surtout bénéficier à des revues musicales en grande partie directement adaptées de Broadway. Le public demandant avidement de nouveaux ‘talkies’, les producteurs d’Hollywood, à cours de temps mais craignant aussi des risques supplémentaires, décidèrent de se tourner vers l’immense patrimoine musical de ‘Tin Pan Alley’.
Décidée à ne point se laisser distancier dans la chasse au public, la RKO, une des grandes compagnies de l’époque, acquit les droits de « Rio Rita » de Harry Tierney. Pour les besoins de la direction musicale, le compositeur recommanda Max Steiner qui avait déjà orchestré et dirigé la version originale. William Le Baron, chef de production de la RKO, s’empressa de faire signer un contrat à Steiner. Celui-ci accepta, et c’est en décembre 1929 qu’il arriva à Hollywood, ignorant sans doute que cette décision allait changer toute sa vie.
Vers la fin de 1930, le public commençait à se lasser de ces revues musicales filmées qui finalement se ressemblaient beaucoup et n’avaient d’ailleurs la plupart du temps pas de véritables trames narratives. La RKO décida de réduire son département musical et chargea Steiner d’y expédier les affaires courantes. Ce qui signifiait concrètement : se limiter à enregistrer des ouvertures et de la musique « de circonstance » pour les films dramatiques, en se basant sur du matériel préexistant. Une politique qui ne différait en rien de celle des autres studios.

La naissance d’un nouvel art
Si la musique fut bannie des films parlants à cette époque, c’était pour plusieurs raisons. Après 1927, il semble y avoir eu une période de transition, où la bande sonore de certains films consistait largement en une musique ininterrompue. Celle-ci pouvait céder la place à une ou deux scènes dialoguées (souvent ajoutées après coup) méritant au film son label de ‘talking picture’. La pratique musicale s’orientait directement à celle des films muets, c’est-à-dire que la compilation et l’équivalence musicale naïve l’emportaient sur la composition originale et la recherche d’univers sonores spécifiques.
Lorsqu’à la suite de LIGHTS OF NEW YORK (1928), et parallèlement à la première vague de comédies musicales, se développa la mode des ‘all-talkies’, des films parlants à 100% où une scène dialoguée suivait l’autre, la musique fut presque complètement abandonnée. Jadis ‘ersatz’ d’une bande sonore réaliste, on la croyait superflue à l’âge de l’image parlante qui semblait combler le besoin de naturalisme du public. On admit sa présence lors du générique et des scènes de poursuite, mais on la bannit des scènes dialoguées.
Le mélange de deux niveaux sonores semblait inacceptable. « Mais d’où viendrait la musique ? », était la question habituelle des producteurs. Seule exception, une musique faisant explicitement ou implicitement partie de la réalité du film, c’est-à-dire jouée par un orchestre, un phonographe, un orgue de Barbarie, etc. Il ne faut pas non plus oublier que pour les premiers films parlants, la prise de son était beaucoup gênée par le fait qu’on enregistrait en même temps l’image et le son (dialogues, bruits, musique).
Dans le meilleur des cas, cette absence de musique bénéficiait au film. Mais beaucoup plus souvent, la seule utilisation de sons réalistes laisse l’impression, de nos jours en tout cas, d’un manque dans l’œuvre cinématographique, d’autant plus grand que la réalité du film s’éloigne de la réalité du spectateur. Ainsi, celui-ci ne peut souvent pas s’identifier à l’histoire et est amené à critiquer l’atmosphère artificielle, « de studio », et le montage « incohérent » du film. Ceci s’applique plus particulièrement au cinéma mélodramatique et fantastique qui commençait à prospérer en ces temps de dépression économique.
À Hollywood, c’est Max Steiner qui le premier découvrit l’immense potentiel psychologique de la musique. Ou plutôt faudrait-il dire : « redécouvrit », car la musique a depuis toujours été utilisée pour surmonter la résistance psychique du spectateur à se faire sienne une réalité créée de toute pièce. L’habitude d’accompagner des dialogues par une musique caractérisait déjà le théâtre romantique et mélodramatique du XIXème siècle. En plus, la pratique de l’accompagnement musical des films muets était trop récente pour avoir tout à fait été oubliée. Dans les années 30, un grand nombre de directeurs musicaux et de compositeurs étaient des rescapés du cinéma muet.
La preuve par l’exemple de l’impact psychologique que peut avoir la musique dans un film, allait être faite dans SYMPHONY OF SIX MILLION (1932) de Gregory LaCava, narrant les problèmes sentimentaux d’un médecin juif de New York. Après le montage, le producteur David O. Selznick jugea que quelque chose manquait à son film et pria Steiner d’écrire de la musique – à titre expérimental – pour une scène où le père du médecin meurt après avoir subi une intervention chirurgicale. Les dirigeants de la RKO furent enchantés par la dimension nouvelle que prenait ainsi leur produit et prièrent Steiner de compléter son travail sur le film entier.
La partition de SYMPHONY OF SIX MILLION peut sembler assez rudimentaire et manquer de subtilité aujourd’hui, mais elle constitua un grand progrès en 1932. Si par son style et la forme de ses thèmes, elle se rattache plutôt à la musique de film muet, l’emplacement judicieux de la musique qui n’était plus utilisée continuellement, témoigna d’une nouvelle approche. La morale que tiraient les producteurs de cet exemple, est que le compositeur est une sorte de docteur qui vient voir son malade après que toutes les autres tentatives de sauvetage aient échoué ; grâce à sa mallette bourrée de mélodies, il peut accomplir tous les miracles voulus. « Vous devez absolument sauver notre film ! », était une phrase que les compositeurs pouvaient entendre de plus en plus souvent.

Le perfectionnement d’un style
Deux autres films de 1932 permettaient à Steiner de poursuivre ses recherches ; BIRD OF PARADISE, une histoire d’amour entre un marin américain et une jeune fille polynésienne, ainsi que THE MOST DANGEROUS GAME. Les deux films contiennent à peu près 100% de musique, manifestement pour surmonter le décalage entre la réalité du spectateur et la « réalité » créée par le film. En effet, parmi ceux qui achetaient un billet pour se plonger dans une salle obscure et oublier le ronron quotidien, qui pouvait prétendre avoir jamais vu de près un archipel polynésien ou été pris en chasse par un comte fou sur une île déserte, ce qui, respectivement, était le propos de ces films. Le résultat est certainement frappant si l’on compare THE MOST DANGEROUS GAME à un film comme ISLAND OF LOST SOULS, tourné la même année, qui, malgré ses qualités artistiques, semble beaucoup plus artificiel et « invraisemblable », très probablement à cause du manque d’une bande musicale. Steiner écrivit de la musique pleine d’agitation pour les scènes de chasse, présageant par endroits la musique qu’il allait écrire l’année suivante pour KING KONG.
KING KONG (1933) est sans doute le premier chef d’œuvre de la musique de film américaine et contribua également beaucoup à faire connaître le nom du compositeur en Europe. Steiner reçut même une offre pour enseigner sa technique de la musique de film à Moscou. Dans ce cas, aussi, les responsables du studio (la RKO) avaient d’abord cru pouvoir se passer de musique ; le président Kahane, jugeant qu’on avait déjà trop dépensé pour cette stupide histoire d’un singe géant tombant amoureux d’une jeune fille blanche, pria Steiner de ne pas encore ajouter aux frais de production et d’utiliser de la musique préexistante, tirée des archives du studio.
Merian C. Cooper, le producteur du film, sentait lui aussi les faiblesses de l’histoire et de l’animation image par image, mais arriva à la conclusion opposée : il demanda à Steiner de faire de son mieux et offrit même de payer tous les frais supplémentaires. Le compositeur ne se fit pas prier et engagea un orchestre de 46 personnes (l’orchestre ordinaire de la RKO n’en comprenait que 10), ajoutant ainsi 50.000 dollars au budget. Le résultat était une musique de film incroyablement moderne et osée pour l’époque ; le rythme sauvage et l’utilisation fréquente de dissonances firent plutôt penser à Stravinsky qu’à Tchaïkovski.
La partition de Max Steiner était basée sur l’emploi de courts ‘leitmotive’ tels que les avait utilisés Richard Wagner dans ses opéras, et dont la fonction était d’unifier le spectacle et d’établir des relations entre des personnages, des situations ou des idées, non-évidentes autrement. Une caractéristique essentielle de ces motifs est leur brièveté, ce qui les oppose aux thèmes plus longs et généralement moins flexibles. Les ‘leitmotive’ de KING KONG répondent bien à cette définition; ainsi le motif de Kong, trois notes chromatiques descendantes, qui s’adapte à toutes les situations et peut être accéléré, ralenti, inversé ou combiné à d’autres motifs.
On a souvent reproché à Steiner l’emploi excessif de ces ‘leitmotive’ qui ne feraient que refléter le contenu superficiel des images. Or, dès KING KONG, le compositeur utilisait ces motifs pour signaler ce qui n’était pas immédiatement contenu dans le perçu visuel. En utilisant un thème déjà clairement associé à un personnage ou une situation, pour une scène au contenu apparemment très différent ou difficilement déchiffrable, le compositeur peut en dégager le sens profond ou même suggérer une idée nouvelle.
En 1935 sortit THE INFORMER, un film qui consacra définitivement la gloire de Max Steiner aux Etats-Unis et ailleurs. Pourtant, sa partition provoqua aussi de violentes polémiques, plus particulièrement de la part du compositeur français Maurice Jaubert qui condamna sévèrement la technique du synchronisme musical, poussée à son extrême dans THE INFORMER. Ce soulignement des incidences matérielles (qualifié de ‘mickey-mousing’ en raison de son utilisation dans les dessins-animés) était une des critiques les plus fréquentes à l’adresse de Max Steiner. Alors que Stokowski trouvait géniale l’idée du compositeur de traduire en musique le boitement de Leslie Howard dans OF HUMAN BONDAGE (1934), Aaron Copland qualifiait l’effet de « trop évident » et « vulgaire ».
Quoi qu’on puisse en penser, l’approche musicale de THE INFORMER était le résultat d’une stylisation voulue, par le réalisateur et le musicien, des sons naturels, peu utilisés dans le film. A l’époque, le résultat paraissait convaincant à beaucoup de gens, comme en témoignent les nombreuses récompenses que reçut Steiner : Oscar, médaille du Roi des Belges, médaille d’Officier de l’Académie française, prix au Festival de Venise, etc. Max Steiner était devenu le compositeur le plus en vue d’Hollywood. « Demandez à Steiner! », « Nous devons absolument avoir Steiner! » étaient des exclamations qu’on pouvait entendre de plus en plus souvent dans les bureaux de direction des grands studios. Deux années plus tard, Frank Capra, mettant en scène LOST HORIZON à la Columbia, allait décider d’engager Steiner pour superviser et diriger la musique composée par le « novice » Dimitri Tiomkin.

La période classique
En 1936, Steiner quitta la RKO pour rejoindre David O. Selznick qui venait de former une compagnie de production indépendante afin de réaliser des œuvres « de qualité », à la différence de la production en série des grands studios. Selznick était un grand admirateur du compositeur, bien que son goût musical fût quelque peu simpliste, et que les deux hommes eussent souvent des divergences d’opinions. Steiner n’allait rester qu’une année avec Selznick et y composer la musique de LITTLE LORD FAUNTLEROY (1936), THE GARDEN OF ALLAH (1936) et A STAR IS BORN (1937). Entre-temps, il fut « loué » (telle était la situation juridique des artistes sous contrat avec un studio) à la Warner Bros., pour CHARGE OF THE LIGHT BRIGADE (1936) et deux autres films.
En 1937, Steiner signa un contrat à long terme avec ce studio, contrat qui allait s’avérer d’une importance capitale pour les deux parties. Le chef du département musical de la Warner, Leo F. Forbstein, musicien médiocre mais technocrate averti, s’était mis en tête de doter son studio du meilleur département musical d’Hollywood. Pour cela, il avait déjà réussi à faire signer un contrat à Erich Wolfgang Korngold, un compatriote de Steiner et un des musiciens les plus célèbres de l’entre-deux-guerres. Etant le premier compositeur de renommée internationale à venir à Hollywood, Korngold avait réussi à obtenir des conditions absolument exceptionnelles ; ainsi, il avait le droit de choisir les films qui l’intéressaient et les droits d’auteur restaient en sa possession au lieu de devenir la propriété du studio, ce qui était un cas absolument unique.
Autour des deux compositeurs-vedettes Korngold et Steiner, était groupée une équipe de compositeurs secondaires (qui avaient parfois une spécialité, comme par exemple les dessins-animés), d’orchestrateurs (comme Hugo Friedhofer), de ‘song-writers’ (comme Harry Warren), de paroliers, d’arrangeurs et de superviseurs divers. La division du travail était de règle dans les grands studios et les départements musicaux n’y faisaient pas exception. « Nous étions tous des roues dans un engrenage bien huilé », se rappellera plus tard Hugo Friedhofer.
Grâce à des moyens comme le ‘cue-sheet’ (découpage d’une séquence en secondes et fractions de secondes) et le ‘click track’ (une sorte de métronome synchronisé avec le film), la technique de la musique de film avait en sorte atteint sa perfection. L’âge de l’improvisation était définitivement révolu. Steiner avait joué un rôle décisif dans l’élaboration de ces techniques dont le but était de permettre un synchronisme absolu.
Le style de la musique était généralement celui du romantisme et du post-romantisme allemand ; Wagner, Mahler, Richard Strauss étaient les grandes idoles, mais également Tchaïkovski, Verdi, Puccini et Rachmaninov. Ce qui s’explique à la fois par l’éducation des musiciens, venant la plupart d’Europe centrale comme Steiner, par le goût du public, des producteurs (décisif!) et la tradition du cinéma muet.
Romantique par son essence, la musique de film était dramatique et expressive ; elle reflétait le perçu visuel dans son espace et dans sa durée. Exprimant des sentiments comme l’amour, la haine, la tristesse, la déception, elle avait besoin d’une certaine durée pour pouvoir livrer son message. Structurée par des ‘leitmotive’ aisément repérables, la musique aidait le spectateur à entrer de plain-pied dans l’univers du réalisateur. Si elle paraît excessive par instants, c’est que sa fonction n’était pas de rattacher les personnages de l’écran à la réalité mais au mythe. Cette sentimentalité qui fait sourire le spectateur blasé d’aujourd’hui, est une caractéristique du cinéma mélodramatique de l’époque et n’y était pas considérée comme redondance musicale.
C’est sous cet aspect qu’il faut voir la contribution de Steiner pour des films comme JEZEBEL (1937), FOUR DAUGHTERS (1938), DARK VICTORY (1939), FOUR WIVES (1940), ALL THIS, AND HEAVEN TOO (1940), THE LETTER (1940), NOW VOYAGER (1942), SINCE YOU WENT AWAY (1944), mais aussi pour des westerns épiques comme THE OKLAHOMA KID (1939), DODGE CITY (1939), VIRGINIA CITY (1940), SERGEANT YORK (1941) ou THEY DIED WITH THEIR BOOTS ON (1942). L’osmose entre les images et la musique y est totale. L’influence de Korngold est sensible dans ces partitions, aussi bien dans l’harmonisation plus riche et plus complexe, qui allait devenir quelque peu l’image de marque du studio, que dans une subtilité plus grande dans l’emploi du ‘dialogue underscoring’, de la musique accompagnant les dialogues.
Steiner et Korngold avaient une nette préférence pour l’orchestre symphonique traditionnel, en l’occurrence composé d’une cinquantaine de musiciens sous contrat, comme dans la plupart des grands studios. Les génériques donnaient toujours lieu à une sorte d’ouverture exposant les principaux thèmes de la partition et faisant appel à l’orchestre complet. Les scènes dialoguées étaient accompagnées la plupart du temps par les violons ou l’ensemble des cordes, pour des raisons psychologiques, mais également parce que leur timbre est relativement neutre par rapport à la voix humaine.

Interlude patriotique
Après l’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941, Hollywood décida de se mettre au service de la nation, en utilisant l’immense potentiel psychologique du cinéma pour soutenir le moral des Américains. Des films de propagande plus ou moins ouverte sortaient en chaîne des grands studios. La Warner montrant une dextérité particulière dans ce domaine, il était normal que la musique de plusieurs de ces films allait être signée par Max Steiner.
CONFESSIONS OF A NAZI SPY (1939) fit figure de pionnier dans ce domaine; il fut suivi par des films comme DIVE BOMBER (1941), CAPTAIN OF THE CLOUDS (1942), DESPERATE JOURNEY (1942), WATCH ON THE RHINE (1943), MISSION TO MOSCOW (1943), CASABLANCA (1943), PASSAGE TO MARSEILLES (1944) et SINCE YOU WENT AWAY (Selznick 1944), pour n’en citer que quelques-uns. Tous ces films se caractérisent par un emploi poussé d’airs populaires et d’hymnes nationaux divers destinés à montrer la résistance héroïque des nations alliées. Steiner, qui refusait toujours d’adapter de la musique classique dans ses partitions cinématographiques, était un grand partisan de ce genre de citation musicale. Il est incontestable que le recours à un patrimoine musical populaire a beaucoup bénéficié à ces films, en leur faisant dépasser le cadre de déboires personnelles des protagonistes qui deviennent des figures exemplaires.
La citation musicale d’airs hautement connotés est d’ailleurs une technique utilisée dans presque toutes les partitions de Max Steiner et des autres compositeurs hollywoodiens de l’époque. A part la marche nuptiale de « Lohengrin » qui accompagnait inévitablement toutes les cérémonies de mariage, on peut citer parmi beaucoup d’autres airs, « Auld Lang Syne » qui annonce la nouvelle année, et « Gaudeamus Igitur », qu’on entend dès que le fils de la famille part pour l’université. Sans oublier bien-sûr le western, terre d’élection des chants folkloriques et patriotiques.
Mais il arrivait également à Steiner de baser des partitions entières sur des airs connus. Ainsi dans ARSENIC AND OLD LACE où le compositeur fait un emploi très ironique de « There is a happy land, far, far away » et de « Rock of Ages », pour se moquer du zèle quasi-religieux des deux vieilles dames à expédier les gens vers l’au-delà. Dans un genre tout à fait différent, on peut citer BEYOND THE FOREST (1949) où Steiner utilise les trois premières notes de la chanson « Chicago » pour montrer l’attirance qu’exerce cette ville sur Rosa Moline (Bette Davis), l’épouse mécontente d’un médecin de campagne.
Mais, pour revenir au film de guerre, ce genre peut encore poser d’autres problèmes au compositeur, exprimés assez laconiquement par Max Steiner : « Vous vous tuez à écrire une musique, et tout ce qu’on entend après, c’est boum-boum-boum-boum ! » Le fait est que même la Warner, le studio réputé le plus mettre en évidence la musique dans la bande sonore de ses films, avait tendance à privilégier les sons réalistes dans les scènes d’action. Ce qui résultait en une variation permanente, non-prévue par le compositeur, du niveau de la musique au mixage; une décision parfois prise aux dépens du film. Il est vrai que cette situation témoigne également du manque de coordination entre les différents départements d’un studio, largement autonomes.
Pour les films de guerre réalisés après 1945, comme FIGHTER SQUADRON (1948), OPERATION PACIFIC (1951). THE CAINE MUTINY (1954), BATTLE CRY (1955) et DARBY’S RANGERS (1958), les mêmes remarques restent valables, l’utilisation d’airs préexistants diminuant toutefois nettement. En plein accord avec les films, la démarche musicale de Steiner était de glorifier les exploits humains dans la guerre : sa musique était toujours plus héroïque que dissonante. Toutes les partitions mentionnées ci-dessus reposent essentiellement sur une marche dans le style de Sousa, qui donne lieu à des variations symphoniques tout au long du film. A noter également la quantité relativement importante de musique réaliste, assumant parfois les fonctions de la musique dramatique; si ce n’est à cause de l’habitude du G.I. hollywoodien de faire ses adieux à sa fiancée dans un bar ou lors d’un bal.
Un nouveau climat musical
Dans l’histoire d’Hollywood, les années 40 marquent une phase de transition importante, transition vers ce qu’on pourrait appeler la période post-classique. Les mythes, qu’on avait crus éternels, et qui constituaient le fond commun du cinéma hollywoodien, commençaient à chanceler. Une autre réalité apparut derrière les décors somptueux en carton-pâte; l’Amérique, jadis terre de pionniers, se découvrit le visage d’un univers urbain, ambigu et parfois inhumain. Le happy-end d’antan fut remplacé par un excès de pessimisme et de morbidité. La frontière entre le bien et le mal devenait moins claire, le film noir fit son apparition. Bien que Hollywood commençât déjà à s’ébranler, la structure interne des grands studios n’allait pas changer jusque dans les années 5o. Ainsi s’explique le choix de compositeurs œuvrant dans la tradition du symphonisme romantique, pour le genre éminemment américain qu’est le ‘thriller’.
En 1946, Max Steiner composa la musique de THE BIG SLEEP, un des films les plus importants de ce courant cinématographique. Confronté à un problème stylistique assez difficile, Steiner opta pour une surenchère orchestrale provoquant un curieux décalage entre les images et la musique. La partition, qui « se présente sous la forme d’une longue montée sourde, dramatique, véritable toile de fond d’un drame métaphysique » (Alain Lacombe), annonce une évolution dans le style de Steiner: sa musique allait se teinter d’un certain pessimisme en accord avec les films. Lourde et écrasante, elle ressemble à un immense linceul, constatant d’avance l’échec des personnages. Les thèmes d’amour (celui de THE BIG SLEEP est significatif à cet égard) devenaient plus sophistiqués et révélaient un certain désabusement. Sentant que les anciennes formules ne suffisaient plus pour s’adapter aux nouveaux films, Steiner employa de plus en plus souvent des dissonances dans son discours musical et utilisa le jazz à des fins dramatiques (CAGED, 1950).
Parallèlement à l’apparition du ‘thriller’, les anciens genres avaient commencé à évoluer et à recourir à des éléments extérieurs aux mythes originaux : le western, le mélodrame et le film d’aventures peuvent ici servir d’exemple. PURSUED (1947) s’inspirait plus de la tragédie antique et de la psychanalyse freudienne que des mythes nourriciers du western. Steiner semble tout à fait avoir saisi la différence entre cette œuvre curieusement bâtarde et les westerns épiques dont il avait l’habitude. Ecoutée séparément, la musique ne trahit jamais ses origines et reste une des œuvres les plus inhabituelles du compositeur.
Le pessimisme caractérisait également les mélodrames sociaux de l’époque, comme MILDRED PIERCE (1945) et surtout BEYOND THE FOREST (1949). Dans la séquence finale de ce film, où une Bette Davis agonisante essaie de se traîner vers le train pour Chicago, Steiner utilise une variation en mineur sur la célèbre chanson, qui n’a plus rien à avoir avec le long crescendo romantique accompagnant les adieux de Jennifer Jones à Robert Walker dans SINCE YOU WENT AWAY (1944).
La même tendance vers une surenchère musicale marquait quelque peu THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE (1948), plus une parabole métaphysique sur la condition humaine qu’un film d’aventures. Plus particulièrement la longue montée arythmique de plus en plus stridente qui accompagne l’attaque des bandits mexicains, a donné lieu à quelques critiques voyant là une exagération absolument gratuite. D’autre part, certaines séquences, comme celles mettant en scène la paranoïa de Dobbs (Humphrey Bogart), permirent à Steiner de composer des passages parmi ses plus modernes.
La musique de film étant un art fonctionnel, toute analyse est nécessairement relative, et ses résultats ne pourraient avoir qu’une validité limitée. Pendant la période décrite ci-dessus, Steiner continua à composer pour des films plus classiques, parmi lesquels il faut surtout relever les partitions de JOHNNY BELINDA (1948), ADVENTURES OF DON JUAN (1949) et THE FOUNTAINHEAD (1949).
Les années 50 et 60
On sait que la qualité du cinéma hollywoodien baissa nettement au début des années 50. L’inspiration du compositeur dépendant largement du film pour lequel il doit écrire sa musique, il n’est pas étonnant que les partitions de Max Steiner sortissent beaucoup plus rarement de l’ordinaire pendant cette époque. La plupart du temps, elles révélaient la grande expérience du compositeur, mais dans certains cas une divergence entre le style du film et celui de la musique apparut déjà plus nettement, Steiner semblait être le plus à l’aise dans des films traditionnels. Des westerns épiques d’abord : ROCKY MOUNTAIN (1950), DISTANT DRUMS (1951), THE LION AND THE HORSE (1952), THE LAST COMMAND (1955), THE SEARCHERS (1956), THE HANGING TREE (1958) et A DISTANT TRUMPET (1964), un de ses derniers films. A noter également ses partitions pour des films de cape et d’épée comme THE FLAME AND THE ARROW (1950), pseudo-historiques comme HELEN OF TROY (1956) ou religieux comme THE MIRACLE OF OUR LADY OF FATIMA (1952). De plus en plus souvent, il fut amené à travailler pour d’autres studios, comme la Columbia, la Republic et la RKO, ou pour des producteurs indépendants.
Conformément aux tendances de l’époque, Steiner employait moins de musique dans la plupart de ses films, tout en utilisant plus parcimonieusement la technique du ‘mickey-mousing’ (une évolution déjà évidente dans les années 40). Mis à part l’admirable THE SEARCHERS (1956), deux autres travaux importants jalonnent la fin de cette décennie: BAND OF ANGELS (1957) et JOHN PAUL JONES (l959). Pour le compositeur, BAND OF ANGELS constituait quelque peu un retour en arrière, à l’époque de GONE WITH THE WIND dont l’histoire du film de Walsh s’inspirait nettement. La musique de Steiner est importante, et sur le plan de la quantité et sur celui de la qualité. Elle montre en outre une prédilection de plus en plus grande pour des thèmes en forme de valse au caractère plus nostalgique que flamboyant. Comme quoi Steiner ne semblait nullement avoir oublié ses origines.
L’année 1959 annonçait une dernière évolution dans l’œuvre du compositeur. A cette époque, le démantèlement des grands studios provoqué par la crise du cinéma, allait entraîner une dissolution des départements musicaux et un renvoi des compositeurs de la vieille école. Car Hollywood, en quête de nouveaux spectateurs après avoir dû abandonner son public familial à la télévision, avait décidé de se mettre à l’heure de la jeunesse. Et on comptait bien donner aux jeunes ce qu’ils demandaient, y compris sur le plan musical.
Steiner, à l’âge de 71 ans, allait prouver qu’il était parfaitement capable de s’adapter à cette mode, tout en gardant à la musique ses possibilités dramatiques. Son thème de A SUMMER PLACE devint un des plus grands succès de la saison. Le compositeur y donnerait suite avec PARRISH (1961) et ROME ADVENTURE (1964), dont les thèmes parvinrent également à devenir très populaires, sans néanmoins pouvoir renouveler le succès phénoménal de A SUMMER PLACE. En 1965, après un film particulièrement médiocre, TWO ON A GUILLOTINE, Max Steiner s’arrêta de travailler pour le cinéma. Il prit sa retraite à contrecœur et pour la seule raison qu’on ne lui proposait plus de films. Sans succès, il allait essayer à plusieurs reprises d’obtenir de nouveaux engagements. Mais les temps avaient bien changé et à Hollywood on oublie vite.
Lorsque le 28 décembre 1971, Max Steiner ferma les yeux pour toujours, il était déjà une légende. Il ne s’était probablement pas douté que plusieurs années plus tard, sa musique serait réenregistrée et ses anciens disques réédités. L’opinion personnelle du compositeur était beaucoup plus humble : « J’ai toujours essayé de me subordonner au film… Certains films ont besoin de beaucoup de musique, d’autres sont si réalistes que la musique ne ferait que déranger. La plupart de mes films étaient des divertissements : drames sentimentaux, aventures fabuleuses et fantaisies. Si ces films étaient tournés aujourd’hui, ils seraient faits différemment, et j’en écrirais la musique d’une manière différente. Mais mon attitude serait la même – donner au film ce dont il a besoin… Je crois que la musique devrait plutôt être sentie qu’entendue. D’autre part, on m’a souvent dit qu’une bonne musique de film est celle qu’on ne remarque pas, à quoi j’ai toujours répliqué : 'Mais à quoi sert-elle si on ne la remarque pas ?’ »