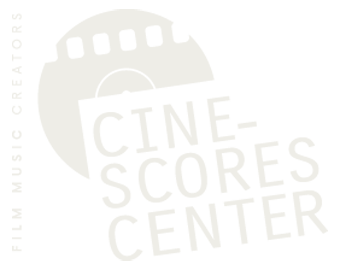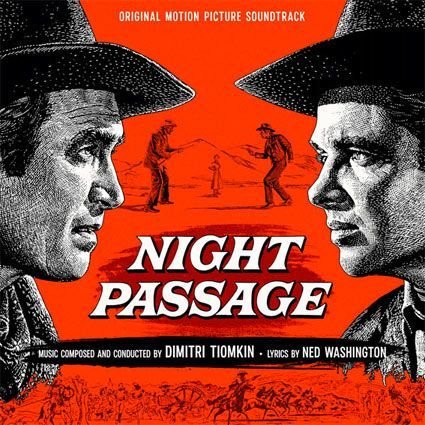A Walk in the Forest

Source: Films in Review Vol XXVI No 10
Publication: December 1975, pp 627-630
Publisher: National Board of Review of Motion Pictures. Copyright © 1975 All rights reserved.
Hugo Friedhofer's current film score is for the Randall Hood production A WALK IN THE FOREST, a very memorable short subject documentary. So brilliant is the music, so dazzling and subtle its impact, that the impulse is to write around the score, to avoid the superlatives it evokes. It reaches to the heart of the poetry and subject of the film. i.e. “Man as Nature's partner:” few short subject features have been graced with such music. Friedhofer's inner vision of both the colors and shapes of “Nature's stern economy,” are beautifully limned against the gossamer-like eloquence of his melodic contours. His score is a forest symphony delicately reminding us of the ritual procession of Nature in intricate harmony with man's silent involvement with that force.
The almost magical mysteries of the large evergreen forest on the West Coast of North America, photo graphed by Michael Lonzo with breathtaking art, is made accessible by Friedhofer's glimpse into the heat, rain and snow, crystallizing the heart breaking majesty and terrifying awe of universal forces. Friedhofer's expertise. building elaborate but easily assimilated musical ideas, is something one hears once in a decade in films. Its quality lies not only in the fluency of Friedhofer's technique, but in even aspect of director Hood's mastery. A WALK IN THE FOREST will leave you breathless; it is an almost unprecedented event in the medium for which the production company, MacMillan Bloedel, should be lauded, lending full financial and moral support over the two years it took to complete this work of genuine cinematic art.
There is an infinite variety in Friedhofer's composition, which runs the length of the entire film (some 30 minutes), simplistic harmonies of the gentlest kind, rising from American roots with a dignity that often takes the breath away (a solo violin over hushed strings for a soaring helicopter shot of the mountains). Friedhofer's counter lines, like folk strands, have an individuality that springs independent of popular limitations and whether accompanying revealing shots of hummingbirds, ouzels, dragonflies skimming the water, or mischievous raccoons, never resorts to mickey mousing.
The opening music evolves against a background of string harmonies as Jim Danforth's magnificent matte transition paintings stir to life and rays of the sun pierce the moist loam of the great forest. As the narrator speaks the words, “Man has built holy places, but this is the oldest sanctuary, the forest where he was born,” the strings reflect the spirit of a principal key-theme, or tema-cardine. (Thematic reminiscence, to be developed by Wagner into the constructive principle of leitmotiv, is strictly a legacy of French revolutionary opera-comique, and here receives a treatment so ethereal it may go unnoticed.)
There is no folk music in A WALK IN THE FOREST, but undoubtedly folk strands are the acorn from which the score grows, the modal pentatonic thematic material, the harmony of the parallel major and minor triads, the evocative and flexible use of chords not exclusively American or English. What is musically remarkable among other things is the skillful avoidance of monotony, the work's unity achieved by mood, based not on tonic- and-dominant form per se, but on free evolution of one sequence from another, a process of fusion and regeneration bound together by diatonic counterpoint. The score is certainly contemplative - “the forest is a creation of light” - clear in texture and positive in outlook, insistent if undemonstrative. Consecutive triads on woodwind and harp establish the shimmering nightfall as a golden moon rises slowly from a nest of branches, followed swiftly by other instrumental variants. Each new idea is a flowering, recapitulated subtly for high-lying strings, solo flute, supporting the natural G and E as a rudimentary sound, evoking the stillness of the silent night predators attuned to darkness. The winter sequence builds quietly, provoking the orchestral fabric to an impassioned calm mobile culminating (as the visuals freeze) in an awesome ice-tableau given significance by Friedhofer's progression leaving the orchestral extension exposed on a high C natural embodying the frozen landscape. The fire sequence contains a persistent intensification with dramatic dialogues between wind and strings, the declamation an alert and precise agitation of nature's havoc. (Almost every frame is composed with a beauty and splendid sensitivity, e.g. as a rainbow rises from the forest a dissolve is imposed over a twig bent and withered by the flame.) Life's struggle is renewed and the narration concludes: “Man of all creatures alone controls his future: he, too, is a guest on this planet ... as in all Nature, he too has a duty, that if he cares for it, it will care for him.” Over this we see a dazzling shot of the mountains and the sun bursting behind them, as over an elegy in the strings the horn chorale reaches a peroration of power and sublime serenity. The film ends with a gentle inversion, for the titles, so tender one hardly notices the clash of semitones as the strings shimmer into silence, “visible silence, still as the hour-glass.
”As an impressionist sound picture, spacious, perhaps mysterious but always clarified dramatically. Friedhofer's score for A WALK IN THE FOREST has its place in the history of the resurgence of modern film music. “Who, someone asked me recently, is the most influential composer in films?” wrote Adrian Woodford in the early ’50‘s, “Korngold or Rozsa? Would it be Newman? Herrmann coming up fast? What did I think? None of the above. I had to admit ruefully: the correct answer would have to be Hugo Friedhofer. How this highly aesthetic, aristocratic, urbanely witty San Franciscan of elitist temperament and leprechaun appearance came to be not just the most influential film composer, but the most subtle, is a curiosity in the history of cinematic taste.” When I pressed Mr. Woodford for an expatiation on these words more recently he added: “Friedhofer has always been a great orchestrator, along with Edward B. Powell, the greatest, perhaps, of this century. Yet not a single one of his works was conceived as pure orchestral music, he is the absolute film composer. Friedhofer is naturally enough associated with Korngold and Steiner, rightfully, as he orchestrated their major works, but he began as a classicist of his own and his music personality is rich, modern, post Wagner, or, rather post-Franck. His enormous clarity of expression and careful, traditional melodic expression surpassed his masters, ironically, in an anterior, extraordinarily sensitive manner they never fully explored. Friedhofer is a classicist, everything is defined, made to work for us. Korngold is jubilant, beautifully full-blown (overblown?), Rozsa is compelling. Herrmann poignantly mystical, Newman profound. Friedhofer is disarming, even when he is dead serious. Friedhofer helped refine the film music vocabulary with such facility it has become the lingua franca of the medium. For if this much-maligned art form has a common vocabulary at all it is that brand of freely connected, non-linear tonal 7ths, 9ths and 11ths, parallel chords, passing chromatics, added to this the tradition of modal folk Americana." I’m not sure I completely understand and/or agree with Woodford’s elaborations but I think the real essence of Friedhofer’s art is that he strikes some deeper chord of intensity, sincerity and wonder representing the finest aspects of his musical character and the art form he has graciously enriched.
Editor’s note: Page Cook’s real name was Charles Marc Boyer (1944-1994). Friedhofer’s letter dated 16 June 1975, sent to Cook after receiving an advance copy of the FIR review, is worth citing in part - “Hearing [the score] again, some months after the fact, I scarcely recognize it as being something of mine. I divested myself of all scruples and just let the music drift along, guided by the pictorial image. Fortunately, some purely subconscious logical process (incomprehensible to me) keeps the thing glued together. What, exactly, brought it about is considerably beyond me.”