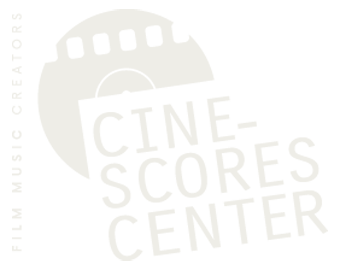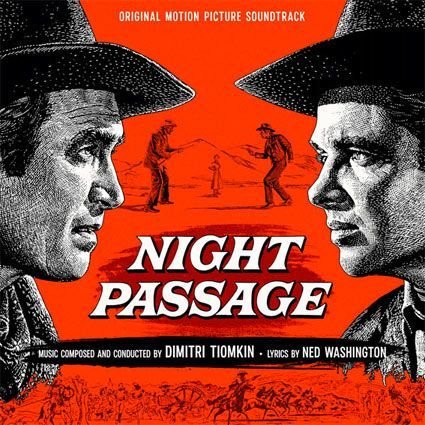Providence

'Providence' traite de la création littéraire vu à travers le point de vue de l'écrivain. Pour ce drame très psychologique et 'cérébral', le réalisateur Alain Resnais a fait appel à des acteurs américains et anglais pour tourner son film. C'est l'excellent John Gielgud qui interprète le rôle de l'écrivain Clive Langham, un vieil homme tourmenté par sa maladie, souffrant seul dans son lit en pleine nuit. Pour tenter de combattre sa maladie, l'écrivain va imaginer une nouvelle histoire où il ferait intervenir des membres de sa propre famille ainsi que sa femme Helen, morte il y a plusieurs années après s'être suicidé. Troublant, le récit imaginaire de Langham prend vie dans l'esprit de Langham, l'alcool ne faisant qu'empirer les choses. Langham est un bourgeois matérialiste qui montre son côté vulgaire au travers de son agonie, mais à travers les flash-back astucieusement entretenus par ce nouveau récit dont il compte extraire un dernier livre, Langham dévoile des éléments de sa propre vie et mélange réalité et fiction. Resnais entretient le récit d'une manière fort déroutante à tel point que le spectateur finit par se demander s'il est dans le réel ou le fictif. Langham montre une vision fort inquiétante des membres de sa famille en développant l'intrigue avec Claude (Dirk Bogarde), un avocat ambitieux qui sait que sa femme Sonia le trompe (Ellen Burstyn) avec Kevin Woodford (David Warner) et qui commence à le supporter de moins en moins, projetant même de le tuer. L'époque dans laquelle se déroule l'histoire est floue, on ne sait pas vraiment dans quelle époque l'écrivain base son récit. Le seul élément dont nous disposons est la présence d'une dictature militaire et de quelques scènes de camp de prisonniers qui ne sont pas sans rappeler le régime Nazi. Le reste du récit se déroule de manière fort troublante avec un agencement d'éléments parfois farfelue, issu de l'esprit torturé d'un écrivain en train d'agoniser. La dernière partie du film nous permet finalement de découvrir les véritables Sonia, Claude et Kevin, ces deux derniers étant ses propres fils. Mais même à la fin du film, on se demande s'il s'agit de la réalité ou bien d'un nouveau récit inventé par l'auteur? Avec cette double couche de narration, 'Providence' maintient le spectateur en haleine jusqu'à la fin et ce malgré quelques longueurs. Alain Resnais analyse avec brio le processus de la création littéraire, comment une histoire germe dans l'esprit d'un artiste, comment sa propre vie familiale et ses propres expériences peuvent influencer ses oeuvres, comment sa sensibilité peut se révéler à travers des éléments déformés du récit ou des fantasmes, etc. en adoptant le point de vue d'un artiste agonisant, Resnais filme la création littéraire d'une manière fort originale et fort astucieuse. On pourra reprocher au film de traîner un peu en longueur, mais le résultat est à la hauteur de nos attentes: 'Providence' s'affirme comme étant l'un des grands classiques du cinéma français de la fin des années 70.
Après avoir fait appel à des acteurs anglais et américains, Resnais a tenu à ce que le grand Miklos Rozsa participe à son film. Alain Resnais peut se vanter d'avoir collaboré avec l'un des derniers grands compositeurs romantiques, perpétuant ainsi la tradition d'un musical postromantique devenu totalement anachronique en 1977 (un peu comme le classicisme d'un Richard Strauss dans les années 1930/1940). Le score de Rozsa pour 'Providence' est une grande partition symphonique sombre et inquiétante, une partition axé autour d'un thème principal reposant sur un rythme quasi funèbre, comme si l'idée de la mort planait sur cette musique. Ceci est d'autant plus marquant que nous sommes en 1977 et que Miklos Rozsa est alors âgé de 70 ans et qu'il ne lui restera plus que 18 ans à vivre avant sa mort en 1995. La musique de 'Providence' se trouve centré autour de la fameuse 'valse crépusculaire', thème principal du score sous la forme d'une lente valse funèbre. Ce thème confié à un orchestre dense et dramatique à la fois évoque le déclin de l'auteur et le tourment de son récit. Cette 'valse crépusculaire' s'ouvre au son d'harmonies plutôt dissonantes évoquant l'ambiance funèbre du score, et qui renforce l'atmosphère déjà si troublante du film.
Avec les orchestrations denses traditionnelles du compositeur, la musique de 'Providence' aborde un ton sombre et noir très proche des partitions thriller/suspense que le compositeur avait écrit dans les années 40/50 (on pense à 'Spellbound', 'Double Indemnity' ou bien encore 'The Killers'). Il est assez amusant de remarquer à quelle point l'approche de Rozsa sur 'Providence' est essentiellement noire et tendue, comme si le compositeur avait vu ce film sous la forme d'un thriller/film noir à l'ancienne. Effectivement, on ressent par moment dans le récit ce côté noir mais c'est véritablement la musique de Rozsa qui transforme ce film en une sorte de polar au scénario complexe et tortueux, inventé par un écrivain malade en train d'agoniser. Le thème principal funèbre domine l'ensemble de la partition, notamment à travers d'excellentes variantes orchestrales comme cette version poignante que le compositeur a écrit pour piano et orchestre. Parfois plus dramatique, la musique de Rozsa conserve ce ton irrémédiablement sombre en évoquant par moment la romance naissante entre Sonia et Kevin, le tout baignant dans un classicisme d'écriture quasi anachronique pour l'époque (un peu comme dans 'Time After Time'), un classicisme d'ailleurs fort étonnant pour un film français de ce genre, preuve de l'ouverture d'esprit du réalisateur. La musique poursuit ainsi sa route jusqu'à la dernière vingtaine de minutes du film où le score semble changer radicalement de ton pour nous offrir une atmosphère pastorale et bucolique en totale contradiction avec la noirceur du reste de la partition. La tension monte en passant par un bref passage d'action représenté dans 'Poursuite', lorsque le récit de Clive décrit la poursuite entre Kevin et Claude, se dernier s'étant mis en tête de l'abattre dans la forêt. On retrouve ici le style plus agressif de Rozsa (percussions, cordes et cuivres en avant, dans un style très proche de ce que fera Rozsa sur 'Time After Time'), toujours dans la lignée de ses partitions thriller des années 40, mais avec une plus grande maturité d'écriture.
Plus de tension, plus de suspense et plus d'idée de mort ci. Dans 'Le Jardin Public', Rozsa fait virevolter ses vents comme le fit Ravel dans une oeuvre comme 'Daphnis et Chloé' lorsqu'il évoquait l'arrivée du matin. Avec un ton plus paisible et naïf, 'Le Jardin Public' semble faire disparaître toute trace de noirceur comme si Clive Langham se retrouvait soudainement au paradis, en compagnie de ses enfants. Cette vision soudainement plus naïve et innocente a de quoi troubler, surtout lorsqu'on sait par où est passé la musique avant d'en arriver là. Le film se conclura finalement sur une dernière reprise de la 'valse crépusculaire', le crépuscule de l'auteur symbolisé par cet excellent thème funèbre, l'un des derniers grands thèmes d'un compositeur devenu maître de son art depuis très longtemps. Si 'Providence' n'est certainement pas LE chef d'oeuvre de Rozsa (sa partition obtint néanmoins l'Oscar de la meilleure musique en 1978), il n'en demeure pas moins un score de référence dans la fin de carrière du compositeur, toujours au sommet de son art à 70 ans. Le classicisme d'écriture de la musique semble transposer le récit inventé par Clive Langham vers une toute autre époque, mais c'est pour mieux marquer le côté intemporel de la création littéraire (rajoutons à cela le fait que l'époque de l'histoire est incertaine). Une partition noire, sombre, dramatique et finalement très émouvante, dans laquelle le compositeur rend un bel hommage à ses anciennes partitions thrillers des années 40!