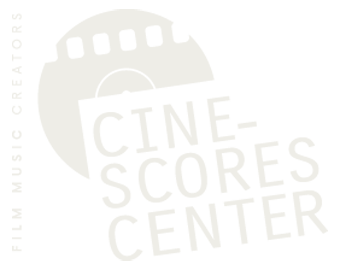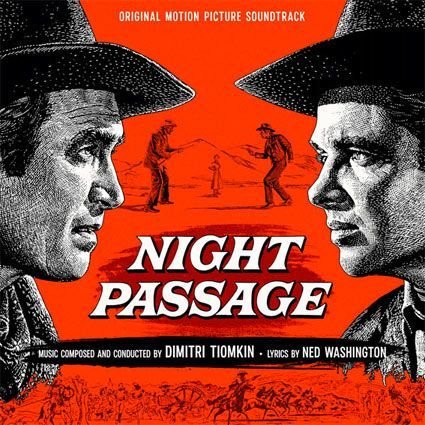Il est difficile d'imaginer une personne plus sociable que Bronislau Kaper. À côté de lui, la façon dont les autres abordent la vie semble désespérée. Il s'y précipite apparemment avec une joie presque sans limite et un enthousiasme suffisant pour toute une entreprise. Pour faire la fête, il suffit de Bronislau Kaper et de quelqu'un d'autre. Son enthousiasme suffit à faire couler le champagne. Son visage slave et acéré est dominé par de grands yeux pétillants et un large sourire sert de véhicule à son rire souvent franc qui éclate en éclats contagieux. L'accent européen de Kaper transforme les "th" en "zeh" et il parle rapidement. Les anecdotes accumulées au fil des ans se succèdent sans difficulté ni hésitation. Il est une combinaison intéressante du charme du vieux monde et de l'homme du présent et peut-être même de l'avenir ; si jeune dans son apparence et ses manières, qu'à la moitié de son âge, j'avais tendance à me sentir deux fois plus âgée que lui qui a 70 ans.
Entretien avec Bronislau Kaper
Quand vous étiez un jeune homme...
Vous voulez dire quand j'étais un très jeune homme. Parce que je me sens comme un jeune homme maintenant.
Eh bien, bien sûr, c'est considéré comme acquis.
Naturellement. Merci.
Quelles étaient vos aspirations musicales lorsque vous avez finalement décidé que c'était ce que vous vouliez faire de votre vie ?
Mes aspirations n'étaient pas ce que je fais - pas ce que je faisais, vous savez. Mes aspirations étaient plus élevées, être un compositeur de musique légitime. Peut-être un pianiste de concert, ce que j'ai abandonné rapidement, mais en tout cas ce n'était pas d'écrire de la musique pour des films. En fait, je suis diplômé en droit à Varsovie.
En effet.
Vous le savez aussi ? (Rires). J'ai peur que toute cette interview soit inutile, parce que je pense que vous en savez plus sur moi que je ne peux m'en souvenir, parce que j'ai trouvé que les gens qui écrivent des livres font tellement de recherches. Ils me chantent parfois des thèmes de mes partitions que j'avais complètement oubliés. C'est fantastique, j'admire vraiment cela. Quoi qu'il en soit, étant issu d'une famille juive polonaise bourgeoise de Varsovie, j'ai dû faire des études supérieures parce que c'était la coutume. Il fallait être soit avocat, soit ingénieur, soit médecin. C'était les trois choses. En fait, cela existe aux Etats-Unis, ce sentiment d'un certain préjugé, vous savez.
J'ai failli devenir ingénieur.
Vous voyez ! Vous connaissez l'histoire célèbre en Amérique de la mère avec ses deux garçons - vous connaissez cette histoire ?
(Rire) Oh oui, oui. Elle les présente, « Le petit de 7 ans est l’avocat et le petit de 9 ans est… »
Le médecin, oui. C’est la même histoire. Quoi qu’il en soit, pour satisfaire mon père qui, après tout, a dépensé de l’argent pour mes études, j’ai obtenu un diplôme de droit. Mais en même temps, j’ai fait le conservatoire, vous savez. Piano et composition. C’était très fatigant parce qu’en même temps que je passais mon diplôme de droit, deux semaines plus tard je devais jouer le concerto de Chopin. Je ne me suis jamais vraiment remis de cet effort… (Rires).
Je suppose que tout ce qui s’est passé depuis n’est que du bonheur, non ?
C’est vrai. Tout est facile, oui. Je n’étais pas trop intéressé par l’université et heureusement que j’étais un bon élève parce que les choses sont venues facilement. J’étais l’étudiant numéro un à l’école, pas dans ma classe - à l’école. C’était embarrassant parce qu’ensuite j’ai dit : « Bon, d’accord, je vais continuer « , comme l’histoire de Paderewski, vous savez. Lorsque Paderewski a donné une interview et qu’il a dit aux journalistes : « À l’âge de 35 ans, je me suis déjà rendu compte que je n’avais aucun talent pour le piano. « Alors ils ont dit, « Pourquoi ne pas avoir arrêté ? ». Il a répondu : « C’était trop tard. J’étais déjà célèbre. » Je n’étais pas célèbre, mais j’étais établi meilleur élève de l’école. Et le droit était très facile pour moi aussi parce que je ne le prenais pas trop au sérieux. J’ai obtenu mon diplôme à l’âge de vingt-deux ans et demi. J’étais donc vraiment très instruite à cet âge. J’aurais aimé pouvoir conserver certaines de ces connaissances jusqu’à aujourd’hui…
Avez-vous commencé à écrire de la musique de théâtre en Pologne ou lorsque vous êtes allé en Allemagne et en France ?
Quand j’étais en Pologne, je devais gagner de l’argent, alors j’enseignais… J’enseignais les mathématiques, le latin… tout ce que j’apprenais, je l’enseignais à quelqu’un d’autre, pour ne pas gaspiller mes études. Un de mes amis est venu me voir et m’a dit : « Écrivons des chansons ». Il y avait deux cabarets à Varsovie, alors on a commencé à écrire des chansons. Chaque soir, nous devions nous présenter à la caisse du cabaret pour toucher les droits d’auteur.
C’était B.A. - Avant A. S. C. A. P.
Avant A.S.C.A.P. ; c’est vrai ! J’ai commencé à composer de la musique sérieuse au conservatoire. Des chansons ont été programmées, de la musique pour piano. J’ai écrit ce qu’on appelait des chansons à caractère artistique, des lieder et tout ça. Mais ensuite, j’ai décidé que ce n’était pas suffisant, alors je suis allé à Berlin pour y poursuivre mes études. Je pensais qu’à Berlin, j’apprendrais davantage, et je dois dire que j’ai beaucoup appris sur la théorie et la composition, mais pas sur le piano. J’ai découvert que le niveau de piano en Pologne était bien plus élevé qu’à Berlin. Comme vous pouvez le voir aujourd’hui, les grands pianistes viennent tous de Pologne et jouent magnifiquement bien.
Pendant les six années passées à Berlin, j’ai fait ce que j’appellerais une carrière de compositeur dans le cinéma. Je suis devenu un auteur de chansons très connu à Berlin. Je me suis lancé dans le cinéma. J’ai vu Hitler dans sa Mercedes-Benz. Je me suis marié avec une Russe. Tout ça en six ans. C’était fantastique. Et j’ai rencontré à Berlin un lyricist très célèbre, Fritz Rotter, qui a écrit beaucoup, beaucoup de grands succès, ‘I Kiss Your Little Hand Madam’, ‘White Lilacs’… Nous sommes devenus des amis très proches, nous avons commencé à écrire des chansons et nous avons eu beaucoup de succès. Nous avions l’habitude de publier deux chansons par jour.
Mon Dieu !
Oui, oui. Nous avons écrit deux chansons, sommes allés chez l'éditeur et avons obtenu une avance. Nous conduisions une belle Cadillac décapotable (ça montre le succès qu'il avait) et j'ai acheté un appartement.
Puis j'ai rencontré de grands chanteurs comme Richard Tauber, pour qui j'ai écrit de nombreuses chansons pour des films. Et le succès suivant a été avec Jan Kiepura. Le dernier film que j'ai fait à Berlin était avec lui. Déjà Hitler nous regardait, vous savez, et les choses devenaient très chaudes. Nous avons tout vendu et le jour où j'ai terminé le dernier enregistrement pour le film de Kiepura, nous sommes partis à Paris. Et à Paris, j'ai encore eu de la chance, j'ai échappé aux mauvaises choses et les bonnes sont arrivées.
C’était en quelle année ?
31, 30, 32… Je ne sais pas. Ne me demandez pas en quelle année. Je suis assez bête quand il faut y penser. Je me souviens de la cravate que les gens portent, ou des lunettes. Je me souviendrai de vos montures… elles ressemblent un peu aux miennes. J’ai commencé les films, l’un après l’autre, puis Louis B. Mayer est venu à Paris à la recherche de bonnes affaires et m’a trouvé parce qu’il avait entendu cette chanson que j’avais écrite pour Kiepura, « Ninon, Smile At Me Again « ; partout - Vienne, Paris, Berlin. Alors il s’est dit : « Ah-hah ! ».
Une affaire.
Il m’a trouvé, j’ai joué pour Mayer, il a fait des gestes étranges avec ses mains que je n’ai pas compris (je ne parlais pas anglais !)… Il a coupé sa main en deux ; il voulait dire aux autres personnes qui l’accompagnaient que la moitié de mon salaire serait déduite de mes royalties. Vous savez, un de ces accords qui ont été modifiés par la suite. Nous (avions) toujours parlé d’Hollywood. Je n’oublierai jamais l’idée que nous avions tous que tout le monde avait un « bungalow ». Cela semblait si terriblement exotique, vous savez. Nous avions tous l’impression que nous allions nous promener avec des chapeaux blancs, en shorts trois-quarts, avec des cannes à la main.
Et déjeuner en plein air sur des divans.
Oui, avec Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Clark Gable. J’appelle Gable et je dis : « Hé, Clark ! Viens déjeuner », Garbo « Que fais-tu pour le thé ? ». En fait, avant que j’y aille, deux de mes collègues y étaient déjà allés. Franz Waxman y est allé avant moi. J’ai oublié qui l’avait engagé. Je pense que Joe May, un réalisateur qui est venu en premier à Hollywood et a amené Billy Wilder avec lui. Joe May était un homme très étrange. Fou, vous savez, mais fabuleux - un vrai génie du cinéma. Un jour, Billy Wilder m’a raconté qu’il avait reçu un télégramme de Joe May lui disant : « Viens à Hollywood ! Aux studios Universal. Apporte deux caisses de vin Rose Anjou et trois bidets ! ». Je ne l’oublierai jamais. Billy et moi étions au Café Select et il m’a montré le télégramme. Je n’y croyais pas. Je dois vous dire la vérité, je ne savais pas qui était Louis B. Mayer, car la Metro-Goldwyn-Mayer n’était pas connue à Paris. On ne connaissait que deux noms : Paramount et Fox. On ne savait pas que la MGM était la plus grande ! Et Louis B. Mayer était…
Le plus important.
Le plus important. Oui, la plus importante personne de tout... Mais je dois dire que Louis B. Mayer a sauvé ma vie, ma famille. Grâce à lui, j'ai pu faire venir mes proches de Pologne. Quoi qu'il en soit, les six premiers mois ont été charmants, et Mayer était très gentil. On a d'abord eu un film appelé ESCAPADE. Myrna Loy a refusé de jouer le rôle et Louise Rainer l'a emporté. Vous vérifiez ma liste de films ? (Rires, tandis que je scrute mes notes).
Il y avait un court métrage intitulé TWO HEARTS IN WAXTIME.
C'est le nom du court-métrage ? Vous voyez bien ! Je ne connaissais pas ce court métrage. Je n'oublierai jamais ESCAPADE parce qu'en Europe, vous faisiez tout, vous n'aviez pas d'argent pour les spécialistes. Quand vous avez fait un film, vous avez fait les chansons, vous avez fait la partition et vous avez dirigé l'orchestre. Et pourtant, je n'aime pas diriger. Je ne l'ai jamais fait.
Pourquoi pas ?
Tout d'abord, quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot d'anglais. Comment faire comprendre à un orchestre ce que l'on veut ? Ce serait une énorme perte de temps. Il faudrait que je consulte un dictionnaire ou que je fasse appel à un interprète, vous savez. C'est une terrible perte de temps. J'en suis venu à la conclusion qu'un chef d'orchestre qui se concentre sur la technique de la direction d'orchestre et qui saisit les repères...
Cela vous soulagerait.
Oui - je suis dans une cabine de contrôle et j'écoute en même temps la musique et les dialogues, et j'ai une image complète du résultat final en doublage. Ainsi, lorsque j'arrive dans la salle de doublage, après avoir entendu ma musique avec les dialogues sur la scène, et en connaissant les possibilités : A quel volume puis-je la jouer ? Cet endroit est-il bon ? Je change parfois d'endroit quand je suis assis à l'étage. Si vous dirigez vous-même et même si vous le rejouez, vous le jouez fort parce que vous voulez vous impressionner... et parfois le producteur. Il faut aussi jouer sa musique fort, parce que c'est la dernière fois qu'on l'entend fort. Il y a une histoire. Vous écrivez un morceau de musique, puis vous l'entendez avec l'orchestre. C'est fantastique. Sur la scène. Tellement génial. Et puis après ça, vous allez dans la salle de doublage...
Et c'est trois fois rien.
Rien. Donc ça commence par rien et ça finit par rien. De cette façon, au moins, je sais ce qui va se passer. Je n'ai pas de surprises, pas d'attaques cardiaques.
Donc vous avez supprimé cette étape angoissante.
C'est vrai. Et les résultats sont meilleurs. C'est ce que je pensais. Et je me suis habitué à ça. Et je connais tellement de chefs d'orchestre de cinéma qui sont bien meilleurs que moi. J'ai eu des chefs d'orchestre formidables pour mes films. J'ai eu des gens comme Johnny Green, qui était à la tête du département musical de la MGM.
C'est aussi un merveilleux compositeur, mais il n'en a fait que très peu.
Malheureusement.
RAINTREE COUNTY est un score merveilleux.
Merveilleux ! C’est une histoire très intéressante car j’ai eu une longue conversation avec John dans son bureau et je lui ai dit que « … votre problème est que vous ne composez pas assez. Vous êtes tellement occupé à être le responsable exécutif du département que vous, en tant que compositeur, avez soudainement un coffre vide. Et je pense que c’est très mauvais pour vous parce que vous êtes un compositeur. » Et il a pris cela très, très à cœur - très sérieusement. Il a donc décidé de demander à faire ce film et, en tant que chef du département, ce ne fut pas trop difficile. Et je pense que c’est une partition merveilleuse ! Nous avons parlé de la direction d’orchestre parce que j’ai dit qu’en Europe, vous deviez tout faire. Ici, ce sont des spécialistes. Et quand j’ai fait le premier court métrage, j’ai écrit les chansons parce que j’écrivais des chansons. M. Mayer m’a signé à cause de « Ninon » ; il ne s’est pas soucié de cette autre chose. J’ai donc commencé à écrire des musiques de scène. Le chef du département m’a appelé et m’a dit : « Vous êtes fou, ce n’est pas votre travail. Tu es un auteur de chansons. Nous avons un compositeur pour le faire.
La bonne vieille méthode américaine du pidgeon-holing.
C’est vrai. Puis, après un certain temps, ils ont découvert que je pouvais écrire des partitions. Alors je regardais le script et je commençais à penser à la partition et j’ai écrit la chanson parce qu’il y avait une scène dans le bar. Et ils m’ont appelé et m’ont dit : « Vous êtes fou ! Vous êtes compositeur. On va demander à un auteur-compositeur d’écrire une chanson pour toi. » Donc j’étais soit un auteur de chansons qui ne savait pas écrire une partition, soit un compositeur qui ne savait pas écrire une chanson ! Eh bien, je les punirai plus tard - j’ai écrit les deux.
ESCAPADE était un film avec Louise Rainer et William Powell et il y avait une chanson, ‘You’re all I need’. Je ne le croirais pas aujourd’hui, mais la chanson a été numéro un au hit-parade de Lucky Strike. J’étais si naïf ; je ne savais même pas ce que cela signifiait. Jack Robbins, l’éditeur, est venu me voir et m’a dit : « Vous avez la chanson numéro un sur Lucky Strike ! » (Une émission de radio hebdomadaire qui célébrait les dix plus grands succès de la chanson.) Je ne parlais pas bien l’anglais. Je savais que Lucky Strike était une cigarette, mais je ne voyais pas le rapport entre la cigarette et ma chanson. Quoi qu’il en soit, j’ai eu de la chance - j’ai eu ce premier succès. Et puis il y a eu ‘San Francisco’ (qui) était naturellement un grand, grand moment.
Avez-vous aussi fait une partie de la partition pour ce film ? (Herbert Stothart était le directeur musical. Les crédits semblaient curieusement se brouiller à l’époque).
Non, juste la chanson. En fait, il y avait deux chansons. Vous voyez, à cette époque, ils avaient des auteurs sous contrat comme (Arthur) Fried et (Nacio Herb) Brown. Ils ont écrit une ballade appelée
‘Would You ?‘. Ils avaient le choix parce que c’étaient des gens importants. Ils ont naturellement pensé que la ballade pouvait être un grand succès. L’autre chanson est une sorte de chanson particulière, alors ils ont dit, « Laissez cet étranger écrire cette chanson particulière » parce qu’ils pensaient, « Qui peut écrire une chanson aussi embarrassante, une chanson entraînante. Mais surtout, nos éditeurs nous ont appris que seules les ballades peuvent se vendre. Aucune musique qui a un caractère entraînant (‘Dai Di’) ne peut se vendre. Il faut un ‘Bum!’ sur le contretemps. Aucun air mineur ne peut se vendre - oh, beaucoup d’autres choses. Bref, quand j’étais à Paris, à Berlin, mes chansons étaient très américaines… je pensais. Et ils le pensaient aussi. Parce que. J’aimais la musique américaine. Je jouais Gershwin, Jerome Kern, Vincent Youmens, et Arthur Schwartz. Tous ces gens étaient nos idoles. Alors ils disaient de moi, « Kaper est très talentueux mais vraiment trop américain. » Alors je suis venu ici et j’ai dit, « Ah-hah ! Maintenant… »
Parfait.
« Maintenant je vais leur montrer ! ». Quand j’ai écrit
‘San Francisco‘, j’étais sûr que c’était une chanson moderne. J’étais tellement naïf, vous voyez. Je pensais vraiment que c’était
‘Sophisticated Lady‘ de Duke Ellington. Eh bien, nous savions que ce n’était pas le cas, mais je ne le savais pas. Mais parce que j’étais si naïf, en toute bonne foi, ça correspondait si bien à l’époque. Parce qu’aucun Américain n’aurait osé l’écrire. Il aurait un peu honte d’écrire, «Dam, bam bah-bah…» Vous imaginez Jerome Kern l’écrire, ou Gershwin ? Non ! Ils préféreraient mourir - et ils sont morts.
(Rire) Et vous êtes toujours là. Et ça semble être un tel classique, même à l’époque on aurait dit qu’il existait depuis des années et des années. Herbert Stothart a donc été chef du département musical (de la MGM) pendant une vingtaine d’années.
De facto, oui - mais pas en fonction du titre. Herbert Stothart était juste un indépendant. Il a été le meilleur compositeur de films de la MGM pendant de nombreuses années. Les producteurs et les cadres supérieurs l’adoraient, vous savez. Il était ce qu’ils appelaient un « showman », un mot magique.
C’était un mot tangible qu’ils pouvaient traiter, n’étant pas musiciens.
Ils ne l’ont pas fait, c’est vrai ! Pour eux, c’était facile à comprendre. Ils ont dit : « Je me fiche de savoir s’il lit bien la musique, s’il peut le faire, laissez-le faire ce qu’il veut - c’est un showman ! ». Il fait du spectacle. Et je l’ai adoré. De beaux yeux bleus, un visage rouge. Il avait une si grande personnalité au studio. Quand il enregistrait, c’était vraiment un showman. Une main couvrait l’oreille gauche ; voici un écouteur qu’il tournait dans les deux sens. Tout était différent mais fantastique. Je regarde aujourd’hui les vieux films avec ses partitions et il savait quand frapper l’accord fort ; il savait quand arrêter la musique. Nous avons tous beaucoup appris de lui, vous savez. Aujourd’hui, nous pourrions dire que c’est du schmaltz, mais nous avons quand même beaucoup appris sur le plan dramatique. Il y avait un autre homme appelé William Axt…
Il a commencé plus tôt dans le monde du cinéma.
En même temps. C’était avant Stothart, mais aussi (la) même époque. Comme Verdi et Wagner. Axt était un type différent. Un homme calme, pas un showman, pas d’yeux bleus, pas de tension élevée. Très bien formé, mais pas de personnalité brillante. Il y avait un film intitulé AT THE BALALAIKA et Stothart ne voulait pas le faire… peut-être était-il occupé. Axt y a été affecté et c’était un gros film. Les producteurs ont dit, « Nous avons besoin d’une chanson, quelque chose comme ‘Volga Boatman’. » Alors il a dit, « laissez-moi regarder autour de moi, » et une semaine plus tard ils ont une réunion et il dit, « J’ai la chanson… je pense. » Il leur joue la chanson et à la fin il y a, un silence, un silence. (Vous savez déjà ce que cela signifie). « Oui, Bill, c’est très bien mais tu sais que ce n’est pas ‘Volga Boatman’. » Alors il dit : « Eh bien, je vais réessayer. » Environ deux semaines plus tard, il joue une autre chanson. « Très bien, très bien. Mais vous savez… il manque quelque chose. Ce n’est pas Volga Boatman. » Cela a duré trois semaines. Finalement, ils ont dit : « Appelons Herb Stothart. Il aura peut-être une idée. Et il arrive - toujours un peu en retard - « Désolé les gars, je suis en retard ! ». Ils lui présentent la situation. Herb écoute, puis dit : « Pourquoi ne pas utiliser ‘Volga Boatman’ ? » Tout à coup, tout le monde était soulagé et heureux, « Oui, pourquoi ne pas utiliser ‘Volga Boatman’ ! ». Vous voyez, ils le voulaient vraiment mais ils étaient gênés de le dire. Et encore une fois, ils disent : « Vous voyez ? Vous voyez Herb Stothart ? Showman ! » Et le pauvre Billy Axt n’était plus dans le coup.
En plus de cette réminiscence, est-ce qu’ils sont déjà venus vous voir pour vous demander de leur donner quelque chose comme le dernier film que vous avez fait ?
(Un peu gravement). Oui. Oui. « Nous avons besoin de quelque chose comme ‘Hi-Lili, Hi-Lo’ ». Je l’ai entendu plusieurs fois. Mais je n’ai pas pu l’écrire. (Rires). La pire chose est arrivée quand ils avaient l’habitude de «bidouiller» les avant-premières. Vous savez, ajouter une partition temporaire. Ils prenaient quelque chose dans la bibliothèque et l’inséraient, afin d’économiser de l’argent, de sorte que plus tard, lorsque le film était coupé, vous n’aviez pas à changer la musique. Il y avait un homme spécial qui connaissait la bibliothèque et mettait la musique en conserve dans le film pour l’adapter d’une manière ou d’une autre. Très souvent, les producteurs, après avoir entendu la musique en conserve pendant quatre avant-premières, s’y sont tellement habitués que lorsque vous avez finalement écrit (une) partition originale, ils ne l’ont pas aimée. Vous voyez, il y a une magie dans le lien entre la musique et le film. C’est le secret pour lequel les gens vont acheter de la musique de films.
Cela fait revenir le premier souvenir d’un film.
C’est la même chose pour le producteur, le réalisateur qui voit quatre fois la musique jouer « Da-Ri, Da-Ri » - et vous jouez « Ti-Ra, T-Ra ». Eh bien, vous avez tort ! Il faut donc être très prudent. Une fois, j’ai fait un film où ils ont utilisé un morceau d’Offenbach dans le générique… A FLEA IN HER EAR… et j’ai su que j’avais des problèmes. Alors j’ai dit : « Utilisons l’Offenbach ». Rien ne peut être aussi bon qu’Offenbach. » Alors tout de suite ils viennent tous, « Oh, non, non - tu peux écrire ! » Vous savez ce qui m’a sauvé ? Ils devaient payer pour Offenbach. Pas dans le domaine public. Ça leur coûterait environ trois mille dollars. J’ai insisté, mais ils ne voulaient pas céder. Et maintenant, quand j’écrivais ma musique, ils devaient l’aimer !
Beaucoup de vos chansons et de vos thèmes sont très simples. Vous ne vous lancez pas dans des constructions très élaborées.
La seule qui était compliquée était INVITATION.
Vous avez beaucoup utilisé ce thème : romantiquement, avec nostalgie, avec un peu d’anxiété.
Vous connaissez l’histoire de cette chanson ? Eh bien, nous avons fait un film intitulé A LIFE OF HER OWN avec Lana Turner et il y avait une scène dans un bar où quelqu’un devait jouer un morceau de musique. Le réalisateur était George Cukor et Johnny Green était le chef du département. Ils ont dit : « Que pouvons-nous utiliser dans le bar ? Peut-être une valse de Chopin ou autre ? » J’ai dit, « Pourquoi la valse de Chopin, pourquoi je n’écrirais pas un morceau ? » Alors ils se sont regardés d’un air méfiant, « O.K., tu veux écrire un morceau ? Fais une compétition avec une valse de Chopin. » Je dis : « Oui, j’écris un morceau. » Je commençais déjà à être en forme à l’époque.
Vous étiez là depuis quelques années.
Oui, je ne voulais pas laisser passer une chance d’écrire. Une semaine plus tard, on s’est rencontrés et ils ont dit timidement : « Tu as une idée de ce que tu vas écrire ? » J’ai répondu : « Je l’ai déjà écrit. » Et j’ai joué : « Dah-Dah Dee-Dee, Dah Dee Dah Dah - Dah Dah Dah »… A LIFE OF HER OWN… Ils l’ont beaucoup aimée et elle était dans le film dans une scène jouée au piano par Jakob Gimpel, un grand pianiste, un de mes amis qui la joue encore. Le film a été un désastre complet, vous savez, mais nous avons commencé à recevoir des appels. Très peu de temps après, ils ont fait un film avec Dorothy Maguire et nous avons décidé de la mettre dans ce film. C’est pourquoi je l’ai utilisé si souvent : parce que je savais déjà que j’avais quelque chose. Et dès que nous avons fait ce film, nous avons immédiatement enregistré cinq ou six disques ; Percy Faith, Victor Young, et d’autres. Et comme le film s’appelait INVITATION, nous avons appelé la chanson « Invitation ». Après le film, Paul Webster a écrit les paroles, qui sont très belles mais que personne ne connaît.
Eh bien, cela a fonctionné à merveille parce que l'histoire était plutôt déprimante (Dorothy Maguire joue le rôle d'une femme atteinte d'une maladie incurable sans nom dont le mari l'a épousée par pitié et à la suite d'une offre d'emploi de son père) et cela a permis de garder un peu de légèreté.
Un peu d'espoir, oui. Je le dis sans prétention, mais je pense que INVITATION a lancé une certaine tendance à ce genre d'harmonies sophistiquées en matière de musique instrumentale. La meilleure preuve en est qu'elle est très difficile à jouer à l'oreille pour un pianiste moyen. Plus tard, j'ai écrit une autre chanson intitulée 'Gloria' pour BUTTERFIELD 8, qui reprend un peu de ce style. Vous savez, j'aime quand vous avez un long film, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui se passent, tellement de couleurs et tellement de changements dans le temps ; les gens mûrissent dans le film et ils traversent tellement de choses. J'ai eu un plaisir fou à écrire la musique de GREEN DOLPHIN STREET - j'ai vraiment adoré travailler. Chaque petite séquence, un carrosse qui arrive en ville, je jouais avec, j'improvisais presque. Je pouvais jouer le genre de musique que je voulais.
J'ai eu du mal à convaincre certains amateurs de jazz qu'il ne fut pas écrit comme un morceau de jazz.
(Ssourire) Je sais ...
C’est devenu un tel classique. Ça doit être une belle chose de voir quelque chose évoluer comme ça.
Et c’était très étrange parce que je n’ai jamais lu le magazine DOWNBEAT. Nous avions l’habitude d’organiser des réunions à la MGM dans le département musical et André Previn faisait partie de l’équipe et il était généralement assis là à lire le magazine DOWNBEAT. Et soudain, il me chuchote : « Miles Davis a enregistré GREEN DOLPHIN STREET ». Alors j’ai dit, « Et alors ? ». Il me dit, « Ca veut dire que dans les trois prochains mois tu auras cinquante enregistrements de GREEN DOLPHIN STREET. » Et c’est là que ça a commencé.
GREEN MANSIONS est un film assez étrange... Comment est venue l'idée de travailler avec Villa-Lobos ?
C‘est un peu une histoire de la CIA… (Rires). Mel Ferrer était le réalisateur du film et je pense que c’était une sorte de démarche politique parce qu’il était marié à Audrey Hepburn. À l’époque il n’était pas un réalisateur connu ou bon, mais c’était une affaire de famille ; donner un peu, prendre un peu… Il a rencontré Villa-Lobos et a entendu une partie de sa musique et comme certains réalisateurs qui ont des idées préconçues, il doit avoir la musique de Villa-Lobos. Lorsque la MGM a décidé de le faire, alors Mel les a convaincus, les a persuadés d’acheter de la musique de Villa-Lobos. Un « deal amateur » typique, car comment acheter de la musique ? Vous ne savez pas ce que vous achetez ! Vous ne savez pas ce que vous allez jouer dans le film ; quelle quantité vous allez utiliser ; qui va le faire.
Puis le film a finalement vu le jour et ils ont dit : « Eh bien, M. Lobos, quand allez-vous venir faire le film ? » Il répond : « Moi, venir faire un film ? Je ne fais pas de musique pour un film ! Je vous donne ma musique et vous la mettez dans votre film. » Très fièrement, mais très bêtement. Il n’aurait pas su par où commencer. Maintenant, les gros problèmes. Sol Siegel, le directeur du studio, est venu me voir et m’a dit : « Ecoutez. Voilà la situation, on veut que tu fasses le film. » Alors j’ai dit : « Je ne veux pas faire un film avec Villa-Lobos. Utilise sa musique et trouve un arrangeur. » Il a dit : « Non, non, non. Vous faites la partition. Tu utilises autant de sa musique que tu veux, juste pour garder le contrat. »
Le résultat a été que j’ai écrit la partition, et mon crédit disait, « Partition musicale par Bronislau Kaper, musique additionnel par Villa-Lobos, chanson par Bronislau Kaper et Mack David » - vous savez, la chanson (chantée) par Tony Perkins. M. Lobos est venu à Hollywood et il m’a jeté le plus mauvais des regards - avant même que je fasse le film. Déjà le fait que je touche à sa musique sacrée l’a fait me détester. On a fait une photo. Je souriais et lui ne souriait pas.
Vous n’avez fait qu’un seul film de science-fiction appelé THEM ! Il est sorti au milieu des années 50 et vous l’avez traité différemment de ce qui semblait être la douzaine de films de science-fiction qui sortaient chaque semaine.
Je ne l’ai pas traité comme un film de science-fiction. Je l’ai traité comme une vraie menace. Je commençais à en avoir assez des effets habituels. Je l’ai traité comme un film d’action, vous savez, « Boom-Bang ! » Vous auriez dû entendre cette musique au studio, elle était vraiment bonne. Et j’ai écrit une « Fugue » qui a été retirée du film plus tard.
Pour quelle partie ?
J’ai oublié. C’était une « Fugue pour fourmis ». Juste pour le plaisir ; je savais qu’il ne serait pas dans le film, mais je l’ai écrit pour le fun. Il m’a fallu environ quatre jours pour l’écrire. Elle est aussi très chromatique (elle imite les motifs qui ressemblent à des groupes de fourmis qui se déplacent en courant). Je me souviens que les musiciens l’ont aimée. Ray Heindorf l’a dirigée. Un génie absolu pour diriger une musique de film. Un génie absolu! C’est aussi un grand arrangeur. Quand je suis arrivé dans cette ville, Harry Warren m’a fait écouter quelques-unes de ses chansons - symphoniques, réalisés par Heindorf. C’était tellement bien que Harry Warren croyait l’avoir écrit lui-même.
Oh, mais une chose amusante est arrivée à LORD JIM. Il s’agissait de faire ce genre de musique (cambodgienne) et d’obtenir quelques instruments, et de trouver les personnes qui peuvent en jouer. Et nous étions complètement désemparés. Je ne savais pas par où commencer ! Puis quelqu’un a dit : « Je sais qu’il y a deux étudiants français qui connaissent la musique indochinoise. Ils vivent à Paris. Peut-être que nous pouvons obtenir les instruments à l’ambassade d’Indochine à Amsterdam. » Je veux dire, il y avait des nuits blanches. Je suis allé au Cambodge pour faire des recherches et écouter de la musique. Terrible. Absolument impossible. Et j’ai eu des auditions de toutes sortes de personnes, de petits groupes. La chose la plus ennuyeuse que vous puissiez imaginer. Alors je suis revenu et j’ai parlé à un de mes anciens agents, Abe Meyer, qui m’a suggéré de contacter Monty Hood, le responsable de la musique ethnique à UCLA. Je l’ai appelé et j’ai découvert qu’il me connaissait ; nous (nous) étions rencontrés chez Ernest Toch. Je suis allé le voir et il m’a emmené en bas, dans la salle des gamins. Je pensais que je rêvais. Je devais me pincer. Il y avait tous les instruments - Java, Bali, tout ce que vous voulez - sans parler de la Thaïlande. Pas le Cambodge. Mais cela ne faisait aucune différence pour moi, car le fait que nous tournions au Cambodge ne signifiait pas que l’histoire se déroulait au Cambodge. Il fallait juste que ce soit n’importe quelle partie de l’Indochine.
Donc, après les avoir tous analysés, j’ai pris certains éléments de Bali et de Java. Mais je n’ai pas vu que les instruments ; ils avaient un orchestre pour cette musique. Quarante ou trente-six personnes qui répétaient chaque semaine et qui savaient en jouer. Maintenant, je suis allé comme à l’école. Monty Hood et son assistant m’ont appris à écrire pour tous les instruments. J’ai pris des cours d’orchestration en Gamolin. J’ai écrit deux morceaux. L’un était un morceau lent, l’autre était rapide. Ils devaient jouer le soir et j’étais une froussarde : Je ne voulais pas y aller. Le lendemain matin, j’appelle : « Comment ça s’est passé ? » Il m’a dit : « Le morceau lent s’est bien passé ; le morceau rapide est impossible à jouer. » J’ai fait une erreur. Pour un instrument, je pensais qu’ils avaient deux marteaux. Ils n’en avaient qu’un. Alors je l’ai réécrit, mais j’ai appris. C’est vraiment fantastique la chance que j’ai eue de trouver ces gens après les avoir cherchés à Paris, en Hollande. Soudain, ils étaient là, sous mon nez. J’ai aimé travailler sur LORD JIM. Une grande envergure. J’ai enregistré à Londres. Un orchestre merveilleux.
Y a-t-il des films auxquels vous auriez aimé être associé ?
Oui, mais je n’arrive pas à m’en souvenir. Parfois, je vois un film et je me dis : « Mince, pourquoi je n’aurais pas pu faire ce film ? » Je ne pense pas très souvent à des films que j’aurais aimé faire, mais il y a quelques chansons. L’une d’elles est « Stella by Starlight » de Victor Young. Chaque fois que je l’entends, je me dis : « Que m’est-il arrivé ? Où étais-je ? Pourquoi je n’ai pas écrit cette chanson ? » C’est trop tard maintenant.
Qu'aimeriez-vous faire que vous n'avez pas encore fait ? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas fait ?
Oh oui ! J'aimerais écrire de la musique, de la bonne musique. Quand vous êtes dans le cinéma, chaque film prend trois mois de votre vie et vous n'avez pas le temps, non seulement de composer, mais aussi de lire, de faire quoi que ce soit. Être sous contrat dans un studio est une bonne chose pour la sécurité (si cela existe), mais cela vous rend vraiment esclave de votre profession, ce que vous ne devriez pas être.
Cela vous donne envie de découvrir tous les aspects de la musique.
Pour la liberté ! La musique, le sport, la lecture, même l’écriture de chansons. Maintenant, les auteurs de chansons sont libres. Ils se promènent, se réunissent, boivent quelques verres, fument et écrivent des chansons. C’est bien. Et quand ils sont fatigués, ils vont à Santa Barbara, ou au Mexique, ou à Las Vegas pendant deux jours. Vous ne pouvez pas le faire quand vous travaillez dans un studio. Si vous partez deux jours, même s’ils n’ont rien à faire pour vous, ils vous cherchent et disent : « Où étiez-vous ? » Est-ce une question à poser à un homme adulte ? Je pense que c’est terrible.
Vous n'êtes pas vraiment semi-retraité car vous êtes très actif personnellement.
Je ne suis pas seulement ça. J'ai des scripts à lire, des pièces à lire, des projets avec des producteurs et tout ça. Mais je vous le dis, vous arrivez à un certain moment de votre vie où vous ne voulez pas être jugé par d'autres personnes. Évalué, vous voyez ? C'est terrible. Si vous faites du cinéma, je me fiche de qui vous êtes, vous pouvez être le plus grand compositeur du monde...
Mais vous serez jugé en fonction de ce film.
Vous serez jugé pendant que vous écrivez. Vous devrez jouer pour quelqu’un, un producteur ou un réalisateur qui ne connaît rien à son métier, qui n’a jamais rien fait dans sa vie, même pas une émission de télévision - tout à coup, ils ont le droit de dire : « Je ne sais pas ce que je veux. » Maintenant, qui sont-ils pour juger mon travail ? Je n’aime pas ça, je n’en veux pas. Récemment, des gens m’ont demandé : « Pourquoi ne travaillez-vous pas dans le cinéma ? » Je réponds qu’il n’y a rien qui m’attire terriblement. Si cela m’attirait beaucoup, je céderais même un peu et laisserais les gens dire ce qu’ils pensent de ma musique (Rires).
J'espère que d'ici peu, vous trouverez un bon scénario et un bon réalisateur. Mais si ce n'est pas le cas, continuez à faire ces choses que vous n'avez jamais pu faire auparavant.
Je suis très occupé maintenant avec le Los Angeles Music Center. Je fais maintenant partie du conseil d'administration de l'orchestre symphonique et je vis dans un monde différent. Je vis dans un monde d'amis, de musiciens, où je n'ai pas besoin de baisser mon niveau. Des gens, avec qui j'ai une compréhension réelle et complète. Comme Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Zuckerman - tous ces gens... Arthur Rubenstein, qui reste l'un de mes plus grands amis. J'adore ces gens. On s'assoit, on parle et on joue.
L’important, c’est que vous vous amusiez, comme vous l’avez fait toutes ces années.
Je suis très heureux. Je ne regrette rien. Vous savez, 28 ans chez MGM, c’était très, très long. Il y avait un homme qui avait travaillé 40 ans chez Warner et un jour, il est rentré chez lui et a dit à sa femme : « Ils m’ont viré. » Et sa femme lui a répondu : « J’ai toujours su que ce n’était pas un travail stable. »
Note de la rédaction
Bien que certains mots du discours de Bronislau Kaper semblent avoir été omis, mais c'est la façon dont il parle. L'interviewer a voulu conserver cette impression.
Entretien avec Bronislau Kaper par William F. Krasnoborski
Traduction de Jean Noé
Publié à l’origine dans Soundtrack Magazine (SNC) No. 2 et No. 3 / 1975
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur, Luc van de Ven