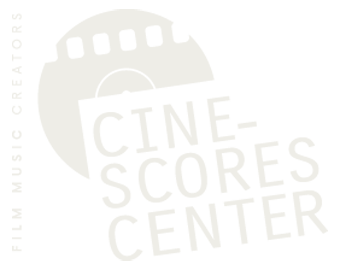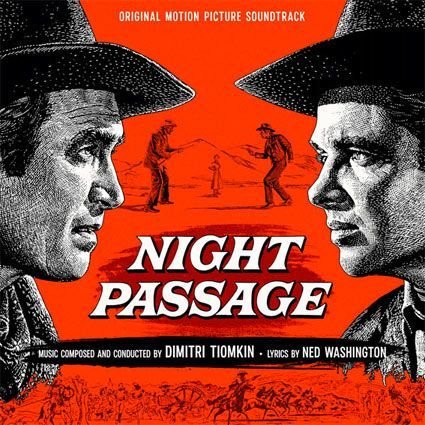Larry Cohen parle de son regretté ami

Au cours des années 70, Larry Cohen, auteur et réalisateur de films comme Q: THE WINGED SERPENT, THE STUFF ou IT’S ALIVE devint un ami proche de l’un des plus grands compositeurs de tous les temps, feu le grand Bernard Herrmann. Les souvenirs suivants sont issus d’une interview récente avec Cohen, dans laquelle il parle des relations tumultueuses entre Alfred Hitchcock et Hermann, et entre Herrmann et les studios des dernières années de sa vie :
Bernard Herrmann était comme un membre de la famille, j’étais avec lui lors de la dernière nuit de sa vie ; nous l’avons ramené au Sheraton Universal avant sa mort. Quand lui et Hitchcock se fâchèrent, c’était une époque où tout le monde cherchait à abandonner les scores orchestraux au profit des scores rocks, country western ou qui incluaient une chanson, un hit. Peu importait le sujet ou le caractère dramatique du film, quelque chanson niaise par Johnny Mathis ou autre conclurait le générique final. Ce n’était pas là la façon de faire de Bernie. Il ne pouvait pas travailler comme ça. Quand ils (les producteurs) ont commencé lui dire qu’ils voulaient un « tube » dan le film, il n’a pas pu le supporter. I était très franc et ne se montrait pas hypocrite; il ne retenait jamais ses sentiments. Il les a fustigées. C’est pourquoi les gens avaient peur de lui. Ils ne voulaient pas de quelqu’un qui dise la vérité tout le temps.
C’est l’une des raisons pour lesquelles il eut ce problème avec Hitchcock. La cause n’en était pas tant la musique de TORN CURTAIN (Le Rideau Déchiré) mais qu’il était l’un des plus proches amis de Hitchcock et l’une des seules personnes qui osaient lui dire la vérité et la vérité était que quand Hitchcock rejoignit Universal, ses films devinrent moins bons. TORN CURTAIN était un mauvais film et TOPAZ (L’Etau) était affreux, mais même Hitchcock le savait. Joan Harrison m’a dit qu’il (Hitchcock) était extrêmement déçu du film alors même qu’il le tournait. Il savait que ce n’était pas bon. Il ne faisait plus de bons films et il le savait. Lorsqu’il revint en Angleterre, il fit un film presque réussi : FRENZY, qui au moins avait quelques scènes dignes du Hitchcock d’antan. La distribution des rôles était mal faite, voilà tout. Il fallait une star dans le rôle que tenait John Finch, et Hitchcock a toujours mieux travaillé quand il avait des stars. S’il avait eu Michael Caine dans le rôle, c’eut été différent. John Finch était trop quelconque. Il n’avait pas le charisme nécessaire pour porter le film. Mais la scène du sac de pommes de terre était merveilleuse. Bernie m’a dit que quand Hitchcock gagna l’Angleterre pour faire FRENZY, quelqu’un à Universal l’appela et lui dit « Hitch est en ville, seriez vous intéressé d’écrire la musique de FRENZY ? » Bernie a répondu de façon caractéristique : « Si Hitch me veut, pourquoi ne m’appelle-t-il pas lui-même ? » Il était comme ça, c’est pourquoi cela ne déboucha sur rien. Il aurait été désireux de retravailler pour Hitch si Hitch l’avait appelé.
De façon assez ironique, il disait qu’il haïssait Universal. Il pensait qu’Universal avait détruit sa relation avec Hitchcock. Il disait qu’il avait été très proche de lui, mais alors Hitchcock avait commencé à devenir très riche et était devenu un actionnaire important de Universal. Deux soirs par semaine, il dînait avec Wasserman, puis avec Schreiber, et Wasserman lui rendait visite dans sa maison. Chaque soir de la semaine en fait, il dînait avec des gens d’Universal, il ne voyait personne en dehors de la hiérarchie d’Universal, ils le rendaient riche et ses films devenaient de plus en plus mauvais. Il faisait des choses comme filmer des publicités pour Universal. Il faisait la série TV et il négociait ses droits sur la série contre des parts dans Universal. Il s’est enrichi de façon importante, mais ses films se détérioraient et il le savait. Il n’avait pas d’amis et était très seul et Bernie était l’une des seules personnes qui le connaissait et qui pouvait parler avec lui sur un plan d’égalité. Les gens d’Universal ne voulaient pas de Bemie à ses côtés. Ils disaient : « Ce type ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin : un tube ». Toute la question était là.
Après la rupture, Bernie qui était toujours anglophile partit pour l’Angleterre avec Norma, sa belle et jeune nouvelle épouse. J’ai toujours pensé que cette jeune femme a conduit à lui aliéner Hitchcock. Bernie n’était physiquement guère différent d’Hitchcock, plutôt gros et il n’était pas ce qu’on considérerait comme un homme attirant, mais Bernie était un homme à femmes - il avait toujours plus que sa part de femmes, il avait été marié trois fois et venait juste de se trouver une jeune femme de 30 ou 40 ans sa cadette. Hitchcock était un homme très réservé qui voulait avoir des aventures extra-conjugales, mais était effrayé de le faire. Il devenait vieux et Bernie arrivait avec sa nouvelle épouse, c’était juste une nouvelle épine dans le flanc d’Hitch. Après le clash avec Hitchcock, Bernie a déménagé en Angleterre avec sa femme et ils s’installèrent dans une jolie maison sur Regent’s Park. Ils ont recueilli un chien abandonné sur Ventura Boulevard, qu’ils ont appelé Alpy, et Bernie sortait promener le chien tous les matins à cinq heures et il eut du travail. Ce n’était pas le genre de travail qu’il faisait auparavant, mais il a fait des films britanniques, un film de Harley Mills et deux autres films, et alors peu à peu, de jeunes gens commencèrent à lui écrire lui demandant s’il pouvait les aider, il a fait ainsi SISTERS pour Brian de Palma et il est revenu pour faire THE EXORCIST.
Il s’est rendu à New York. Je venais de terminer IT’S ALIVE et je persuadais les gens à la Warner qui le connaissaient de voir si il était disponible pour écrire la musique pour moi. Ils ont répondu qu’il ne l’était pas puisqu’il faisait THE EXORCIST. Il s’est envolé pour New York pour rencontrer Friedkin, qui lui a montré le film. Après quoi, Friedkin lui a dit, selon Bernie : « Je veux que vous m’écriviez une meilleure musique que pour CITIZEN KANE ». Ce fut la fin de leurs relations. Bernie est retourné en Angleterre et ils ont choisi des disques pour la bande son. Des gens au département musical de la Warner m’avaient dit que Bernie était reparti en Angleterre. Ils m’ont obtenu son numéro de téléphone et je l’ai appelé Outre-Atlantique et j’ai dit : « Écoutez, j’ai cru comprendre que vous pourriez faire un film », il a dit : » Bon, envoyez-moi le film ». Donc je lui ai envoyé un montage noir et blanc du film et quelques semaines plus tard, j’ai reçu un coup de fil de sa par disant: « J’aime ce film, je vais le faire ». On a conclu un marché et on s’est entretenu plusieurs fois au téléphone. On a eu une dispute. Il y a une scène où les personnages regardent la télévision qui diffuse un dessin animé de Road Runner. Je lui ai demandé s’il pouvait écrire une musique incidentale pour le dessin animé. Il m’a dit : « Je n’écris pas de musique pour les dessins animés, trouvez-vous un autre compositeur ». J’ai immédiatement répondu : « Une minute, ne m’abandonnez pas. Si vous ne voulez pas écrire de musique pour le dessin animé, n’en écrivez pas. J’utiliserai des effets sonores ou quelque chose comme ça. On ne va pas se quitter pour quelque chose comme ça. Vous écrivez ce que vous voulez. Je ne vais pas passer derrière pour vous dire quoi écrire. Écrivez ce que vous voulez écrire et je suis sûr que j’en serai content. » Il a dit : « Voulez-vous assister aux sessions d’enregistrement ? ». J’ai répondu : « Je viendrai si vous voulez que je vienne ». Il a dit : « Bien entendu, que je souhaite que vous teniez ». Ainsi, directement, sans avoir à lui forcer la main, j’étais invité. C’est pourquoi je m’y suis rendu plus comme une personne invitée que comme quelqu’un cherchant à exercer son autorité sur lui.
C’est alors que nous nous rencontrâmes. On s’est rendu à sa maison, on l’a rencontré ainsi que sa femme, et à la fin de la journée, il nous a dit que nous devrions nous installer à Londres et nous sommes restés huit ou neuf mois et nous le voyions trois à quatre fois par semaine. Chaque jour, il téléphonait. Il devenait comme le grand-père, il appelait tous les jours pour prendre des nouvelles des enfants et de tout le monde. Je ne pouvais pas le croire, c’était un être si doux, si gentil, et quand il est mort tout le monde disait qu’il était terrible et difficile. Même aux funérailles, tout le monde fit des remarques sur son caractère difficile, peu agréable et autoritaire. Et ce n’était pas là le Bernie que nous connaissions. Nous le connaissions comme une tout autre personne qui n’aurait pas pu être plus douce.
Une chose étrange est qu’il détestait Universal pour s’être mis entre lui et Hitchcock, et lorsqu’il est revenu aux Etats-Unis, où l’ont-ils logé ? À l’arrière des studios Universal avec une fenêtre qui surplombait tout le lotissement. Il pouvait ainsi voir le bungalow de Hitchcock de sa fenêtre. Et c’est là qu’il est mort—sur le lotissement d’Universal. Ironie étrange. Le lendemain, nous reçûmes un appel de l’amie de Martin Scorcese, ils avaient rendez-vous pour le petit-déjeuner avec lui, et il avait été trouvé mort. Nous sommes venus immédiatement. Il y avait John Williams et on a ramené Norma, sa femme. Elle est restée chez nous un certain temps après sa mort et tout le monde est venu lui présenter les condoléances après les funérailles. Ainsi, nous avions De Palma, Scorcese et tous ces gens. Ils étaient tous présents pour le traditionnel repas. Truffaut n’est pas venu. Il s’est comporté de manière étrange aux funérailles, il se tenait éloigné du lieu du service religieux, très discret. Tous les autres étaient au premier rang, il s’est glissé pour le service et s’est écarté de nouveau. Je pense qu’il arrivait directement de Paris. Je lui ai parlé et il a dit : « Non, je ne peux pas venir, j’ai un avion ». Je pense donc qu’il est venu directement pour le service funèbre et est reparti immédiatement.
Les autres sont venus et le Rabbin voulait avoir un Mynian. Dans la religion Judaïque, dix adultes mâles doivent être présents pour dire une prière. Pour avoir une congrégation, il faut avoir dix hommes juifs âgés de plus de 13 ans. Le Rabbin cherchait donc à avoir ces prieurs et il ne pouvait pas trouver dix hommes juifs dans ce groupe, la plupart étant des non-juifs. Finalement, il décida de faire quand même la prière. Il distribua les Yamulkas, les coiffe-têtes, et De Palma en pris une, et Robert De Niro, et Scorcese, et Norman Lloyd, et nous tous formèrent un cercle dans la salle de séjour. De Palma demanda : « Que dois-je faire ? », je dis : « Vous secouez juste votre tête un peu, comme ça, de haut en bas ». Ils y avaient donc tous ces Italiens faisant un cercle comme des Juifs dans mon séjour, rendant un hommage funèbre à Bernard Herrmann. J’aurais aimé en garder une photo. Bernie l’aurait adoré.
Il est mort la veille de Noël, et sa femme est venue pour le dîner de Noël, elle a fait un dessin de tous les convives et elle a dessiné Bernie aussi. Bien qu’il soit mort la veille, elle l’a dessiné parmi le groupe. En dehors des films, vous avez ces relations personnelles et ce sont des choses personnelles qui sont importantes et qui en font l’intérêt. Je sais que si je n’avais pas fait qu’écrire de scénarios, je serais ici porte fermée et je n’aurais pas connu tous ces gens. Pour moi, le fait d’avoir rencontré tous ces gens merveilleux est l’un des grands plus au fait d’avoir fait ces films. La même chose avec Miklós Rózsa, qui est réellement en homme merveilleux. Ce sont là des grands hommes que vous rencontrez en dehors de ce travail.
Traduction : Denis Bricka
Publié à l’origine dans Soundtrack Magazine Vol.11 / No.42 / 1992
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur, Luc van de Ven