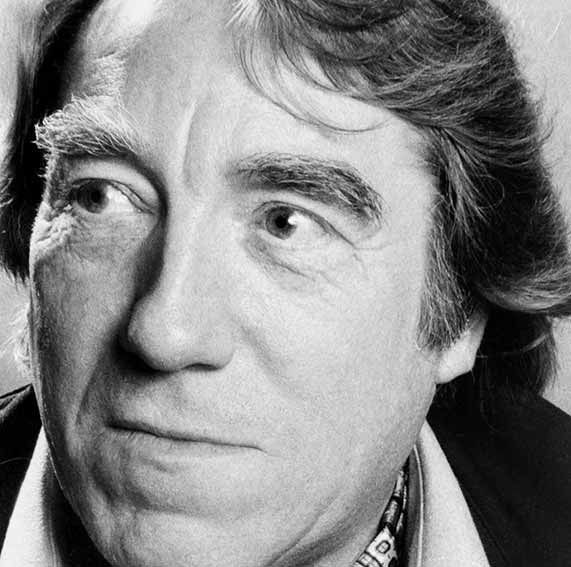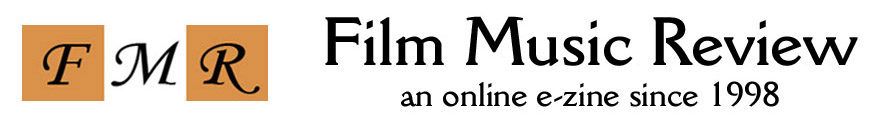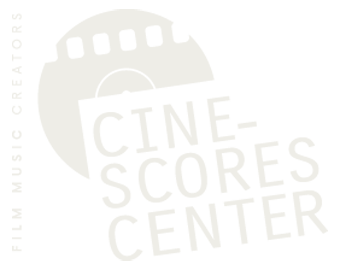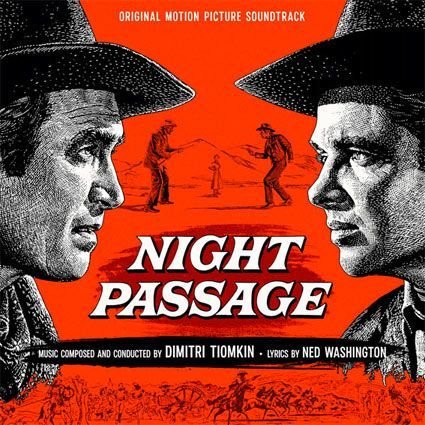Ben-Hur : A Tale of the Christ

Célèbre péplum de William Wyler et classique mythique du cinéma américain de 1959, Ben-Hur : A Tale of the Christ s’inspire du roman du général américain Lew Wallace écrit en 1880 et adapté à l’origine au théâtre en 1899 avant d’être porté une première fois au cinéma en 1926, réalisé par Fred Niblo - qui avait alors parmi ses assistants de l'époque un très jeune William Wyler. Ironie du sort, ce sera le même Wyler qui, quelques décennies plus tard, adaptera à son tour la pièce en un grand film épique et spectaculaire dépassant les 3h30. Ben-Hur : A Tale of the Christ raconte l’histoire célèbre de Judas Ben-Hur (formidable Charlton Heston dans le plus grand rôle de toute sa carrière !), prince de Judée qui va défier un jour son ancien ami d'enfance le tribun romain Messala (Stephen Boyd) pour avoir fait emprisonner injustement sa mère et sa soeur à la suite d'un incident que Ben-Hur n'a pas commis. Jeté dans les galères des prisonniers, Ben-Hur réussit à s'échapper lors d'une attaque de pirates et retourne à Rome pour accomplir sa vengeance. Il y retrouve sa fiancée Esther (Haya Harareet) et affronte finalement Messala lors d’une course de char qui vire au drame. Piétiné et écrasé par ses chevaux, Messala agonise sur son lit de mort et annonce alors à Ben-Hur que sa mère et sa soeur ont attrapé la lèpre, une maladie inguérissable à cette époque. Esther, la fiancée de Ben-Hur, lui affirme alors connaître un homme capable de les guérir, cet homme n’étant nul autre que Jésus Christ. Mais Ponce Pilate vient tout juste de le condamner à mort, et il est désormais trop tard. Près de 40 ans plus tard, Ben-Hur reste toujours aussi spectaculaire et imposant. La légendaire course de chars vers le milieu du film demeure encore aujourd’hui un pur moment d'anthologie cinématographique, comme le film en lui-même d'ailleurs. Il faut dire que Ben-Hur était à l'époque le film de tous les records : un budget colossal de 15 millions de dollars (énorme pour l'époque), des formats techniques innovants pour l'époque - filmé en Panavision avec un négatif d’origine au format large de 65mm, 4 mois de tournage pour filmer l'inoubliable course de chars, une authentique galère romaine entièrement reconstruite dans son intégralité, près de 40 scripts écrits à l'origine, 400000 figurants qui apparaissent dans le film et un triomphe monumental lors de la remise des Oscars en 1960 avec 12 nominations, 11 Oscars et 4 Golden Globes - un record ex-æquo avec Titanic et Lord of the Rings : Return of the King. Le film permit alors de sauver financièrement la MGM qui était à cette époque au bord de la faillite, et reste encore aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps.
Légendaire compositeur de l'âge d'or hollywoodien, Miklos Rozsa a accompli un travail colossal sur Ben-Hur : A Tale of the Christ. Plus qu'une simple partition musicale pour un péplum, Rozsa a dû mener un véritable travail d’historien de la musique pour tenter de se rapprocher le plus possible du contexte musical de l’époque à laquelle se déroule le film. Utilisant bien évidemment toutes les ressources d’un grand orchestre symphonique, Miklos Rozsa a construit une partition colossale autour d’une poignée de grands thèmes nombreux véhiculés à travers tout le film. Les nombreuses séquences spectaculaires ne manquent pas dans cette musique : la naissance de Jésus, la parade des chars avant la course, les marches romaines, la bataille des galères, la victoire de Ben-Hur à la course des chars (on sent d’ailleurs ici les influences de la musique de Rozsa sur l’esthétique des Star Wars de John Williams), la sinistre séquence funèbre du chemin de croix de Jésus sans oublier le magnifique final du film avec le miracle de la pluie qui purifie les visages de Miriam et Tirzah après la mort du Christ sur la croix : que de moments inoubliables qui, musicalement, sont portés par chaque note du compositeur avec une certaine grâce et un lyrisme classique constant.
L'ouverture de Ben-Hur reste tout bonnement imposante. Elle nous plonge d’emblée dans l'ambiance épique du film de William Wyler. Miklos Rozsa utilise une technique musicale qui deviendra systématiquement associé aux Romains dans le film, c'est-à-dire l’utilisation de quintes parallèles, un intervalle aux consonances médiévales/archaïques que l'harmonie classique moderne interdit ensuite dans ses traités. Ainsi, toutes les nombreuses fanfares qu'a écrit Rozsa pour les marches romaines sont basées autour de ce principe de quinte à vide en parallèle, qui résonnent avec une certaine dureté et une rigidité évoquant non seulement l'aspect historique de l'époque mais aussi la suprématie de l’empire romain. Ces marches pompeuses apportent un côté cérémonial, martial et spectaculaire à la partition de Rozsa. Elles demeurent très imposantes, en particulier grâce à un pupitre de cuivres très utilisé pour le caractère guerrier/militaire des fanfares (qui évoquent à maintes reprises Richard Wagner !). L'ouverture annonce alors d’emblée le thème de Ben-Hur après une fanfare très cuivrée nous plongeant directement dans l'ambiance du film. Le thème décrit en réalité la soif de vengeance de Ben-Hur, justifiant alors son côté dur et déterminé. Puis, pour l’inévitable séquence de l’épilogue, on assiste à la naissance du Christ. Miklos Rozsa annonce alors ici le deuxième grand thème de sa partition, le thème des rois mages, mélodie majestueuse aux accents populaires interprété magnifiquement ici par les cordes dans toute leur splendeur, et associé dans le film au miracle que représente la naissance de Jésus Christ sur terre.
Ben-Hur s’impose tout au long de l’écoute par la richesse et la variété de ses différentes émotions. Emerveillement avec la naissance du Christ et les rois mages, tristesse avec les moments dramatiques où Miriam et Tirzah sont devenus lépreuses et doivent se cacher dans la vallée des lépreux, séquence qui suggère toute l'amertume et la haine au coeur de Ben-Hur, mais aussi passages plus romantiques entre Ben-Hur et Esther - des passages qui restent toujours très stéréotypés et conventionnels, mais en tout cas parfaitement écrit dans un style postromantique 19èmiste du plus bel effet ! Reste que la partie guerrière est toujours aussi imposante : le défilé des chars s’avère être très prenant, avec cette longue marche cuivrée, sans oublier l'excitante bataille des galères - autre passage incontournable de la partition de Ben-Hur ! A ce propos, Rozsa introduit d’ailleurs cette séquence au son d’un rythme martial enlevé qui rappelle beaucoup le fameux « Mars » des « Planètes » de Gustav Holst (référence musicale incontournable au cinéma américain !). Cette excellente séquence musicale est suivie des coups de marteaux censés apporter le rythme aux rameurs de la galère afin de faire avancer le bateau. La musique de Rozsa suit alors astucieusement dans ce passage le rythme des marteaux, n'hésitant pas à devenir de plus en plus tendue voire stressante alors que les rythmes de marteaux s'accélèrent pour la vitesse d'attaque. Reste que la bataille des galères est un moment d'action incroyablement excitant, d’une puissance redoutable - autant à l’écran que sur l’album - un grand moment de musique en somme !
Miklos Rozsa utilise d'autres thèmes tout au long de sa partition. On retrouve ainsi l'inévitable « Love Theme » lyrique et sirupeux, celui de la vengeance de Ben-Hur mais aussi un thème aux consonances juives pour illustrer le retour de Ben-Hur à Jérusalem, lorsqu'il revient chez lui en Judée. La thématique de la partition de Ben-Hur demeure solide, riche et inspirée, magnifiquement construite, équilibrée et bien amenée. On retrouve à travers tout ces thèmes les principales idées du film : la vengeance, la passion, la lutte, la ferveur, et ce même si le point le plus important de l'oeuvre de Rozsa reste sans aucun doute l’incroyable reconstitution historique que le musicien a fait à partir d'une écriture symphonique très stylée (et aussi très stéréotypée !) qui impose une vision musicale colossale et titanesque de l'empire Romain à l'époque de Ben-Hur, une vision musicale qui ne pouvait naître qu’à travers les pages de l’un des plus grands maîtres du Golden Age hollywoodien. La dernière partie du film, celle concernant les deux lépreuses (la mère et la soeur de Ben-Hur) s’avère être radicalement plus sombre. Miklos Rozsa fait alors appel à des cordes amples et denses afin de retranscrire de manière très sombre la souffrance de Ben-Hur et celle de Miriam et Tirzah. La musique commence à résonner de façon particulièrement sombre et dramatique après le passage où le geôlier trouve Miriam et Tirzah au fond de leur cellule, devenues lépreuses. La musique devient alors quasiment terrifiante. La musique de la séquence dans la vallée des lépreux reste désespérée, sombre, dramatique. Rozsa utilise le pupitre des cordes agrémentées de couleurs tragiques et sombres que le compositeur obtient par exemple en utilisant un jeu d'harmoniques sur les cordes du plus bel effet.
Mais la véritable surprise de la partition de Ben-Hur reste sans aucun doute la superbe finale du film. Alors que le Christ meurt sur sa croix après avoir été crucifié, un terrible orage se déclenche. La pluie tombe et coule sur Miriam et Tirzah qui, miraculeusement, sont guéries de la lèpre. Cette séquence est évidemment symbolique : elle représente le pouvoir de la foi en Dieu. Le miracle de la guérison est une sorte de cadeau du ciel pour récompenser cette foi poignante, la pluie ruisselant sur le sol étant ici aussi un élément symbolique, image de l'eau qui purifie, qui lave les souillures, qui nettoie l'homme de ses pêchés. Et pour illustrer ce miracle, Miklos Rozsa utilise alors un choeur grandiose au milieu de l'orchestre afin de conférer à cette scène un caractère religieux indissociable de cette grande conclusion, une coda grandiose, véritable hymne aux miracles divins - à noter qu’il était de coutume à cette époque de conclure la plupart des péplums bibliques sur des choeurs religieux !
Ben-Hur : A Tale of the Christ reste au final une partition immense et démesurée, aux orchestrations magnifiques, servie par ses cuivres imposants et ses cordes lyriques typiques de Miklos Rozsa, illustrant la puissance de l'empire romain et de ses puissantes légions de centurions. Le compositeur nous offre sur le film de William Wyler une excellente reconstitution musicale de l’histoire à travers un style symphonique emprunté au répertoire postromantique allemand du 19ème siècle (Wagner, Strauss, Mahler), une approche conventionnelle et stéréotypée pour l’époque qui peut paraître aujourd’hui un peu datée, mais qui s’adaptait pourtant à merveille à la richesse visuelle et à la virtuosité technique de la superproduction de William Wyler. Quoiqu'il en soit, Ben-Hur : A Tale of the Christ restera à jamais une oeuvre majeure dans le monde de la musique de film, un chef-d'oeuvre épique et classique de l'âge d'or hollywoodien où tous les moyens étaient bons pour imposer à l’écran une écriture symphonique resplendissante et flamboyante, chose devenue beaucoup plus rare de nos jours. Un chef-d'oeuvre incontournable de la musique de film, tout simplement !