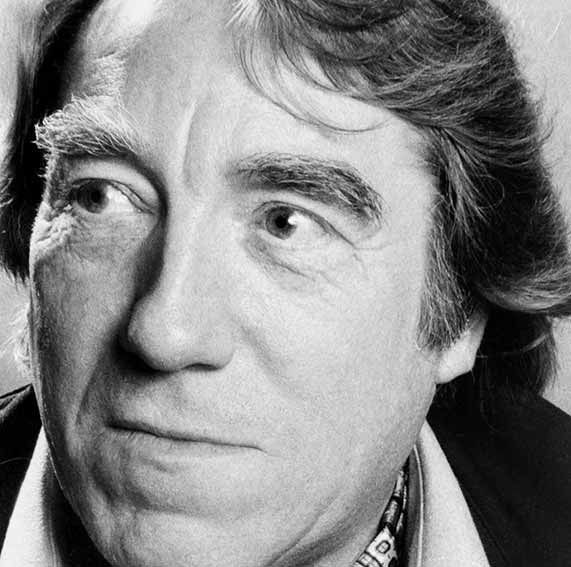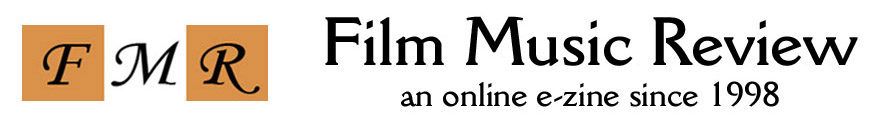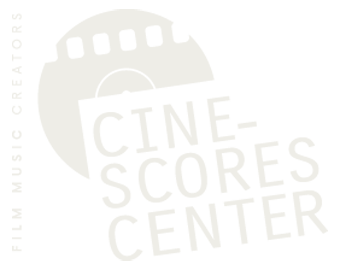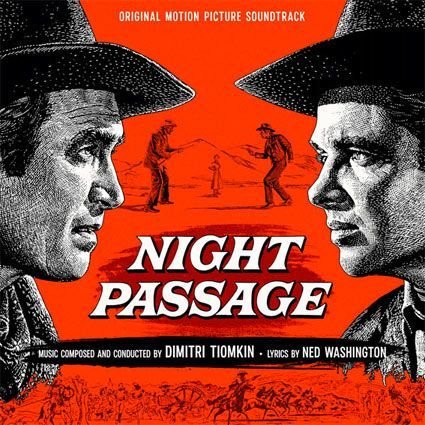Time After Time

Bien avant le célèbre 'Back To The Future' de Robert Zemeckis, le 'Time After Time' (C'était demain) de Nicholas Meyer (plus connu pour avoir réalisé 'Star Trek II: The Wrath of Khan' en 1982) traitait déjà du thème du voyage dans le temps, sujet que l'on doit au fameux romancier anglais H.G. Wells qui se trouve être le héros de ce thriller/science-fiction. Le scénario de ce film part sur une idée folle: H.G. Wells (interprété ici par Malcolm McDowell), le 'père de la science-fiction' moderne, auteur de 'The Time Machine', met au point la machine à voyager dans le temps dans le but d'explorer le passé et le futur de l'humanité. Or, il se trouve qu'au même moment, le célèbre tueur Jack l'éventreur continue de semer la terreur en assassinant sauvagement des prostitués des bas quartiers de Londres. La situation se complique alors lorsque la police découvre que Jack l'éventreur n'est autre que le médecin John Lesley Stevenson (David Warner), l'un des amis de Wells. Jack/Stevenson n'a plus qu'une seule solution: s'enfuir à bord de la machine à voyager dans le temps pour se réfugier dans le 20ème siècle, en 1979. Heureusement, la machine est faite pour revenir à son point de départ lorsqu'on lui enlève sa 'clé', et c'est bien ce que Wells a pensé à faire, si bien que la machine, ayant transporté Jack dans le futur, revient ensuite en 1895, permettant alors à Wells de l'utiliser à son tour pour se transporter en 1979 et poursuivre Jack l'éventreur à travers les rues de San Francisco, aux Etats-Unis. Commence alors une longue course contre la montre pour tenter d'arrêter l'assassin qui découvre un nouveau siècle violent et toujours aussi brutal. Entre temps, Wells va rencontrer Amy Robbins (Mary Steenburgen), une jeune américaine qui travaille dans une banque. Entre Wells et Amy va naître un grand amour qui sera pour Wells l'occasion de découvrir les coutumes et la manière de vivre de ce nouveau siècle. Dans la vraie vie, Amy Robbins fut la femme de H.G. Wells. Cette dernière mourut en 1927. Après sa mort, Wells écrivit 'The Shape of Things To Come' et mourut à son tour à Londres, le 13 Août 1946.
'Time After Time' est un film assez spécial, à mi-chemin entre la science-fiction et le thriller. Mélanger les deux grandes 'figures' anglaises que sont H.G. Wells et le sinistre Jack l'éventreur était un projet assez osé, et malgré le côté irréel de cette histoire, on ne peut qu'applaudir l'exploit accompli par le futur réalisateur de 'Star Trek II'. Derrière cette sombre histoire se cache aussi une parabole sur la sombre nature de l'homme, une nature cruelle et primitive qui n'évolue pas de siècle en siècle. En partant de son époque, des rêves plein la tête, Wells pense que la société du futur sera forcément meilleure, harmonieuse et plus paisible. Evidemment, il se trompait lourdement mais ne le savait pas encore. Cette terrible expérience dans le futur sera pour lui l'occasion de découvrir à quel point il a pu se tromper sur le compte de l'homme: malgré l'essor technologique de cette nouvelle époque, le 20ème siècle fut encore plus brutal et sanguinaire que le siècle précédent: deux guerres mondiales, une guerre au Viêt-nam, la prolifération des armes aux Etats-Unis, etc. Certes, la 'démonstration' que nous propose le réalisateur reste assez caricaturale, mais le propos n'en est pas moins juste. Si le scénario a retenu le personnage de Jack l'éventreur, c'était surtout pour renforcer cette parabole sur la violence de l'homme: Jack se vante d'être à 'l'origine' du 20ème siècle. Est-ce qu'à travers ses actes de barbarie le tueur voyait déjà ce que le futur allait devenir? Il ne fallait certainement pas être un devin pour comprendre que la situation de l'humanité n'allait pas s'améliorer dans les temps à venir. Pourtant dans le film, Wells nous est décrit comme un être optimiste, aux idées parfaitement utopiques, ce qui nous conduit finalement au triste propos du film: l'homme est un être mauvais et le restera à tout jamais, jusqu'à la fin des temps (l'histoire est là pour nous l'apprendre). L'autre message du film est bien entendu celui sur l'amour, ce grand Amour qui fait que la vie vaut la peine d'être vécu malgré la profonde connerie de l'homme, et la romance entre Wells et Amy est là pour nous le prouver. Une fois encore, et comme nous l'avons déjà mentionné un peu plus haut, tout cela reste très caricatural (le gentil amoureux, poli et optimiste, le méchant très cruel et inhumain, etc.) mais le film nous convainc néanmoins par la qualité de son scénario, les idées qui s'en dégagent et les effets spéciaux impressionnants pour l'époque (la séquence du voyage dans le temps vers le début du film est très impressionnante sur le plan visuel). Une véritable surprise!
Pour les besoins de son film, le réalisateur souhaitait renouer avec le son orchestral de l'âge d'or Hollywoodien. Le film de Meyers (sa toute première réalisation) se situe en pleine époque du renouveau du cinéma spectaculaire de science-fiction, relancé par Georges Lucas et Steven Spielberg. En 1977, Spielberg cartonnait avec 'Close Encounters of The 3th Kind'. La même année, Lucas connaissait un succès international avec 'Star Wars'. Ces deux grands monuments du cinéma de science-fiction ont contribués à relancer cette vague d'un cinéma d'aventure proche de ce que l'on avait pu connaître durant l'âge d'or Hollywoodien (la même année que 'Time After Time', Ridley Scott tournait l'inoubliable 'Alien' tandis que Robert Wise réalisait 'Star Trek: The Motion Picture'). C'est ce qui explique probablement le fait que le réalisateur, passionné par la musique du Golden Age Hollywoodien, ait voulu faire appel au grand Miklos Rozsa, surnommé par certain béophile comme étant 'le dernier grand compositeur romantique'. Malgré les qualités d'écriture irréprochables de cette partition alternant aventure, action et suspense, on ne peut s'empêcher d'être gêné par le style finalement 'vieillot' utilisé par Rozsa dans le film de Meyer. A l'écoute du score de 'Time After Time' dans le film, on a l'impression d'entendre une musique toute droit sorti d'un autre âge, d'une autre époque. Il y a un sérieux décalage entre le style 'moderne' du film (plus tourné vers les années 80) et le style 'ancien' de la musique, et ce décalage crée par moment un certain malaise. Etait-ce donc la meilleure solution à envisager pour la musique de film? Nous pourrons émettre quelques réserves en nuançant néanmoins notre propos, puisque, à l'image des deux personnages principaux du film, la musique de 'Time After Time' s'échappe elle aussi de son 'époque' pour se retrouver dans une autre époque, celle de 1979. C'est probablement dans cette optique là que la musique du film a été pensé, et on ne peut qu'applaudir le compositeur pour avoir réussi à élaborer une telle astuce, une telle gageure, même si on est un peu gêné par le décalage apparent entre l'époque du film et 'l'époque' de la musique.
La partition symphonique de Rozsa repose sur deux grands thèmes principaux, un excellent 'Love Theme' typique du compositeur, décrivant la romance entre Wells et Amy. L'autre thème est un sinistre motif descendant associé au tueur. Sa présence, souvent opposé au matériau plus romantique de la partition crée une sensation de malaise apparent: le mal est omniprésent et rôde tel un prédateur à la recherche d'une nouvelle proie. Pour renforcer le son 'Golden Age Hollywoodien' de sa partition, Rozsa a tenu à faire débuter le film au son de sa célèbre fanfare pour la Warner Bros, suivi du 'Main Title' qui donne le ton de l'oeuvre, dans un style orchestral plutôt ample privilégiant les cuivres, les cordes, quelques vents et quelques percussions. On retrouve ici le son 19èmiste typique du compositeur, un son qui coïncidence parfaitement avec le début du film qui se passe dans les années 1890 à Londres. N'oublions pas que la musique symphonique de cette époque était dominée en Allemagne et du côté de Vienne par Gustav Mahler, Richard Strauss ou bien encore Anton Bruckner , qui allait mourir en 1896. (Wagner étant mort en 1883). Bref, on débute le film en pleine période Romantique et, à l'instar du score de Rozsa, on reste dans ce style Romantique même après nous être transporté dans le San Francisco de 1979.
Le début du film nous plonge dans une atmosphère mystérieuse avec des cordes et des cuivres pesants qui rappellent le style thriller typique du compositeur (qui nous renvoie ici à ses musiques de thriller des années 40). Rozsa évoque alors les premiers méfaits de Jack l'éventreur. Evidemment, on pense par moment au style de Bernard Herrmann mais sans le côté lourd et appuyé des orchestrations. On a véritablement à faire ici à du Rozsa au sommet de son art (il continuera à composer jusqu'à la fin des années 90, et il mourra en 1995). La terreur et le suspense sont deux éléments typiques du score de 'Time After Time', et malgré le côté peu original de ces morceaux de suspense/frisson (on est parfois très proche de 'Spellbound' par exemple et d'une pièce telle que 'Terror On The Ski Run'), le résultat à l'écran est assez saisissant. Si Rozsa maintient son atmosphère de mystère tout au début du film jusqu'à la séquence du voyage dans le temps où il fait appel à une écriture plus rythmé et saccadée faisant intervenir les percussions, xylophone, cuivres, etc., c'est le romantisme qui apparaîtra dans la seconde partie de la composition de Rozsa avec le fameux 'Time Machine Waltz', interprété au piano par Eric Parkin pour la scène où Wells et Amy dînent ensemble au restaurant. Le 'Time Machine Waltz' est en faite une reprise du 'Love Theme' pour piano solo, un thème que Rozsa développera parfaitement à l'orchestre par la suite (il aura même recours à une version avec violon soliste et orchestre, digne de 'Double Indemnity').
Mais c'est la partie suspense à la 'Spellbound' que l'on retiendra ici. L'action apparaît dans un premier climax, l'excitant 'The Ripper/Pursuit' qui s'avère être un premier grand tour de force orchestral de la part du compositeur. Pour la première séquence de poursuite dans les rue de San Francisco, Rozsa martèle une rythmique orchestrale excitante reposant sur un rythmique frénétique allant crescendo jusqu'à l'issue de la scène (Jack arrive à s'échapper). On notera la manière dont le compositeur a recours aux cuivres (cors et trombones bien mis en avant avec les trompettes) et aux percussions et à la façon dont il fait s'accélérer le tempo du morceau jusqu'à la séquence où une voiture renverse un passant qui ressemble à Jack. Un autre élément particulièrement marquant apparaît dans le petit thème de boîte à musique que l'on entend toujours de manière rituelle avant que Jack commette un meurtre. (ce petit motif est diffusé sur sa petite montre/boîte à musique dont il ne se sépare jamais) A noter la façon dont l'orchestre fait parfois écho à ce thème en reprenant la mélodie sous une forme orchestrale dérivée comme pour mieux personnifier le côté malsain du personnage. 'Frightened', 'Murder' et 'The Last Victim' sont autant de pièces qui font monter la tension et évoquent le suspense avec des cuivres pesants et agressifs et des cordes tendues et dissonantes (à noter l'utilisation remarquable de la harpe dans la séquence du 'Nocturnal Visitor'). Le thème de Jack l'éventreur prend une plus grande importance dans le morceau 'The Fifth Victim' lorsque Jack fait sa cinquième victime. Ce thème devient de plus en plus hypnotisant et Rozsa l'orchestre de manière à le rendre de plus en plus pesant. 'Dangerous Drive' est finalement le dernier grand morceau d'action du score, très proche de l'excellent 'The Ripper/Pursuit'. 'Dangerous Drive' renoue avec le style excitant de 'The Ripper/Pursuit' en martelant une nouvelle rythmique orchestrale frénétique pleine de fureur et d'énergie. Le morceau rend cette dernière scène de poursuite (en voiture) particulièrement intense, évoquant presque par moment la musique d'action que l'on pourra entendre à l'époque, surtout chez Jerry Goldsmith. On a à faire ici à un deuxième grand tour de force orchestral de la part du compositeur qui a écrit l'un de ses plus beaux passages d'action de cette fin des années 70. L'histoire trouvera paisiblement sa conclusion sur le très romantique 'Journey's End/Final' qui reprend une dernière fois le 'Love Theme' dans une version de cordes très sirupeuse mais aussi très 'happy-end' Hollywoodien kitsch des années 30/40.
Avec 'Time After Time', pas de concession: d'une manière totalement radicale, Miklos Rozsa aura tenu à aller jusqu'au bout de son propos en écrivant un score de suspense/terreur renouant avec le style du Golden Age Hollywoodien des années 30 jusqu'aux années 50. Certes, le décalage apparent avec la 'modernité' du film peut choquer, mais le résultat n'en est que plus conséquent: on part d'une époque pour voyager dans une autre, et le final mièvre très 'classicisme Hollywoodien' pourrait parfaitement évoquer cette idée de retour vers le passé (Amy et Wells retournent dans les années 1890, Wells emportant Amy avec lui). Certes, 'Time After Time' n'a rien d'une composition follement originale: Rozsa se tourne très clairement ici vers son passé en renouant avec le style de ses musiques thriller telles que 'Spellbound', 'Double Indemnity' ou bien encore 'The Killers'. Néanmoins, 'Time After Time' est considéré comme l'un des derniers grands classiques du compositeur d'origine hongroise avec sa fameuse partition pour 'Providence' écrite en 1977 pour le non moins célèbre film d'Alain Resnais. Pour les fans de Miklos Rozsa, 'Time After Time' s'avère être une BO incontournable. Pour les autres, il se pourrait bien qu'il soit surpris par l'énergie déployé par le compositeur dans ses morceaux d'action et de suspense. Un score qui rend un bien bel hommage aux musiques thrillers/romantiques du 'Golden Age Hollywoodien', signé par l'un des derniers grands maîtres de cette époque déjà quelque peu lointaine.